Raton-Liseur's 2024 reading journal (Part 2)
This is a continuation of the topic Raton-Liseur's 2024 reading journal (Part 1).
TalkClub Read 2024
Join LibraryThing to post.
1raton-liseur
Summer break is already a few weeks through, and I enjoy my quiet holidays this year. So maybe it's time to try to resume talking about books?
I actually liked my break from LT. It was not planned and just happened. I thought it was due to a lack of time and energy, but if I look back I feel I enjoyed this time not reading about books: I did not have temptations (and actually bought almost no books during those last months, neither did I feel the urge to buy some). But I did read. Maybe not always a lot, but I kept on reading, mainly books that I had bought in the past couple of years but never found the time to read. So it was a nice reading period after all, despite being away from you.
The flip side is that I have a backlog of reviews to write bigger than I ever had (more than 30…). I do plan to absorb this backlog, but I have so many other things I would like to do during this break that I’ll see how things go…
I realise that I also have a long list of books I would like to read during this summer break. I’m not learning from my “mistakes”, as I keep enjoying making never-able-to-complete wishlists…
This second part of my annual reading log will include books read since the beginning of July, and then I will try to update the first part when I write long overdue reviews.
I will limit the set up posts by not adding the lists of books to read from: I feel that I keep on copying those lists from one thread to another with too limited changes and it’s depressing, so I have decided that I will include them in my home page for personal reference only.
I actually liked my break from LT. It was not planned and just happened. I thought it was due to a lack of time and energy, but if I look back I feel I enjoyed this time not reading about books: I did not have temptations (and actually bought almost no books during those last months, neither did I feel the urge to buy some). But I did read. Maybe not always a lot, but I kept on reading, mainly books that I had bought in the past couple of years but never found the time to read. So it was a nice reading period after all, despite being away from you.
The flip side is that I have a backlog of reviews to write bigger than I ever had (more than 30…). I do plan to absorb this backlog, but I have so many other things I would like to do during this break that I’ll see how things go…
I realise that I also have a long list of books I would like to read during this summer break. I’m not learning from my “mistakes”, as I keep enjoying making never-able-to-complete wishlists…
This second part of my annual reading log will include books read since the beginning of July, and then I will try to update the first part when I write long overdue reviews.
I will limit the set up posts by not adding the lists of books to read from: I feel that I keep on copying those lists from one thread to another with too limited changes and it’s depressing, so I have decided that I will include them in my home page for personal reference only.
2raton-liseur
Personal on-going reading commitments

 Tour du monde en livres
Tour du monde en livres

 Petite bibliothèque des prix Nobel de littérature
Petite bibliothèque des prix Nobel de littérature

 Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire : Les Rougon-Macquart d’Emile Zola
Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire : Les Rougon-Macquart d’Emile Zola

 Luis Sepúlveda in extenso
Luis Sepúlveda in extenso

 Prix Gens de mer
Prix Gens de mer

 Prix Emile Guimet
Prix Emile Guimet

 Backlog list from the 2022 Asian book challenge
Backlog list from the 2022 Asian book challenge

 Backlog list from the 2023 African novel challenge
Backlog list from the 2023 African novel challenge
3raton-liseur
Books read in July 2024














57. -. (-) La Brute et le Divin de Léonard Chemineau
58. 42. (33) Anne de Bretagne, Duchesse et reine de France de Claire L'Hoër
59. 43. (-) Nouvelles du Front de Marine Tondelier
60. 44. (1e) Les Cloches de Nagasaki de Takashi Nagai, traduit de la version anglaise par Prune de Mentque et révisé à partir de la version japonaise par Mashuko Osuki-Demenois
61. 45. (-) Veilleuse du Calvaire de Lyonel Trouillot
62. 46. (34) Cérès et Vesta de Greg Egan, traduit de l'anglais (Australie) par Erwann Perchoc
63. 47. (35) Les gais Lurons de Robert Louis Stevenson, traduit de l'anglais par Théo Varlet
64. 48. (-) Chiennes de garde de Dahlia de la Cerda, traduit de l'espagnol (Mexique) par Lise Belperron
65. 7g. (-) Idiss de Richard Malka (scénario) et Fred Bernard (dessin), d'après le livre éponyme de Robert Badinter
66. 8g. (-) Dans la forêt de Lomig, d'après le roman éponyme de Jean Hegland
67. -. (-) La tempête de Marino Neri,, traduit de l'italien par Hélène Dauniol-Remaud
68. -. (-) Plein Ciel de Pierre-Roland Saint-Dizier (scénario) et Michaël Crosa (dessin)
69. 9g. (-) Ce que je sais de Rokia de Quitterie Simon (scénario) et Francesca Vartuli (dessin)
70. 10g. (-) The Talk de Darrin Bell, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cécile Hermellin














57. -. (-) La Brute et le Divin de Léonard Chemineau
58. 42. (33) Anne de Bretagne, Duchesse et reine de France de Claire L'Hoër
59. 43. (-) Nouvelles du Front de Marine Tondelier
60. 44. (1e) Les Cloches de Nagasaki de Takashi Nagai, traduit de la version anglaise par Prune de Mentque et révisé à partir de la version japonaise par Mashuko Osuki-Demenois
61. 45. (-) Veilleuse du Calvaire de Lyonel Trouillot
62. 46. (34) Cérès et Vesta de Greg Egan, traduit de l'anglais (Australie) par Erwann Perchoc
63. 47. (35) Les gais Lurons de Robert Louis Stevenson, traduit de l'anglais par Théo Varlet
64. 48. (-) Chiennes de garde de Dahlia de la Cerda, traduit de l'espagnol (Mexique) par Lise Belperron
65. 7g. (-) Idiss de Richard Malka (scénario) et Fred Bernard (dessin), d'après le livre éponyme de Robert Badinter
66. 8g. (-) Dans la forêt de Lomig, d'après le roman éponyme de Jean Hegland
67. -. (-) La tempête de Marino Neri,, traduit de l'italien par Hélène Dauniol-Remaud
68. -. (-) Plein Ciel de Pierre-Roland Saint-Dizier (scénario) et Michaël Crosa (dessin)
69. 9g. (-) Ce que je sais de Rokia de Quitterie Simon (scénario) et Francesca Vartuli (dessin)
70. 10g. (-) The Talk de Darrin Bell, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cécile Hermellin
4raton-liseur
Books read in August 2024




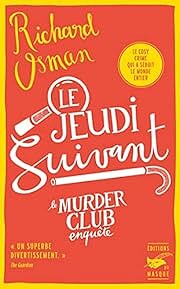

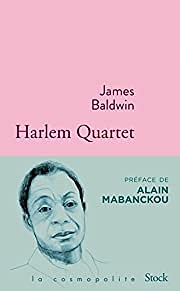


71. 49. (36) La Fosse aux Vents, tome 1 : Ceux de la "Galatée" de Roger Vercel
72. 50. (37) La Fosse aux Vents, tome 2 : La Peau du Diable de Roger Vercel
73. 51. (38) La Fosse aux Vents, tome 3 : Atalante de Roger Vercel
74. -. (39) La Dure Loi du karma de Mo Yan, traduit du chinois par Chantal Chen-Andro
75. 52. (-) Le Murder Club enquête, tome 2 : Le Jeudi suivant de Richard Osman, traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Sophie Alibert
76. -. (-) Bâtardes de Rachel Corenblit
77. 53. (40) Harlem Quartet de James Baldwin, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Christiane Besse
78. 11g. (-) Salon de beauté de Quentin Zuttion
79. 54. (41) Médée Kali, suivi de Sodome , ma douce de Laurent Gaudé




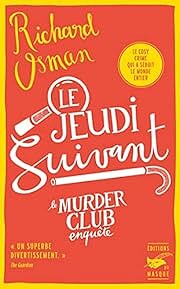

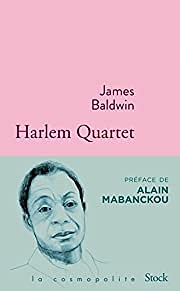


71. 49. (36) La Fosse aux Vents, tome 1 : Ceux de la "Galatée" de Roger Vercel
72. 50. (37) La Fosse aux Vents, tome 2 : La Peau du Diable de Roger Vercel
73. 51. (38) La Fosse aux Vents, tome 3 : Atalante de Roger Vercel
74. -. (39) La Dure Loi du karma de Mo Yan, traduit du chinois par Chantal Chen-Andro
75. 52. (-) Le Murder Club enquête, tome 2 : Le Jeudi suivant de Richard Osman, traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Sophie Alibert
76. -. (-) Bâtardes de Rachel Corenblit
77. 53. (40) Harlem Quartet de James Baldwin, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Christiane Besse
78. 11g. (-) Salon de beauté de Quentin Zuttion
79. 54. (41) Médée Kali, suivi de Sodome , ma douce de Laurent Gaudé
5raton-liseur
Books read in September 2024

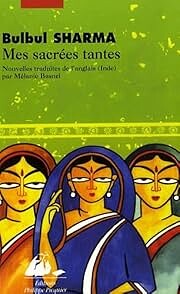




80. 55. (-) Les Saisons et les Jours de Caroline Miller, traduit de l'américain par Michèle Valencia
81. 56. (42) Mes Sacrées Tantes de Bulbul Sharma, traduit de l'anglais (Inde) par Mélanie Basnel
82. 57. (43) Requiem pour un paysan espagnol de Ramón J. Sender, traduit de l'espagnol par Jean-Paul Cortada
83. 58. (44) La Montgolfière de Willa Cather, traduit de l'américain par Victor Llona
84. 59. (-) Les Voisins, et autres nouvelles de Diane Oliver, traduit de l’anglais (États-Unis) par Marguerite Capelle
85. 12g. (-) Intrus à l'Etrange de Simon Hureau

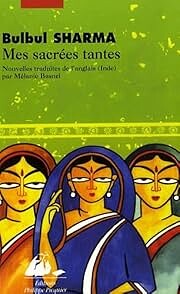




80. 55. (-) Les Saisons et les Jours de Caroline Miller, traduit de l'américain par Michèle Valencia
81. 56. (42) Mes Sacrées Tantes de Bulbul Sharma, traduit de l'anglais (Inde) par Mélanie Basnel
82. 57. (43) Requiem pour un paysan espagnol de Ramón J. Sender, traduit de l'espagnol par Jean-Paul Cortada
83. 58. (44) La Montgolfière de Willa Cather, traduit de l'américain par Victor Llona
84. 59. (-) Les Voisins, et autres nouvelles de Diane Oliver, traduit de l’anglais (États-Unis) par Marguerite Capelle
85. 12g. (-) Intrus à l'Etrange de Simon Hureau
6raton-liseur
Books read in October 2024








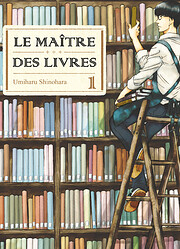







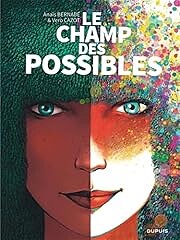
86. 60. (45) La Dette publique : Précis d'économie citoyenne d'Eric Berr, Léo Charles, Arthur Jatteau, Jonathan Marie et Alban Pellegris pour le collectif des Economistes atterrés
87. 13g. (-) Les Crieurs du Crime : La Belle Epoque du fait divers de Sylvain Venayre (scénario) et Hugues Micol (dessin)
88. -. (-) Albert Londres doit disparaître de Frédéric Kinder (scénario) et Brice Follet (dessin)
89. 61. (-) Rire avec le diable de Bruno Patino
90. -. (-) Matin brun de Franck Pavloff
91. 62. (46) Grand-peur et misère du IIIe Reich de Bertolt Brecht, traduit de l'allemand par Pierre Vesperini
92. 63. (-) Rendez-vous d'amour dans un pays en guerre de Luis Sepúlveda, traduit de l’espagnol (Chili) par François Gaudry
93. 64. (47) Les Ames de feu d'Annie Francé-Harrar, traduit de l'allemand (Autriche) par Erwann Perchoc
94. -. (-) Le Maître des livres, tome 1 d'Umiharu Shinohara, traduit du japonais par Fabien Nabhan
95. 65. (48) Pasó por aquí d'Eugene Manlove Rhodes, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Serge Chauvin
96. -. (-) Le plus beau vœu de Mini-Taupe de Sang-Keun Kim, adapté du coréen par Lim Yeong-hee
97. 66. (-) Maï, une femme effacée de Geetanjali Shree, traduit du hindi (Inde) par Annie Montaut
98. 67. (49) Impossibles adieux de Han Kang, traduit du coréen par Kyungran Choi et Pierre Bisiou
99. 14g. (-) Lebensborn d'Isabelle Maroger
100. 15g. (-) Mémoires de Gris de Sylvain Ferret
101. 16g. (-) Henri de Turenne : Sur le front de Corée de Stéphane Marchetti (scénario) et Rafael Ortiz (dessin)
102. 17g. (-) Le Champs des possibles de Vero Cazot (scénario) et Anaïs Bernabé (dessin)








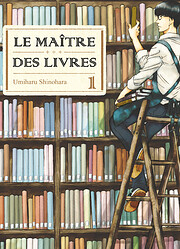







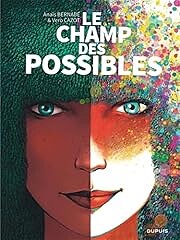
86. 60. (45) La Dette publique : Précis d'économie citoyenne d'Eric Berr, Léo Charles, Arthur Jatteau, Jonathan Marie et Alban Pellegris pour le collectif des Economistes atterrés
87. 13g. (-) Les Crieurs du Crime : La Belle Epoque du fait divers de Sylvain Venayre (scénario) et Hugues Micol (dessin)
88. -. (-) Albert Londres doit disparaître de Frédéric Kinder (scénario) et Brice Follet (dessin)
89. 61. (-) Rire avec le diable de Bruno Patino
90. -. (-) Matin brun de Franck Pavloff
91. 62. (46) Grand-peur et misère du IIIe Reich de Bertolt Brecht, traduit de l'allemand par Pierre Vesperini
92. 63. (-) Rendez-vous d'amour dans un pays en guerre de Luis Sepúlveda, traduit de l’espagnol (Chili) par François Gaudry
93. 64. (47) Les Ames de feu d'Annie Francé-Harrar, traduit de l'allemand (Autriche) par Erwann Perchoc
94. -. (-) Le Maître des livres, tome 1 d'Umiharu Shinohara, traduit du japonais par Fabien Nabhan
95. 65. (48) Pasó por aquí d'Eugene Manlove Rhodes, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Serge Chauvin
96. -. (-) Le plus beau vœu de Mini-Taupe de Sang-Keun Kim, adapté du coréen par Lim Yeong-hee
97. 66. (-) Maï, une femme effacée de Geetanjali Shree, traduit du hindi (Inde) par Annie Montaut
98. 67. (49) Impossibles adieux de Han Kang, traduit du coréen par Kyungran Choi et Pierre Bisiou
99. 14g. (-) Lebensborn d'Isabelle Maroger
100. 15g. (-) Mémoires de Gris de Sylvain Ferret
101. 16g. (-) Henri de Turenne : Sur le front de Corée de Stéphane Marchetti (scénario) et Rafael Ortiz (dessin)
102. 17g. (-) Le Champs des possibles de Vero Cazot (scénario) et Anaïs Bernabé (dessin)
7raton-liseur
Books read in November 2024









103. 68. (-) Ma grand-mère était un homme de Mahamat-Saleh Haroun
104. 18g. (-) Je suis leur silence de Jordi Lafebre, traduit de l'espagnol par Geneviève Maubille
105. 69. (50) Terrasses, ou Notre Long Baiser si longtemps retardé de Laurent Gaudé
106. 70. (51) Pourquoi la guerre ? : une correspondance entre Albert Einstein et Sigmund Freud, traduit de l'allemand par Blaise Briod
-. -. (-) Le Maître des livres, tome 2 d'Umiharu Shinohara, traduit du japonais par Fabien Nabhan
107. 71. (-) Le Tableau du maître flamand d'Arturo Pérez-Reverte, traduit de l'espagnol par Yves Gonzalez-Quijano
108. -. (-) Le Maître des livres, tome 3 d'Umiharu Shinohara, traduit du japonais par Fabien Nabhan
109. 72. (52) Un lycée pas comme les autres d'Yvonne Meynier
110. 19g. (-) Pisse-Mémé de Cati Baur









103. 68. (-) Ma grand-mère était un homme de Mahamat-Saleh Haroun
104. 18g. (-) Je suis leur silence de Jordi Lafebre, traduit de l'espagnol par Geneviève Maubille
105. 69. (50) Terrasses, ou Notre Long Baiser si longtemps retardé de Laurent Gaudé
106. 70. (51) Pourquoi la guerre ? : une correspondance entre Albert Einstein et Sigmund Freud, traduit de l'allemand par Blaise Briod
-. -. (-) Le Maître des livres, tome 2 d'Umiharu Shinohara, traduit du japonais par Fabien Nabhan
107. 71. (-) Le Tableau du maître flamand d'Arturo Pérez-Reverte, traduit de l'espagnol par Yves Gonzalez-Quijano
108. -. (-) Le Maître des livres, tome 3 d'Umiharu Shinohara, traduit du japonais par Fabien Nabhan
109. 72. (52) Un lycée pas comme les autres d'Yvonne Meynier
110. 19g. (-) Pisse-Mémé de Cati Baur
8raton-liseur
Books read in December 2024

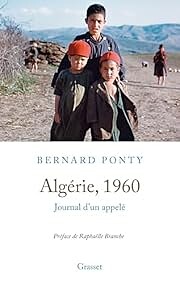


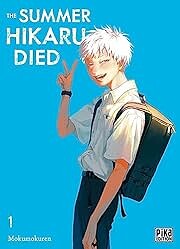
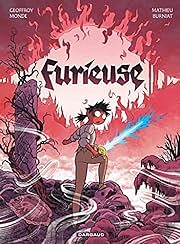

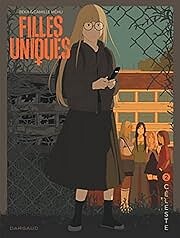


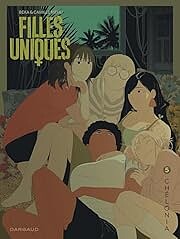






111. 73. (53) Les jours viennent et passent d'Hemley Boum
112. -. (-) Algérie, 1960 : Journal d'un appelé de Bernard Ponty
113. 20g. (54) Souffler sur le feu : Violences passées et à venir en Inde de Joe Sacco, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sidonie Van der Dries
114. 21g. (-) Coquelicot de Fanny Vella
115. -. (-) The Summer Hikaru died, tome 1 de Mokumokuren, traduit du japonais par Manon Debienne et Sayaka Okada
116. 22g. (-) Furieuse de Geoffroy Monde (scénario) et Mathieu Burniat (dessin)
117. 23g. (-) Filles uniques, tomes 1 à 5 de BeKa (scénario) et ★ Camille Méhu (dessin)
118. 24g. (-) Je suis au-delà de la mort de L'Homme étoilé
119. 25g. (-) Champs de bataille : L'Histoire enfouie du remembrement d'Inès Léraud (scénario) et Pierre Van Hove (dessin)
120. 74. (-) Une Fratrie de Brigitte Reimann, traduit de l'allemand par Françoise Toraille
121. -. (-) Poison Ivy, tome 1 : Cycle vertueux de G. Willow Wilson (scénario) et Marcio Takara (dessin), traduit de l'anglais par Mathieu Auverdin
122. 26g. (55) Crayon noir : Samuel Paty, histoire d'un prof de Valérie Igounet (texte) et Guy Le Besnerais (adaptation et dessin)
123. 27g. (56) Le Voyage de Shuna d'Hayao Miyazaki, traduit du japonais par Léopold Dahan
Gallery of authors read in December 2024 (wordy books)


73. ★ Hemley Boum
74. ★ Brigitte Reimann
Gallery of authors read in December 2024 (graphic books)









:quality(50)/2023/10/17/uhfk3znlj5fphjenuepsj43bom-652e85dbaf7f7362469847.jpg)

20g. Joe Sacco
21g. ★ Fanny Vella
22g. ★ Geoffroy Monde (scénario) et ★ Mathieu Burniat (dessin)
23g. BeKa (scénario) et ★ Camille Méhu (dessin)
24g. ★ L'Homme étoilé
25g. ★ Inès Léraud (scénario) et ★ Pierre Van Hove (dessin)
26g. ★ Valérie Igounet (texte) et ★ Guy Le Besnerais (adaptation et dessin)
27g. ★ Hayao Miyazaki
Currently reading

 Life of Pi de Yann Martel
Life of Pi de Yann Martel
☐
🗵

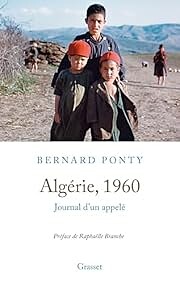


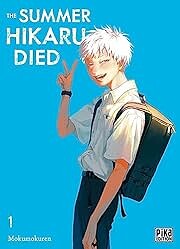
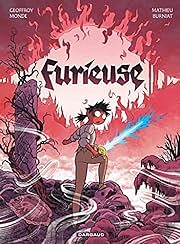

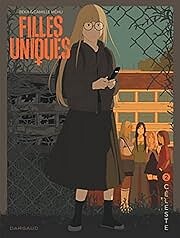


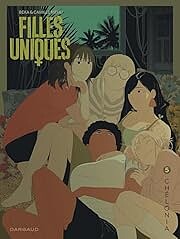






111. 73. (53) Les jours viennent et passent d'Hemley Boum
112. -. (-) Algérie, 1960 : Journal d'un appelé de Bernard Ponty
113. 20g. (54) Souffler sur le feu : Violences passées et à venir en Inde de Joe Sacco, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sidonie Van der Dries
114. 21g. (-) Coquelicot de Fanny Vella
115. -. (-) The Summer Hikaru died, tome 1 de Mokumokuren, traduit du japonais par Manon Debienne et Sayaka Okada
116. 22g. (-) Furieuse de Geoffroy Monde (scénario) et Mathieu Burniat (dessin)
117. 23g. (-) Filles uniques, tomes 1 à 5 de BeKa (scénario) et ★ Camille Méhu (dessin)
118. 24g. (-) Je suis au-delà de la mort de L'Homme étoilé
119. 25g. (-) Champs de bataille : L'Histoire enfouie du remembrement d'Inès Léraud (scénario) et Pierre Van Hove (dessin)
120. 74. (-) Une Fratrie de Brigitte Reimann, traduit de l'allemand par Françoise Toraille
121. -. (-) Poison Ivy, tome 1 : Cycle vertueux de G. Willow Wilson (scénario) et Marcio Takara (dessin), traduit de l'anglais par Mathieu Auverdin
122. 26g. (55) Crayon noir : Samuel Paty, histoire d'un prof de Valérie Igounet (texte) et Guy Le Besnerais (adaptation et dessin)
123. 27g. (56) Le Voyage de Shuna d'Hayao Miyazaki, traduit du japonais par Léopold Dahan
Gallery of authors read in December 2024 (wordy books)


73. ★ Hemley Boum
74. ★ Brigitte Reimann
Gallery of authors read in December 2024 (graphic books)









:quality(50)/2023/10/17/uhfk3znlj5fphjenuepsj43bom-652e85dbaf7f7362469847.jpg)

20g. Joe Sacco
21g. ★ Fanny Vella
22g. ★ Geoffroy Monde (scénario) et ★ Mathieu Burniat (dessin)
23g. BeKa (scénario) et ★ Camille Méhu (dessin)
24g. ★ L'Homme étoilé
25g. ★ Inès Léraud (scénario) et ★ Pierre Van Hove (dessin)
26g. ★ Valérie Igounet (texte) et ★ Guy Le Besnerais (adaptation et dessin)
27g. ★ Hayao Miyazaki
Currently reading
 Life of Pi de Yann Martel
Life of Pi de Yann Martel☐
🗵
9raton-liseur
Gallery of authors read in July 2024 (wordy books)
Note: A star in front of the name means it is a new-to-me author.







42. ★ Claire L'Hoër
43. ★ Marine Tondelier
44. ★ Takashi Nagai
45. ★ Lyonel Trouillot
46. Greg Egan
47. Robert Louis Stevenson
48. ★ Dahlia de la Cerda
Gallery of authors read in August 2024 (wordy books)




49. ; 50. et 51. Roger Vercel
52. Richard Osman
53. ★ James Baldwin
54. Laurent Gaudé
Note: A star in front of the name means it is a new-to-me author.







42. ★ Claire L'Hoër
43. ★ Marine Tondelier
44. ★ Takashi Nagai
45. ★ Lyonel Trouillot
46. Greg Egan
47. Robert Louis Stevenson
48. ★ Dahlia de la Cerda
Gallery of authors read in August 2024 (wordy books)



49. ; 50. et 51. Roger Vercel
52. Richard Osman
53. ★ James Baldwin
54. Laurent Gaudé
10raton-liseur
Gallery of authors read in September 2024 (wordy books)
Note: A star in front of the name means it is a new-to-me author.





55. ★ Caroline Miller
56. Bulbul Sharma
57. ★ Ramón J. Sender
58. Willa Cather
59. ★ Diane Oliver
Gallery of authors read in October 2024 (wordy books)








60. ★ Les Economistes atterrés
61. ★ Bruno Patino
62. Bertolt Brecht
63. Luis Sepúlveda
64. ★ Annie Francé-Harrar
65. ★ Eugene Manlove Rhodes
66. ★ Geetanjali Shree
67. ★ Han Kang
Note: A star in front of the name means it is a new-to-me author.




55. ★ Caroline Miller
56. Bulbul Sharma
57. ★ Ramón J. Sender
58. Willa Cather
59. ★ Diane Oliver
Gallery of authors read in October 2024 (wordy books)








60. ★ Les Economistes atterrés
61. ★ Bruno Patino
62. Bertolt Brecht
63. Luis Sepúlveda
64. ★ Annie Francé-Harrar
65. ★ Eugene Manlove Rhodes
66. ★ Geetanjali Shree
67. ★ Han Kang
11raton-liseur
Gallery of authors read in November 2024 (wordy books)
Note: A star in front of the name means it is a new-to-me author.
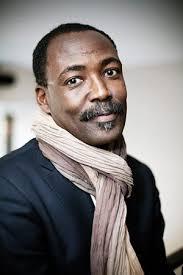





68. ★ Mahamat-Saleh Haroun
69. Laurent Gaudé
70. ★ Albert Einstein et ★ Sigmund Freud
71. Arturo Pérez-Reverte
72. ★ Yvonne Meynier
Gallery of authors read in December 2024 (wordy books)
Note: A star in front of the name means it is a new-to-me author.
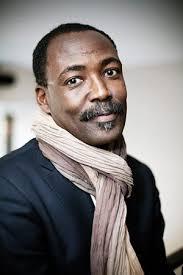





68. ★ Mahamat-Saleh Haroun
69. Laurent Gaudé
70. ★ Albert Einstein et ★ Sigmund Freud
71. Arturo Pérez-Reverte
72. ★ Yvonne Meynier
Gallery of authors read in December 2024 (wordy books)
12raton-liseur
Gallery of authors read in July 2024 (graphic books)
Note: A star in front of the name means it is a new-to-me author.
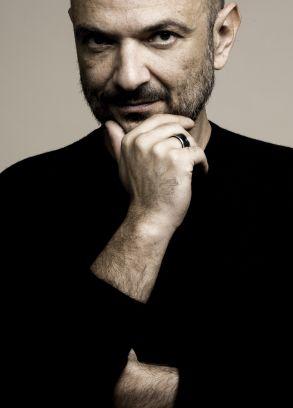


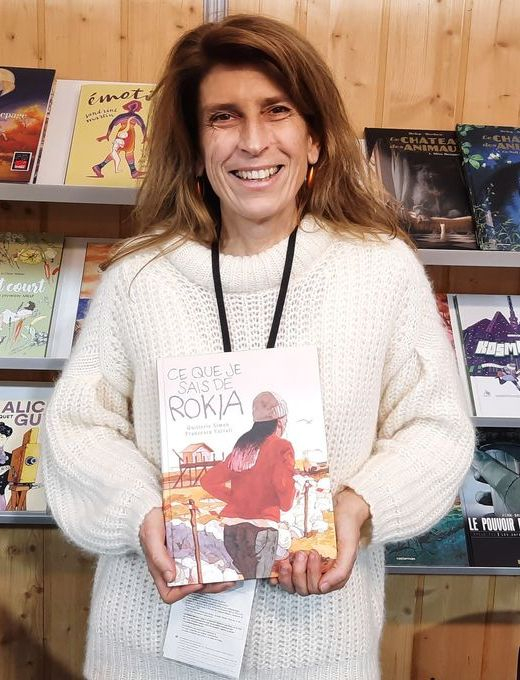


7g. Richard Malka (scénario) et Fred Bernard (dessin)
8g. Lomig
9g. ★ Quitterie Simon (scénario) et ★ Francesca Vartuli (dessin)
10g. ★ Darrin Bell
Gallery of authors read in August 2024 (graphic books)

11g. ★ Quentin Zuttion
Note: A star in front of the name means it is a new-to-me author.
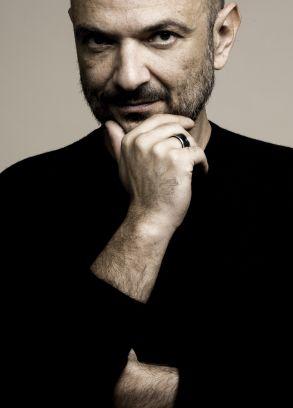


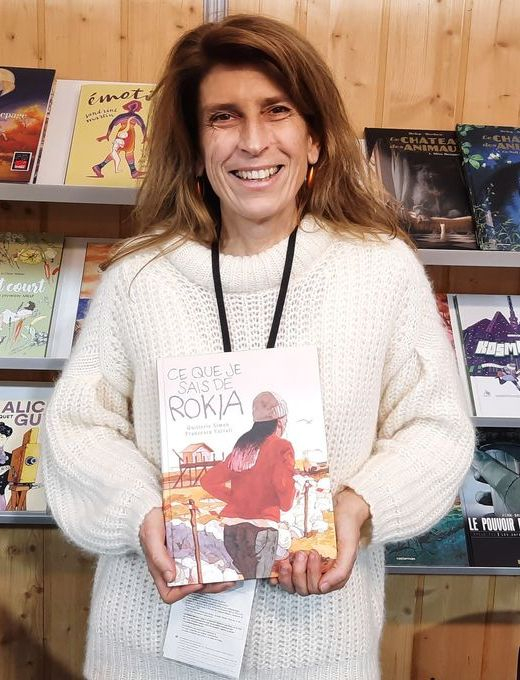


7g. Richard Malka (scénario) et Fred Bernard (dessin)
8g. Lomig
9g. ★ Quitterie Simon (scénario) et ★ Francesca Vartuli (dessin)
10g. ★ Darrin Bell
Gallery of authors read in August 2024 (graphic books)

11g. ★ Quentin Zuttion
13raton-liseur
Gallery of authors read in September 2024 (graphic books)
Note: A star in front of the name means it is a new-to-me author.

12g. ★ Simon Hureau
Gallery of authors read in October 2024 (graphic books)


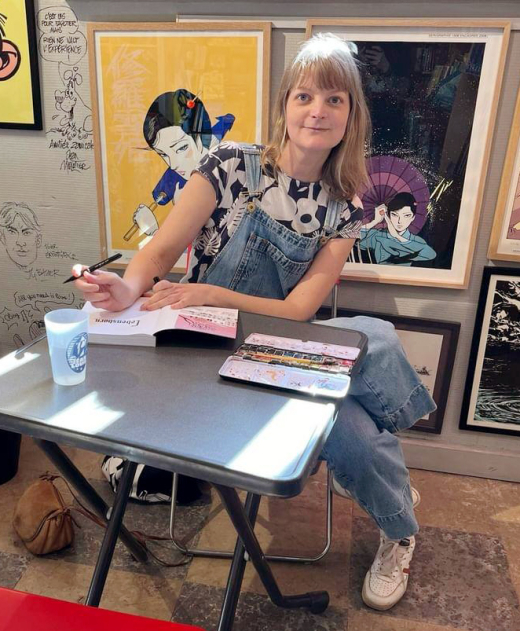





13g. ★ Sylvain Venayre (scénario) et ★ Hugues Micol (dessin)
14g. ★ Isabelle Maroger
15g. ★ Sylvain Ferret
16g. ★ Stéphane Marchetti (scénario) et ★ Rafael Ortiz (dessin)
17g. ★ Vero Cazot (scénario) et ★ Anaïs Bernabé (dessin)
Note: A star in front of the name means it is a new-to-me author.

12g. ★ Simon Hureau
Gallery of authors read in October 2024 (graphic books)


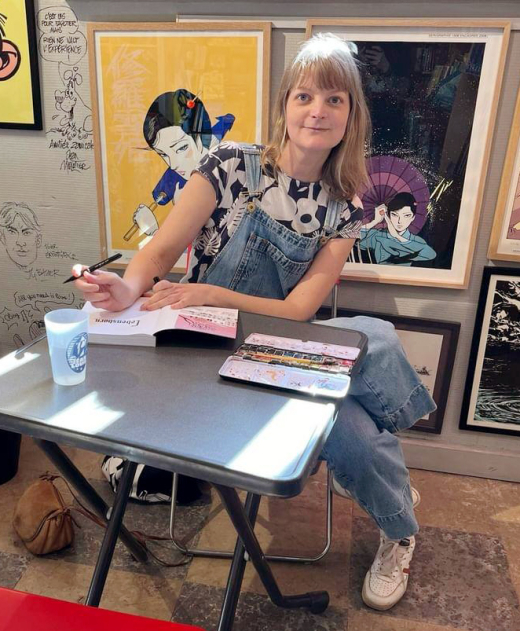





13g. ★ Sylvain Venayre (scénario) et ★ Hugues Micol (dessin)
14g. ★ Isabelle Maroger
15g. ★ Sylvain Ferret
16g. ★ Stéphane Marchetti (scénario) et ★ Rafael Ortiz (dessin)
17g. ★ Vero Cazot (scénario) et ★ Anaïs Bernabé (dessin)
14raton-liseur
Gallery of authors read in November 2024 (graphic books)
Note: A star in front of the name means it is a new-to-me author.


18g. Jordi Lafebre
19g. ★ Cati Baur
Gallery of authors read in December 2024 (graphic books)
Note: A star in front of the name means it is a new-to-me author.


18g. Jordi Lafebre
19g. ★ Cati Baur
Gallery of authors read in December 2024 (graphic books)
15raton-liseur
Unread books bought earlier in 2024
by alphabetical order of author
 Les jours viennent et passent d'Hemley Boum
Les jours viennent et passent d'Hemley Boum
 Un Monde pour Julius d'Alfredo Bryce Echenique, traduit de l'espagnol (Pérou) par Albert Bensoussan
Un Monde pour Julius d'Alfredo Bryce Echenique, traduit de l'espagnol (Pérou) par Albert Bensoussan
 La Forêt suspendue de Louise Erdrich, traduit de l’américain par Mimi Perrin
La Forêt suspendue de Louise Erdrich, traduit de l’américain par Mimi Perrin
 Alma, livre 3 : La Liberté de Timothée de Fombelle
Alma, livre 3 : La Liberté de Timothée de Fombelle
 Médée Kali, suivi de Sodome , ma douce de Laurent Gaudé
Médée Kali, suivi de Sodome , ma douce de Laurent Gaudé
 Les autres et les miens de Pierre-Jakez Hélias
Les autres et les miens de Pierre-Jakez Hélias
 Crayon noir : Samuel Paty, histoire d'un prof de Valérie Igounet (texte) et Guy Le Besnerais (adaptation et dessin)
Crayon noir : Samuel Paty, histoire d'un prof de Valérie Igounet (texte) et Guy Le Besnerais (adaptation et dessin)
 Nancy-Kabylie de Dorothée-Myriam Kellou
Nancy-Kabylie de Dorothée-Myriam Kellou
 La Ballade du café triste et autres nouvelles de Carson McCullers, traduit de l'américain par Jacques Tournier
La Ballade du café triste et autres nouvelles de Carson McCullers, traduit de l'américain par Jacques Tournier
 Fine de Charlotte Merle
Fine de Charlotte Merle
 Un lycée pas comme les autres d'Yvonne Meynier
Un lycée pas comme les autres d'Yvonne Meynier
 La Maison du splendide isolement d’Edna O’Brien, traduit de l’anglais (Irlande) par Jean-Baptiste de Seynes
La Maison du splendide isolement d’Edna O’Brien, traduit de l’anglais (Irlande) par Jean-Baptiste de Seynes
 Opinion d'une femme sur les femmes de Fanny Raoul
Opinion d'une femme sur les femmes de Fanny Raoul
 La Chartreuse de Parme de Stendhal
La Chartreuse de Parme de Stendhal
 L'Art de perdre d'Alice Zeniter
L'Art de perdre d'Alice Zeniter
 Lais bretons: aux origines de la poésie chantée médiévale de Gérard Domenec’h et Agnès Brosset, accompagné d’un CD de chants interprétés par l’ensemble COLORTALEA
Lais bretons: aux origines de la poésie chantée médiévale de Gérard Domenec’h et Agnès Brosset, accompagné d’un CD de chants interprétés par l’ensemble COLORTALEA
 La Dette publique : Précis d'économie citoyenne de Eric Berr, Léo Charles, Arthur Jatteau, Jonathan Marie et Alban Pellegris, membres du collectif des Economistes atterrés
La Dette publique : Précis d'économie citoyenne de Eric Berr, Léo Charles, Arthur Jatteau, Jonathan Marie et Alban Pellegris, membres du collectif des Economistes atterrés
 Histoire de l'autre : Israël - Palestine, ouvrage collectif traduit de l'arabe par Rachid Akel et de l'hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech
Histoire de l'autre : Israël - Palestine, ouvrage collectif traduit de l'arabe par Rachid Akel et de l'hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech
by alphabetical order of author
16raton-liseur
Books acquired in July 2024
 1e. La Havane année zéro de Karla Súarez, traduit de l'espagnol (Cuba) par François Gaudry
1e. La Havane année zéro de Karla Súarez, traduit de l'espagnol (Cuba) par François Gaudry
 2e. Ouragans tropicaux de Leonardo Padura, traduit de l’espagnol (Cuba) par René Solis
2e. Ouragans tropicaux de Leonardo Padura, traduit de l’espagnol (Cuba) par René Solis
 3e. Les Cloches de Nagasaki de Takashi Nagai, traduit de la version anglaise par Prune de Mentque et révisé à partir de la version japonaise par Mashuko Osuki-Demenois
3e. Les Cloches de Nagasaki de Takashi Nagai, traduit de la version anglaise par Prune de Mentque et révisé à partir de la version japonaise par Mashuko Osuki-Demenois
 4e. Les enfants du désordre de Janine Elkouby
4e. Les enfants du désordre de Janine Elkouby
 5e. La fille du cryptographe de Pablo de Santis, traduit de l’espagnol (Argentine) par François Gaudry
5e. La fille du cryptographe de Pablo de Santis, traduit de l’espagnol (Argentine) par François Gaudry
 (free download as a special offer from the publisher) Nouvelles du Front de Marine Tondelier
(free download as a special offer from the publisher) Nouvelles du Front de Marine Tondelier
 39. (new) Prière aux vivants pour leur pardonner d'être vivants, et autres poèmes de Charlotte Delbo
39. (new) Prière aux vivants pour leur pardonner d'être vivants, et autres poèmes de Charlotte Delbo
Books acquired in August 2024
 (press service) Bâtardes de Rachel Corenblit
(press service) Bâtardes de Rachel Corenblit
 (press service) Salon de beauté de Quentin Zuttion
(press service) Salon de beauté de Quentin Zuttion
Books acquired in August 2024
17raton-liseur
Books acquired in September 2024
 40. (second hand) Les Girofliers de Zanzibar d'Adam Shafi Adam, traduit du swahili par Jean-Pierre Richard
40. (second hand) Les Girofliers de Zanzibar d'Adam Shafi Adam, traduit du swahili par Jean-Pierre Richard
 41. (second hand) Abdul Bashur, le rêveur de navires d'Alvaro Mutis, traduit de l'espagnol par François Maspero
41. (second hand) Abdul Bashur, le rêveur de navires d'Alvaro Mutis, traduit de l'espagnol par François Maspero
 42. (second hand) Mes Sacrées Tantes de Bulbul Sharma, traduit de l'anglais (Inde) par Mélanie Basnel
42. (second hand) Mes Sacrées Tantes de Bulbul Sharma, traduit de l'anglais (Inde) par Mélanie Basnel
 43. (second hand) Destins obscurs de Willa Cather, traduit de l'américain par Michèle Causse
43. (second hand) Destins obscurs de Willa Cather, traduit de l'américain par Michèle Causse
 44. (second hand) Cassandre : Les prémisses et le récit de Christa Wolf, traduit de l'allemand par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein
44. (second hand) Cassandre : Les prémisses et le récit de Christa Wolf, traduit de l'allemand par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein
 45. (second hand) Mutinerie à bord de Jacques Perret
45. (second hand) Mutinerie à bord de Jacques Perret
 46. (second hand) Chevaliers et Chatelaines de la mer de Georges G. Toudouze
46. (second hand) Chevaliers et Chatelaines de la mer de Georges G. Toudouze
 47. (second hand) Maintenant que j'ai 50 ans de Bulbul Sharma, traduit de l'anglais (Inde) par Mélanie Basnel
47. (second hand) Maintenant que j'ai 50 ans de Bulbul Sharma, traduit de l'anglais (Inde) par Mélanie Basnel
 48. (second hand) La Montgolfière de Willa Cather, traduit de l'américain par Victor Llona
48. (second hand) La Montgolfière de Willa Cather, traduit de l'américain par Victor Llona
 49. (second hand) Le Pays sans ombre d'Abdoulahman A. Waberi
49. (second hand) Le Pays sans ombre d'Abdoulahman A. Waberi
 50. (second hand) Requiem pour un paysan espagnol / Réquiem por un campesino español de Ramon J. Sender, traduit de l'espagnol par Jean-Paul Cortada
50. (second hand) Requiem pour un paysan espagnol / Réquiem por un campesino español de Ramon J. Sender, traduit de l'espagnol par Jean-Paul Cortada
 (press service) Les Voisins, et autres nouvelles de Diane Oliver, traduit de l’anglais (États-Unis) par Marguerite Capelle
(press service) Les Voisins, et autres nouvelles de Diane Oliver, traduit de l’anglais (États-Unis) par Marguerite Capelle
 (press service) Les Crieurs du Crime : La Belle Epoque du fait divers de Sylvain Venayre (scénario) et Hugues Micol (dessin)
(press service) Les Crieurs du Crime : La Belle Epoque du fait divers de Sylvain Venayre (scénario) et Hugues Micol (dessin)
 51. (new) Grand-peur et misère du IIIe Reich de Bertolt Brecht, traduit de l'allemand par Pierre Vesperini
51. (new) Grand-peur et misère du IIIe Reich de Bertolt Brecht, traduit de l'allemand par Pierre Vesperini
 52. (new) Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire
52. (new) Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire
 53. (new) Ana non d'Agustin Gomez-Arcos
53. (new) Ana non d'Agustin Gomez-Arcos
 54. (new) Dors ton sommeil de brute de Carole Martinez
54. (new) Dors ton sommeil de brute de Carole Martinez
 55. (new) Titus Andronicus, Jules César, Antoine et Cléopâtre, Coriolan de William Shakespeare, traduit de l'anglais par François-Victor Hugo
55. (new) Titus Andronicus, Jules César, Antoine et Cléopâtre, Coriolan de William Shakespeare, traduit de l'anglais par François-Victor Hugo
 56. (new) Printemps au coin cassé de Mario Benedetti, traduit de l'espagnol par Caroline Lepage
56. (new) Printemps au coin cassé de Mario Benedetti, traduit de l'espagnol par Caroline Lepage
 (press service) Intrus à l'Etrange de Simon Hureau
(press service) Intrus à l'Etrange de Simon Hureau
 (press service) Maï, une femme effacée de Geetanjali Shree, traduit du hindi (Inde) par Annie Montaut
(press service) Maï, une femme effacée de Geetanjali Shree, traduit du hindi (Inde) par Annie Montaut
 57. (new) Les limites à la croissance (dans un monde fini) de Dennis Meadows, Donella Meadows et Jorgen Randers, traduit de l'anglais par Agnès El Kaïm
57. (new) Les limites à la croissance (dans un monde fini) de Dennis Meadows, Donella Meadows et Jorgen Randers, traduit de l'anglais par Agnès El Kaïm
 58. (new) Près de la mer d'Abdulrazak Gurnah, traduit de l'anglais par Sylvette Gleize
58. (new) Près de la mer d'Abdulrazak Gurnah, traduit de l'anglais par Sylvette Gleize
 59. (new) Hommage à la Catalogne de George Orwell, traduit de l'anglais par Yvonne Davet
59. (new) Hommage à la Catalogne de George Orwell, traduit de l'anglais par Yvonne Davet
 60. (new) Les Ames de feu d'Annie Francé-Harrar, traduit de l'allemand (Autriche) par Erwann Perchoc
60. (new) Les Ames de feu d'Annie Francé-Harrar, traduit de l'allemand (Autriche) par Erwann Perchoc
Books acquired in October 2024
 (press service) Rire avec le diable de Bruno Patino
(press service) Rire avec le diable de Bruno Patino
 (press service) Ma grand-mère était un homme de Mahamat-Saleh Haroun
(press service) Ma grand-mère était un homme de Mahamat-Saleh Haroun
 (press service) Algérie, 1960 : Journal d'un appelé de Bernard Ponty
(press service) Algérie, 1960 : Journal d'un appelé de Bernard Ponty
 61. (new) Chroniques du Pays des gens les plus heureux du monde de Wole Soyinka, traduit de l’anglais (Nigéria) par David Fauquemberg et Fabienne Kanor
61. (new) Chroniques du Pays des gens les plus heureux du monde de Wole Soyinka, traduit de l’anglais (Nigéria) par David Fauquemberg et Fabienne Kanor
 62. (new) Lettre à ma fille de Maya Angelou, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Anne-Emmanuelle Robicquet
62. (new) Lettre à ma fille de Maya Angelou, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Anne-Emmanuelle Robicquet
 (gift) L’Homme des îles de Tomás O’Crohan, traduit du gaélique par Jean Buhler et Una Murphy
(gift) L’Homme des îles de Tomás O’Crohan, traduit du gaélique par Jean Buhler et Una Murphy
 63. (new) Impossibles adieux de Han Kang, traduit du coréen par Kyungran Choi et Pierre Bisiou
63. (new) Impossibles adieux de Han Kang, traduit du coréen par Kyungran Choi et Pierre Bisiou
 64. (new) Terrasses, ou Notre Long Baiser si longtemps retardé de Laurent Gaudé
64. (new) Terrasses, ou Notre Long Baiser si longtemps retardé de Laurent Gaudé
 65. (new) Pour mourir, le monde de Yan Lespoux
65. (new) Pour mourir, le monde de Yan Lespoux
 (press service) Mémoires de Gris de Sylvain Ferret
(press service) Mémoires de Gris de Sylvain Ferret
 (press service) Le plus beau vœu de Mini-Taupe de Sang-Keun Kim, adapté du coréen par Lim Yeong-hee
(press service) Le plus beau vœu de Mini-Taupe de Sang-Keun Kim, adapté du coréen par Lim Yeong-hee
Books acquired in October 2024
18raton-liseur
Books acquired in November 2024
 (press service) Le Tableau du maître flamand d'Arturo Pérez-Reverte, traduit de l'espagnol par Yves Gonzalez-Quijano
(press service) Le Tableau du maître flamand d'Arturo Pérez-Reverte, traduit de l'espagnol par Yves Gonzalez-Quijano
 (press service) Champs de bataille : L'Histoire enfouie du remembrement d'Inès Léraud (scénario) et Pierre Van Hove (dessin)
(press service) Champs de bataille : L'Histoire enfouie du remembrement d'Inès Léraud (scénario) et Pierre Van Hove (dessin)
 66. (new) Pourquoi la guerre ? : une correspondance entre Albert Einstein et Sigmund Freud, traduit de l'allemand par Blaise Briod
66. (new) Pourquoi la guerre ? : une correspondance entre Albert Einstein et Sigmund Freud, traduit de l'allemand par Blaise Briod
Books acquired in December 2024
 67. (new) Klara et le soleil de Kazuo Ishiguro, traduit de l'anglais par Anne Rabinovitch
67. (new) Klara et le soleil de Kazuo Ishiguro, traduit de l'anglais par Anne Rabinovitch
 68. (new) Dette : 5000 ans d'histoire de David Graeber, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Françoise et Paul Chemla
68. (new) Dette : 5000 ans d'histoire de David Graeber, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Françoise et Paul Chemla
 (loyalty card gift) Le Voyage de Shuna d'Hayao Miyazaki, traduit du japonais par Léopold Dahan
(loyalty card gift) Le Voyage de Shuna d'Hayao Miyazaki, traduit du japonais par Léopold Dahan
 69. (new) Souffler sur le feu : Violences passées et à venir en Inde de Joe Sacco, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sidonie Van der Dries
69. (new) Souffler sur le feu : Violences passées et à venir en Inde de Joe Sacco, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sidonie Van der Dries
 (press service) Une Fratrie de Brigitte Reimann, traduit de l'allemand par Françoise Toraille
(press service) Une Fratrie de Brigitte Reimann, traduit de l'allemand par Françoise Toraille
 (Christmas present) Et que se taisent les vagues : Chili - La Traversée de Désirée et Alain Frappier
(Christmas present) Et que se taisent les vagues : Chili - La Traversée de Désirée et Alain Frappier
Books acquired in December 2024
19raton-liseur
All set for my first July reviews and my grand come back to CR!
20raton-liseur
57. -. (-) La brute et le divin de Léonard Chemineau
Titre en anglais : non traduit


Une bd aux beaux dessins et aux couleurs éclatantes pour parler de sobriété, de nécessaire changement de mode de vie et pour nous mettre devant nos contradictions, celles d’une impréparation à une plus grande autonomie, voire autarcie (qui de nous est capable de construire sa maison, de faire pousser sa nourriture…), mais aussi celles des chimères du tout technologique et de la fuite en avant.
J’ai passé un bon moment de lecture et j’ai bien aimé, même si cette bd rend un peu inconfortable car, sans donner de leçon, elle montre bien à quel point on n’en fait pas assez pour essayer de sauver ce qui est encore à sauver...
Titre en anglais : non traduit


Une bd aux beaux dessins et aux couleurs éclatantes pour parler de sobriété, de nécessaire changement de mode de vie et pour nous mettre devant nos contradictions, celles d’une impréparation à une plus grande autonomie, voire autarcie (qui de nous est capable de construire sa maison, de faire pousser sa nourriture…), mais aussi celles des chimères du tout technologique et de la fuite en avant.
J’ai passé un bon moment de lecture et j’ai bien aimé, même si cette bd rend un peu inconfortable car, sans donner de leçon, elle montre bien à quel point on n’en fait pas assez pour essayer de sauver ce qui est encore à sauver...
21labfs39
Welcome back, Raton! Although I missed you, I understand the need and desire for breaks. It sounds like yours was full of relaxed reading. A worthy way to spend your summer break.
22raton-liseur
>21 labfs39: Thanks Lisa. It's really nice to be back, even if I enjoyed my time far from LT.
it's pretty paradoxical: I enjoy the recommendations I get from LT, enjoy most of the books I read after finding them here, but it was nice to be away from that for some time.
Anyway, I hope I’m back for good and will be able to post my reviews fairly regularly, and then start again reading other people’s thread and even commenting, from time to time!
it's pretty paradoxical: I enjoy the recommendations I get from LT, enjoy most of the books I read after finding them here, but it was nice to be away from that for some time.
Anyway, I hope I’m back for good and will be able to post my reviews fairly regularly, and then start again reading other people’s thread and even commenting, from time to time!
23raton-liseur
58. 42. (32) Anne de Bretagne, duchesse et reine de Claire L'Hoër
Titre en anglais : non traduit


Anne de Bretagne est un personnage qui me fascine, comme il fascine beaucoup de Bretons, mais dont je connais peu de choses et, paradoxalement, plutôt son côté reine de France que son côté duchesse de Bretagne. J’avais lu il y a trois ans je crois une biographie écrite par Frédéric Morvan, qui m’avait un peu laissée sur ma faim parce qu’elle faisait un portrait en creux et disait très peu sur Anne de Bretagne (parce qu’il y a très peu d’informations directement sur elle, c’était donc une posture scientifique très honnête de la part de cet historien). La biographie de Claire de L’Hoër est un livre plus grand public, plus proche de la vulgarisation, mais il est intéressant aussi car il arrive à faire revivre Anne de Bretagne, tout en restant, autant que je puisse en juger, fidèle à l’histoire et aux sources. Pour cela, elle s’attache à comprendre la personne derrière ce que l’on connaît d’Anne de Bretagne : ses décision politiques, ses parures, ses livres, ses commandes artistiques et ses grands chantiers.
Une biographie fort bien faite, facile à lire et à suivre, même si je n’ai pas été convaincue par le dernier chapitre qui tente de comprendre pourquoi Anne de Bretagne a été ainsi récupérée politiquement par tant d’idéologies parfois contradictoires.
Titre en anglais : non traduit


Anne de Bretagne est un personnage qui me fascine, comme il fascine beaucoup de Bretons, mais dont je connais peu de choses et, paradoxalement, plutôt son côté reine de France que son côté duchesse de Bretagne. J’avais lu il y a trois ans je crois une biographie écrite par Frédéric Morvan, qui m’avait un peu laissée sur ma faim parce qu’elle faisait un portrait en creux et disait très peu sur Anne de Bretagne (parce qu’il y a très peu d’informations directement sur elle, c’était donc une posture scientifique très honnête de la part de cet historien). La biographie de Claire de L’Hoër est un livre plus grand public, plus proche de la vulgarisation, mais il est intéressant aussi car il arrive à faire revivre Anne de Bretagne, tout en restant, autant que je puisse en juger, fidèle à l’histoire et aux sources. Pour cela, elle s’attache à comprendre la personne derrière ce que l’on connaît d’Anne de Bretagne : ses décision politiques, ses parures, ses livres, ses commandes artistiques et ses grands chantiers.
Une biographie fort bien faite, facile à lire et à suivre, même si je n’ai pas été convaincue par le dernier chapitre qui tente de comprendre pourquoi Anne de Bretagne a été ainsi récupérée politiquement par tant d’idéologies parfois contradictoires.
24raton-liseur
59. 43. (-) Nouvelles du Front de Marine Tondelier
Titre en anglais : non traduit


Les éditions du Lien qui Libèrent ont eu la bonne idée, après le traumatisme des résultats du premier tour des élections législatives, de mettre en accès libre ce livre, bien qu’il date un peu (2017, autant dire le moyen-âge dans notre société où l’actualité a une durée de vie d’à peine plus d’une demi-minute) et bien qu’il ne soit pas transposable (les compétences au niveau d’une commune ne sont pas celles de l’État ; les échelles ne sont pas les mêmes, les contre-pouvoirs non plus). Lorsque ce livre est paru, Marine Tondelier n’était pas encore le personnage médiatique qu’elle est devenue, elle est une jeune conseillère municipale d’à peine 30 ans, faisant ses armes dans la ville d’Hénin-Beaumont, devenue célèbre nationalement pour être le premier fief nordique du Front National.
Bien sûr c’est un livre, qui comme d’habitude, ne convaincra que ceux qui sont déjà convaincus, voire que ne liront que ceux qui sont déjà convaincus (mais n’est-ce pas plus ou moins le lot de tous les livres politiques?).
Ce qu’elle raconte n’est pas bien joli. Et ce sont notamment les techniques de gestion du personnel qui font peur, avec une façon extrêmement dérangeante de mélanger ce qui relève du personnel et ce qui relève de la sphère privée. La liberté de pensée ne tient qu’à un cheveu, et Big Brother n’a pas l’air bien loin.
Pour être tout à fait honnête, il me faut préciser que le maire d’Hénin-Beaumont, Steeve Briois, a attaqué Marine Tondelier en diffamation suite à la publication de ce livre. D’après les informations sur Wikipédia, le tribunal a jugé les propos diffamatoires mais a relaxé l’autrice et son éditeur « au bénéfice de la bonne foi », un verdict un peu étrange, je ne savais pas qu’on avait le droit de commettre une infraction et d’échapper à une sanction au nom de la bonne foi, nul n’est censé ignorer la loi, non ?…
Enfin, pour conclure, j’ai lu ce livre après le soulagement (hélas temporaire à mon avis) du deuxième tour. Mais vraiment, même s’il n’y a que la moitié de vrai dans ce livre, on se prépare des moments de régression sociale et vraiment, vraiment, ça ne donne pas envie.
Titre en anglais : non traduit


En réalité, ce que le Front national ne supporte pas, c’est l’altérité. Ce qui ne leur obéit pas, ce qu’ils ne maîtrisent pas. Soit vous êtes avec eux, soit vous êtes contre eux. Revoilà leur éternel scénario complotiste et manichéen.
(p. 117, Chapitre 10).
Les éditions du Lien qui Libèrent ont eu la bonne idée, après le traumatisme des résultats du premier tour des élections législatives, de mettre en accès libre ce livre, bien qu’il date un peu (2017, autant dire le moyen-âge dans notre société où l’actualité a une durée de vie d’à peine plus d’une demi-minute) et bien qu’il ne soit pas transposable (les compétences au niveau d’une commune ne sont pas celles de l’État ; les échelles ne sont pas les mêmes, les contre-pouvoirs non plus). Lorsque ce livre est paru, Marine Tondelier n’était pas encore le personnage médiatique qu’elle est devenue, elle est une jeune conseillère municipale d’à peine 30 ans, faisant ses armes dans la ville d’Hénin-Beaumont, devenue célèbre nationalement pour être le premier fief nordique du Front National.
Bien sûr c’est un livre, qui comme d’habitude, ne convaincra que ceux qui sont déjà convaincus, voire que ne liront que ceux qui sont déjà convaincus (mais n’est-ce pas plus ou moins le lot de tous les livres politiques?).
Ce qu’elle raconte n’est pas bien joli. Et ce sont notamment les techniques de gestion du personnel qui font peur, avec une façon extrêmement dérangeante de mélanger ce qui relève du personnel et ce qui relève de la sphère privée. La liberté de pensée ne tient qu’à un cheveu, et Big Brother n’a pas l’air bien loin.
Pour être tout à fait honnête, il me faut préciser que le maire d’Hénin-Beaumont, Steeve Briois, a attaqué Marine Tondelier en diffamation suite à la publication de ce livre. D’après les informations sur Wikipédia, le tribunal a jugé les propos diffamatoires mais a relaxé l’autrice et son éditeur « au bénéfice de la bonne foi », un verdict un peu étrange, je ne savais pas qu’on avait le droit de commettre une infraction et d’échapper à une sanction au nom de la bonne foi, nul n’est censé ignorer la loi, non ?…
Enfin, pour conclure, j’ai lu ce livre après le soulagement (hélas temporaire à mon avis) du deuxième tour. Mais vraiment, même s’il n’y a que la moitié de vrai dans ce livre, on se prépare des moments de régression sociale et vraiment, vraiment, ça ne donne pas envie.
25raton-liseur
60. 44. (1e) Les Cloches de Nagasaki de Takashi Nagai, traduit de la version anglaise par Prune de Mentque et révisé à partir de la version japonaise par Mashuko Osuki-Demenois
Titre original : The Bells of Nagasaki


Difficile d’écrire une note de lecture sur ce livre, ou en fait non, pas si difficile, il faut juste séparer la valeur historique et la valeur littéraire du texte. Autant le dire tout de suite, la valeur littéraire ne m’a pas convaincue : le texte est froid (mais j’y reviendrai), d’un style plat, parfois redondant, parfois imprécis. Mais Takashi Nagai n’est pas littérateur. Il est médecin radiologue et le reste pendant tout ce livre. Il est aussi un des piliers de la communauté chrétienne d’Urakami, le quartier chrétien de Nagasaki, épicentre de l’explosion de la seconde bombe atomique larguée sur le Japon. Et c’est de ce point de vue qu’il écrit ce livre : comme un témoin (j’allais écrire une victime, mais ce serait inexact, ce n’est pas ainsi qu’il se présente) direct de l’explosion, et comme un acteur aussi puisqu’il participe activement aux secours.
Une fois affranchi de la question littéraire, le témoignage est vraiment intéressant. D’abord la description de l’explosion et de la façon dont elle est physiquement ressentie au plus près de l’épicentre. Ensuite, la façon dont les secours s’organisent et les sentiments qui sont mis en avant. Il est intéressant de voir que ce témoignage s’intéresse plus à la façon dont est vécue la capitulation du Japon qu’aux conséquences personnelles de l’explosion (on apprend ainsi au détour d’une phrase que la femme de Nagai est morte dans l’explosion, mais à aucun moment il ne décrit la façon dont il le découvre ou la façon dont cela l’affecte). En cela, ce livre est aussi un témoignage de l’état d’esprit de l’époque et il y a me semble-t-il quelque chose d’irréductiblement japonais dans cette pudeur un peu froide et cette façon de faire passer le collectif avant toute considération personnelle.
En découvrant ce livre un peu par hasard, je me suis étonnée qu’un tel témoignage soit si peu connu. En le lisant, je crois que je comprends mieux cet apparent oubli, car le texte, s’il est certain qu’il est intéressant à lire, peut paraître difficile d’accès du fait de la différence culturelle qu’il peut y avoir entre l’auteur et un lecteur occidental. Pour ma part, c’est une lecture que j’ai trouvée intéressante et instructive et que je serais prête à recommander, malgré les quelques réserves que j’ai pu exprimer.
Titre original : The Bells of Nagasaki


Difficile d’écrire une note de lecture sur ce livre, ou en fait non, pas si difficile, il faut juste séparer la valeur historique et la valeur littéraire du texte. Autant le dire tout de suite, la valeur littéraire ne m’a pas convaincue : le texte est froid (mais j’y reviendrai), d’un style plat, parfois redondant, parfois imprécis. Mais Takashi Nagai n’est pas littérateur. Il est médecin radiologue et le reste pendant tout ce livre. Il est aussi un des piliers de la communauté chrétienne d’Urakami, le quartier chrétien de Nagasaki, épicentre de l’explosion de la seconde bombe atomique larguée sur le Japon. Et c’est de ce point de vue qu’il écrit ce livre : comme un témoin (j’allais écrire une victime, mais ce serait inexact, ce n’est pas ainsi qu’il se présente) direct de l’explosion, et comme un acteur aussi puisqu’il participe activement aux secours.
Une fois affranchi de la question littéraire, le témoignage est vraiment intéressant. D’abord la description de l’explosion et de la façon dont elle est physiquement ressentie au plus près de l’épicentre. Ensuite, la façon dont les secours s’organisent et les sentiments qui sont mis en avant. Il est intéressant de voir que ce témoignage s’intéresse plus à la façon dont est vécue la capitulation du Japon qu’aux conséquences personnelles de l’explosion (on apprend ainsi au détour d’une phrase que la femme de Nagai est morte dans l’explosion, mais à aucun moment il ne décrit la façon dont il le découvre ou la façon dont cela l’affecte). En cela, ce livre est aussi un témoignage de l’état d’esprit de l’époque et il y a me semble-t-il quelque chose d’irréductiblement japonais dans cette pudeur un peu froide et cette façon de faire passer le collectif avant toute considération personnelle.
En découvrant ce livre un peu par hasard, je me suis étonnée qu’un tel témoignage soit si peu connu. En le lisant, je crois que je comprends mieux cet apparent oubli, car le texte, s’il est certain qu’il est intéressant à lire, peut paraître difficile d’accès du fait de la différence culturelle qu’il peut y avoir entre l’auteur et un lecteur occidental. Pour ma part, c’est une lecture que j’ai trouvée intéressante et instructive et que je serais prête à recommander, malgré les quelques réserves que j’ai pu exprimer.
26raton-liseur
61. 45. (-) Veilleuse du Calvaire de Lyonel Trouillot
Titre en anglais : non traduit


Lyonel Trouillot est bien sûr un grand nom de la littérature haïtienne et de la littérature francophone en général, mais je n’avais jamais eu l’occasion de le lire. Alors quand la bibliothécaire a mis ce titre en évidence sur un présentoir, j’ai eu l’impression que c’était à moi qu’elle s’adressait, et je n’ai pas pu résister. Un titre au hasard dans la bibliographie d’un auteur, c’est toujours un peu dangereux, encore plus quand cette bibliographie est aussi abondante que celle de Lyonel Trouillot, mais cette fois je suis bien tombée !
Veilleuse du Calvaire n’est pas un livre dans lequel il est facile de rentrer. Il commence avec une certaine hargne, comme on en trouve chez de nombreux écrivains des ex-colonies (je pense à notamment à deux auteurs congolais, Alain Mabanckou et Fiston Mwanza Mujila). Elle est cependant moins violente ici (ce qui me convient, j’ai un peu de mal avec la littérature violente, crue, coup de poing des auteurs que je viens de citer et d’autres qui creusent des sillons similaires), et puis surtout cette violence sert le propos sans le desservir et elle n’est pas la seule arme de l’écrivain.
Mais après cette remarque liminaire il est temps de parler du livre. Un livre tout entier situé dans un quartier (fictif mais proche de la réalité) de la capitale d’Haïti, la colline du Calvaire. Mais si le lieu est circonscrit, le temps l’est moins puisqu’on balaye probablement une petite centaine d’années de l’histoire de ce quartier, depuis sa création jusqu’à sa décrépitude actuelle. Et c’est à la fois la vie de ce quartier qui est racontée et toutes les turpitudes de l’histoire récente du pays, sans en omettre les périodes les plus sombres. L’histoire n’étant pas linéaire, encore une fois, le livre ne se donne pas d’emblée et il faut s’accrocher pour suivre les sauts dans le temps et comprendre les allusions (une petite connaissance de l’histoire d’Haïti n’est pas superflue, même si je dois bien dire que mes connaissances à moi sont bien minces).
Et après ce récit qui prend toute la première partie du livre (première partie sur trois, mais de loin la plus longue, presque deux tiers du livre), viens le temps de la littérature, le récit prend une toute autre dimension, totalement imprévue et qui moi m’a emportée et conquise. L’auteur se met à jouer avec le lecteur d’une façon que rien jusqu’alors ne laissait prévoir et donne à ce roman un souffle nouveau qui m’a soulevée depuis le bord de la page où je me tenais.
Je crois que cela faisait longtemps que je n’avais pas été ainsi surprise par un livre, et je me suis laissée prendre avec plaisir. Le livre est dur et n’épargne pas son lecteur, mais c’est aussi un petit bijou littéraire, qui fait de sa lecture un vrai plaisir. Une lecture que je ne peux, donc, que recommander chaudement à tous les lecteurs qui aiment la littérature étrangère, celle-ci est un merveilleux exemple de littérature francophone.
Titre en anglais : non traduit


La sagesse du peureux consiste à faire l’éloge de la continuité. Je n’ai jamais été très sage. Il n’y a d’avenir dans la persistance du pire. Et je veux, pour qui souffre, le don de la rupture, pas celui de l’accommodement.
(p. 11, “Liminaire”, Partie 1, “Veilleuse”).
Creuse. Prends le pouls de la terre. Tu entendras le murmure de corps qui ne furent jamais photographiés et n’eurent jamais droit à rien. Ni dans leur vie ni dans leur mort. Pas même au souvenir.
(p. 41, “De quoi l’avenir fut fait”, Partie 1, “Veilleuse”).
Lyonel Trouillot est bien sûr un grand nom de la littérature haïtienne et de la littérature francophone en général, mais je n’avais jamais eu l’occasion de le lire. Alors quand la bibliothécaire a mis ce titre en évidence sur un présentoir, j’ai eu l’impression que c’était à moi qu’elle s’adressait, et je n’ai pas pu résister. Un titre au hasard dans la bibliographie d’un auteur, c’est toujours un peu dangereux, encore plus quand cette bibliographie est aussi abondante que celle de Lyonel Trouillot, mais cette fois je suis bien tombée !
Veilleuse du Calvaire n’est pas un livre dans lequel il est facile de rentrer. Il commence avec une certaine hargne, comme on en trouve chez de nombreux écrivains des ex-colonies (je pense à notamment à deux auteurs congolais, Alain Mabanckou et Fiston Mwanza Mujila). Elle est cependant moins violente ici (ce qui me convient, j’ai un peu de mal avec la littérature violente, crue, coup de poing des auteurs que je viens de citer et d’autres qui creusent des sillons similaires), et puis surtout cette violence sert le propos sans le desservir et elle n’est pas la seule arme de l’écrivain.
Mais après cette remarque liminaire il est temps de parler du livre. Un livre tout entier situé dans un quartier (fictif mais proche de la réalité) de la capitale d’Haïti, la colline du Calvaire. Mais si le lieu est circonscrit, le temps l’est moins puisqu’on balaye probablement une petite centaine d’années de l’histoire de ce quartier, depuis sa création jusqu’à sa décrépitude actuelle. Et c’est à la fois la vie de ce quartier qui est racontée et toutes les turpitudes de l’histoire récente du pays, sans en omettre les périodes les plus sombres. L’histoire n’étant pas linéaire, encore une fois, le livre ne se donne pas d’emblée et il faut s’accrocher pour suivre les sauts dans le temps et comprendre les allusions (une petite connaissance de l’histoire d’Haïti n’est pas superflue, même si je dois bien dire que mes connaissances à moi sont bien minces).
Et après ce récit qui prend toute la première partie du livre (première partie sur trois, mais de loin la plus longue, presque deux tiers du livre), viens le temps de la littérature, le récit prend une toute autre dimension, totalement imprévue et qui moi m’a emportée et conquise. L’auteur se met à jouer avec le lecteur d’une façon que rien jusqu’alors ne laissait prévoir et donne à ce roman un souffle nouveau qui m’a soulevée depuis le bord de la page où je me tenais.
Je crois que cela faisait longtemps que je n’avais pas été ainsi surprise par un livre, et je me suis laissée prendre avec plaisir. Le livre est dur et n’épargne pas son lecteur, mais c’est aussi un petit bijou littéraire, qui fait de sa lecture un vrai plaisir. Une lecture que je ne peux, donc, que recommander chaudement à tous les lecteurs qui aiment la littérature étrangère, celle-ci est un merveilleux exemple de littérature francophone.
27Dilara86
>24 raton-liseur: I didn't know about this! Thanks: I've just downloaded it :-)
The political situation in France is beyond ridiculous at the moment. And those 3 weeks between the dissolution and the elections were some of the most stressful in my life.
>25 raton-liseur: >26 raton-liseur: also interesting!
The political situation in France is beyond ridiculous at the moment. And those 3 weeks between the dissolution and the elections were some of the most stressful in my life.
>25 raton-liseur: >26 raton-liseur: also interesting!
28raton-liseur
>27 Dilara86: Great to know Nouvelles du Front is still available for free! it is not a great piece of literature, but it's an interesting (and depressing?) read.
I won’t start talking about the political situation here, it is just ubuesque. I felt so relieved on July the 7th. But then, I know it is only a matter of time…
But now it’s the Olympic Games, so who cares? Panem et circenses as someone said a long time ago. Nothing new under the sun… Sigh...
Veilleuse du Calvaire might be just right up your alley. It won’t cheer you up, but it’s a great read.
I won’t start talking about the political situation here, it is just ubuesque. I felt so relieved on July the 7th. But then, I know it is only a matter of time…
But now it’s the Olympic Games, so who cares? Panem et circenses as someone said a long time ago. Nothing new under the sun… Sigh...
Veilleuse du Calvaire might be just right up your alley. It won’t cheer you up, but it’s a great read.
29labfs39
>25 raton-liseur: I'm adding The Bells of Nagasaki to my wishlist. I read a similar witness account, Hiroshima Diary: The Journal of a Japanese Physician, August 6-September 30, 1945 by Michihiko Hachiya. It sounds like it may have been better written from a literary pov, but I'm interested in reading the Bells to compare the experiences.
30raton-liseur
>29 labfs39: I'll keep my eyes open for Hiroshima Diary. The Bells of Nagasaki was fine but left me willing for more. I'll be interested on your take on the Takashi Nagai if you read it.
31raton-liseur
62. 46. (33) Cérès et Vesta de Greg Egan, traduit de l'anglais (Australie) par Erwann Perchoc
Titre original : The Four Thousand, The Eight Hundred


M’sieur Raton, grand fan de Greg Egan, était enthousiaste à la lecture de ce court roman, alors je le lui ai piqué avant qu’il ne le remette sur les étagères… Je suis probablement moins enthousiaste que lui, mais ce livre me laisse pleine d’interrogations. Difficile de savoir ce que Greg Egan a voulu dire : il est question d’injustice liée à une forme de racisme (ou plutôt d’ostracisme puisque la couleur de peau n’est pas le problème), il est question de chemins migratoires clandestins et dangereux, et puis bien sûr on est dans un monde futuriste (colonisation d’astéroïde, surveillance de la population grâce à des technologies de pointe, gadgets anti-apesanteur et robots super-efficaces à tous les coins de rue…). Mais il me semble, même si les sujets sociétaux abordés sont importants pour Greg Egan qui les a déjà évoqués ailleurs, tout cela ne soit qu’un habillage (fort élaboré certes) pour aborder la question de la valeur morale de nos actes et de nos décisions. Qu’il s’agisse d’Olivier et Camille sur Vesta ou d’Anna sur Cérès, la question est de savoir ce qu’il est juste de faire pour défendre une cause ou pour défendre des principes. Comment le savoir au moment de choisir de passer à l’acte, comment le savoir quand les conséquences de cet acte, celles attendues et peut-être encore plus celles inattendues, sont connues ?
Le titre en anglais, littéralement « Les 4 000, les 800 » (que l’on ne comprend que dans les dernières pages), suggère que le véritable sujet du roman est bien celui-là : nos choix, nos actes, leurs conséquences. Les conséquences visibles, que l’on peut compter (oui, 4 000 est plus grand que 800) et les conséquences invisibles, que l’on ne peut toucher du doigt (que signifierait renier ses principes, comme individu ou comme nation, sur ce que l’on est, sur sa propre identité). Et le livre est suffisamment intelligent pour ne pas donner de réponse (j’ai beaucoup aimé le dialogue final de deux des personnages principaux), au lecteur de ruminer cette histoire et d’essayer de comprendre ce qu’elle lui dit et ce qu’il veut en comprendre.
Et moi qui disait que je n’étais pas enthousiaste ?… Je crois plutôt que ce roman est comme le bon, il se bonifie avec le temps qui passe après qu’on l’ait refermé.
Titre original : The Four Thousand, The Eight Hundred


Qui se soucie de justice quand les serveurs de jeu ne peuvent plus tourner ?
(p. 77, Chapitre 11).
M’sieur Raton, grand fan de Greg Egan, était enthousiaste à la lecture de ce court roman, alors je le lui ai piqué avant qu’il ne le remette sur les étagères… Je suis probablement moins enthousiaste que lui, mais ce livre me laisse pleine d’interrogations. Difficile de savoir ce que Greg Egan a voulu dire : il est question d’injustice liée à une forme de racisme (ou plutôt d’ostracisme puisque la couleur de peau n’est pas le problème), il est question de chemins migratoires clandestins et dangereux, et puis bien sûr on est dans un monde futuriste (colonisation d’astéroïde, surveillance de la population grâce à des technologies de pointe, gadgets anti-apesanteur et robots super-efficaces à tous les coins de rue…). Mais il me semble, même si les sujets sociétaux abordés sont importants pour Greg Egan qui les a déjà évoqués ailleurs, tout cela ne soit qu’un habillage (fort élaboré certes) pour aborder la question de la valeur morale de nos actes et de nos décisions. Qu’il s’agisse d’Olivier et Camille sur Vesta ou d’Anna sur Cérès, la question est de savoir ce qu’il est juste de faire pour défendre une cause ou pour défendre des principes. Comment le savoir au moment de choisir de passer à l’acte, comment le savoir quand les conséquences de cet acte, celles attendues et peut-être encore plus celles inattendues, sont connues ?
Le titre en anglais, littéralement « Les 4 000, les 800 » (que l’on ne comprend que dans les dernières pages), suggère que le véritable sujet du roman est bien celui-là : nos choix, nos actes, leurs conséquences. Les conséquences visibles, que l’on peut compter (oui, 4 000 est plus grand que 800) et les conséquences invisibles, que l’on ne peut toucher du doigt (que signifierait renier ses principes, comme individu ou comme nation, sur ce que l’on est, sur sa propre identité). Et le livre est suffisamment intelligent pour ne pas donner de réponse (j’ai beaucoup aimé le dialogue final de deux des personnages principaux), au lecteur de ruminer cette histoire et d’essayer de comprendre ce qu’elle lui dit et ce qu’il veut en comprendre.
Et moi qui disait que je n’étais pas enthousiaste ?… Je crois plutôt que ce roman est comme le bon, il se bonifie avec le temps qui passe après qu’on l’ait refermé.
32raton-liseur
63. 47. (34) Les Gais Lurons de Robert Louis Stevenson, traduit de l'anglais par Théo Varlet
Titre original : The Merry Men


Une longue nouvelle ou un très court roman écrit en 1881 et publié l’année suivante, par un Stevenson qui n’a pas encore écrit les grands romans que l’on associe en général à son nom. Pourtant, tous les ingrédients sont là, et j’ai pris beaucoup de plaisir à lire ce petit opuscule, d’autant que je crois que j’apprécie plus Stevenson dans ses formes courtes que dans ses œuvres plus longues.
Si l’on me demandait qui est le personnage principal des Gais Lurons, je répondrais très certainement que c’est la mer. Les Gais Lurons, titre énigmatique au départ (et très élégante traduction du titre original, The Merry Men), n’est d’ailleurs ni plus ni moins que le nom d’un traître courant qui sévit dans les parages de l’île d’Aros, où se déroule la tragédie. La mer, qui joue sans se préoccuper des hommes qui la parcourent ou qui l’observe, la mer qui n’a que faire de la peur de Dieu ou de celle du diable, la mer qui fait fi de la cupidité, de la convoitise, du meurtre, de la folie…
Il y a dans la postface, une citation de Stevenson expliquant à un ami ce qu’il avait tenté de faire dans cette nouvelle : « Il y a, pour autant que je sache, trois manières, et trois manières seulement, d'écrire une histoire. Vous pouvez choisir une intrigue et y adapter des personnages. Vous pouvez choisir un personnage et imaginer des événements et des situations pour le développer, le faire évoluer. Ou bien (…) vous prenez une certaine atmosphère et choisissez l’action et les personnages en fonction d’elle, pour la rendre sensible. Je vais vous donner un exemple – Les Gais Lurons. Là, je suis parti avec l’impression laissée sur moi par une de ces îles de la côte ouest de l'Écosse et j'ai développé l’action pour l’exprimer le plus fortement possible. ».
C’est tout à fait ça, et Stevenson le dit mille fois mieux que moi. Une très bonne lecture pour voyager en cet été de ciels lourds et gris.
Titre original : The Merry Men


Une longue nouvelle ou un très court roman écrit en 1881 et publié l’année suivante, par un Stevenson qui n’a pas encore écrit les grands romans que l’on associe en général à son nom. Pourtant, tous les ingrédients sont là, et j’ai pris beaucoup de plaisir à lire ce petit opuscule, d’autant que je crois que j’apprécie plus Stevenson dans ses formes courtes que dans ses œuvres plus longues.
Si l’on me demandait qui est le personnage principal des Gais Lurons, je répondrais très certainement que c’est la mer. Les Gais Lurons, titre énigmatique au départ (et très élégante traduction du titre original, The Merry Men), n’est d’ailleurs ni plus ni moins que le nom d’un traître courant qui sévit dans les parages de l’île d’Aros, où se déroule la tragédie. La mer, qui joue sans se préoccuper des hommes qui la parcourent ou qui l’observe, la mer qui n’a que faire de la peur de Dieu ou de celle du diable, la mer qui fait fi de la cupidité, de la convoitise, du meurtre, de la folie…
Il y a dans la postface, une citation de Stevenson expliquant à un ami ce qu’il avait tenté de faire dans cette nouvelle : « Il y a, pour autant que je sache, trois manières, et trois manières seulement, d'écrire une histoire. Vous pouvez choisir une intrigue et y adapter des personnages. Vous pouvez choisir un personnage et imaginer des événements et des situations pour le développer, le faire évoluer. Ou bien (…) vous prenez une certaine atmosphère et choisissez l’action et les personnages en fonction d’elle, pour la rendre sensible. Je vais vous donner un exemple – Les Gais Lurons. Là, je suis parti avec l’impression laissée sur moi par une de ces îles de la côte ouest de l'Écosse et j'ai développé l’action pour l’exprimer le plus fortement possible. ».
C’est tout à fait ça, et Stevenson le dit mille fois mieux que moi. Une très bonne lecture pour voyager en cet été de ciels lourds et gris.
33raton-liseur
64. 48. (-) Chiennes de garde de Dahlia de la Cerda, traduit de l'espagnol (Mexique) par Lise Belperron
Titre original : Perras de reserva
Titre en anglais : Reservoir Bitches


Chiennes de nouvelles ! J’ai découvert ce livre il y a quelques jours sur la table de ma libraire pointue et intello et j’ai tout de suite su qu’il fallait que je le lise, avec cette photo pleine de provocation et de contradictions sur la première de couverture et cette citation pleine de colère sur la quatrième de couverture.
Et les treize nouvelles qui composent ce livre (ce ne peut être un nombre choisi au hasard…) sont à la hauteur de ce qui est promis. Provocation et colère, mais aussi beaucoup d’ironie et d’humour noir. Dahlia de la Cerda nous balade d’un extrême à l’autre de l’échelle sociale qui, au Mexique, est particulièrement longue. Et que l’on soit dans la pauvreté la plus extrême ou dans la richesse la plus indécente, c’est la même violence, la même hargne qui s’exprime, même si les enjeux de survie sont très différents.
A chaque fois, c’est la voix d’une femme, qui se raconte à la première personne, sans que l’on sache bien à qui elle s’adresse. Mais cela crée une proximité immédiate à laquelle il est impossible de se soustraire. La plupart de ces femmes sont jeunes, souvent pleines de projets et de désirs, mais toujours rattrapées par la réalité, que ce soit la violence, le patriarcat, la pauvreté, les mirages de la migration. Pour donner une idée, la première nouvelles, Persil et Coca-Cola est le récit factuel et sans filtre d’un avortement solitaire (eh oui, le persil et le coca-cola semblent des méthodes d’avortement artisanales si on cherche sur le web…) et la dernière nouvelle, La Huesera, raconte le deuil d’une adolescente qui a perdu sa meilleure amie suite à un féminicide. Et toutes les nouvelles sont à peu près aussi légères que ça…
Ces femmes sont toutes des battantes, même si la plupart du temps elles perdent, mais souvent, même dans la mort elles ne s’avouent pas vaincues. Et cela donne un texte d’une grande vitalité, irrigué de musiques et dans lesquelles j’ai retrouvé à chaque page le Mexique que j’ai pu effleurer lorsque j’y ai vécu.
J’ai acheté ce livre pour l’offrir à M’ni Raton. Il est peut-être un peu dur pour l’adolescente qu’elle est, mais les questions de genre sont sa grande préoccupation depuis quelques temps déjà, et le Mexique, elle connaît aussi, alors je me dis que c’est un livre qui pourrait lui plaire, même si elle a un peu laissé tomber la lecture en ce moment. En tout cas, pour moi, cela a été une découverte fortuite, mais une lecture très forte et des portraits de femmes qui me resteront en tête un bon moment. Une autrice dont c’est le premier livre publié en France, mais à suivre, absolument.
Titre original : Perras de reserva
Titre en anglais : Reservoir Bitches


N’importe quoi, je suis plus mexicaine que les nopales
(p. 158, “Le sourire”).
Le Mexique est un énorme monstre qui dévore les femmes. Le Mexique est un désert fait de poudre d’os. Le Mexique est un cimetière de croix roses. Le Mexique est un pays qui déteste les femmes.
(p. 220-221, “La Huesera”).
Chiennes de nouvelles ! J’ai découvert ce livre il y a quelques jours sur la table de ma libraire pointue et intello et j’ai tout de suite su qu’il fallait que je le lise, avec cette photo pleine de provocation et de contradictions sur la première de couverture et cette citation pleine de colère sur la quatrième de couverture.
Et les treize nouvelles qui composent ce livre (ce ne peut être un nombre choisi au hasard…) sont à la hauteur de ce qui est promis. Provocation et colère, mais aussi beaucoup d’ironie et d’humour noir. Dahlia de la Cerda nous balade d’un extrême à l’autre de l’échelle sociale qui, au Mexique, est particulièrement longue. Et que l’on soit dans la pauvreté la plus extrême ou dans la richesse la plus indécente, c’est la même violence, la même hargne qui s’exprime, même si les enjeux de survie sont très différents.
A chaque fois, c’est la voix d’une femme, qui se raconte à la première personne, sans que l’on sache bien à qui elle s’adresse. Mais cela crée une proximité immédiate à laquelle il est impossible de se soustraire. La plupart de ces femmes sont jeunes, souvent pleines de projets et de désirs, mais toujours rattrapées par la réalité, que ce soit la violence, le patriarcat, la pauvreté, les mirages de la migration. Pour donner une idée, la première nouvelles, Persil et Coca-Cola est le récit factuel et sans filtre d’un avortement solitaire (eh oui, le persil et le coca-cola semblent des méthodes d’avortement artisanales si on cherche sur le web…) et la dernière nouvelle, La Huesera, raconte le deuil d’une adolescente qui a perdu sa meilleure amie suite à un féminicide. Et toutes les nouvelles sont à peu près aussi légères que ça…
Ces femmes sont toutes des battantes, même si la plupart du temps elles perdent, mais souvent, même dans la mort elles ne s’avouent pas vaincues. Et cela donne un texte d’une grande vitalité, irrigué de musiques et dans lesquelles j’ai retrouvé à chaque page le Mexique que j’ai pu effleurer lorsque j’y ai vécu.
J’ai acheté ce livre pour l’offrir à M’ni Raton. Il est peut-être un peu dur pour l’adolescente qu’elle est, mais les questions de genre sont sa grande préoccupation depuis quelques temps déjà, et le Mexique, elle connaît aussi, alors je me dis que c’est un livre qui pourrait lui plaire, même si elle a un peu laissé tomber la lecture en ce moment. En tout cas, pour moi, cela a été une découverte fortuite, mais une lecture très forte et des portraits de femmes qui me resteront en tête un bon moment. Une autrice dont c’est le premier livre publié en France, mais à suivre, absolument.
34Dilara86
>33 raton-liseur: Another one for my wishlist!
35raton-liseur
>34 Dilara86: Oh yes, do read it! It's really worth it!
36raton-liseur
I have read very little graphic stories since the beginning of 2024 (at least compared to the past couple of years). But I don't know why, at the end of July, I had a frenzy of graphic reading. The first ones were not that great, but it got better and better, the last one being the best (The Talk by Darrin Bell, but I have not written my review yet).
65. 7g. (-) Idiss de Richard Malka (scénario) et Fred Bernard (dessin), d'après le livre éponyme de Robert Badinter
Titre en anglais : non traduit

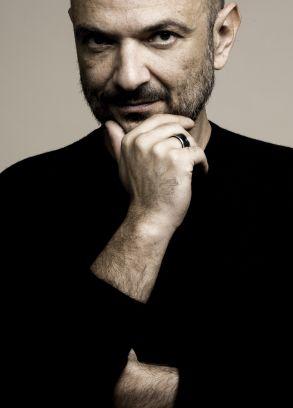


Je tourne autour de cette bd depuis un moment, et j’ai enfin pris le temps de la lire, car il va être temps de la rendre à la bibliothèque. C’est je crois la couverture qui m’a donné envie de la lire, avec son dessin un tantinet naïf et aux couleurs pleines d’harmonie. L’histoire est linéaire et suit la vie d’Idiss, née à la fin du XIXème siècle en Ukraine et qui aura côtoyé toute sa vie à travers l’Europe les différentes exactions dont les juifs ont pu être victimes. Mais ce n’est pas une bd misérabiliste pour autant. Idiss a eu une vie simple et bien remplie, avec ses épreuves et ses joies.
Cette bande dessinée a eu du mal à m’accrocher parce que j’ai trouvé qu’elle ne faisait qu’effleurer son sujet, que ce soit les recoins les plus sombres du siècle passé ou la façon dont Idiss les a affrontés. J’imagine que c’est par pudeur et par respect de cette grand-mère bien aimée que l’auteur initial, Robert Badinter, a adopté ce parti-pris, mais pour moi il nuit au propos et rend la bd hélas bien peu mémorable.
65. 7g. (-) Idiss de Richard Malka (scénario) et Fred Bernard (dessin), d'après le livre éponyme de Robert Badinter
Titre en anglais : non traduit

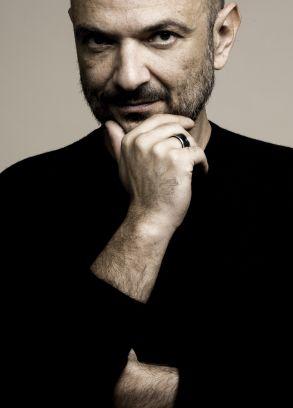


Je tourne autour de cette bd depuis un moment, et j’ai enfin pris le temps de la lire, car il va être temps de la rendre à la bibliothèque. C’est je crois la couverture qui m’a donné envie de la lire, avec son dessin un tantinet naïf et aux couleurs pleines d’harmonie. L’histoire est linéaire et suit la vie d’Idiss, née à la fin du XIXème siècle en Ukraine et qui aura côtoyé toute sa vie à travers l’Europe les différentes exactions dont les juifs ont pu être victimes. Mais ce n’est pas une bd misérabiliste pour autant. Idiss a eu une vie simple et bien remplie, avec ses épreuves et ses joies.
Cette bande dessinée a eu du mal à m’accrocher parce que j’ai trouvé qu’elle ne faisait qu’effleurer son sujet, que ce soit les recoins les plus sombres du siècle passé ou la façon dont Idiss les a affrontés. J’imagine que c’est par pudeur et par respect de cette grand-mère bien aimée que l’auteur initial, Robert Badinter, a adopté ce parti-pris, mais pour moi il nuit au propos et rend la bd hélas bien peu mémorable.
37raton-liseur
66. 8g. (-) Dans la forêt de Lomig, d'après le roman éponyme de Jean Hegland
Titre en anglais : la bande dessinée n'est pas traduite en anglais, mais le roman dont elle est tirée est originellement paru en anglais sous le titre Into The Forest



Relecture de 2024 : Je ne me souvenais pas avoir lu cette bd, mais internet me dit que je l’ai lue en 2020. Effectivement, en la relisant, les différentes péripéties m’ont parue familières. Je semble l’avoir peut-être un peu moins apprécié que ce que suggère ma note de lecture de l’époque, mais elle demeure assez proche de mon ressenti lors de cette relecture. Je la reproduis donc ici :
J’avais entendu parler de ce livre, mais je n’ai pas pris le temps de le lire. Alors quand la bibliothèque de mon village a fait l’acquisition de cette adaptation graphique, j’ai sauté sur l’occasion. L’histoire est ici assez simple, avec ces deux sœurs qui se retrouvent dans un monde post-apocalyptique, mais sans apocalypse. Le monde tel que nous le connaissons a fini de fonctionner, c’est tout, c’est un fait. Les événements s’enchaînent finalement assez rapidement, et l’on n’a pas le temps de s’ennuyer dans ce huis-clos forestier où tout tourne autour de la façon dont ces deux sœurs s’adaptent à leurs nouvelles conditions de vie, avec des moments d’espoir et des moments de découragement.
Simple dans le propos, jamais trop didactique, et très beau dans les dessins. Des dessins au crayon, en noir et blanc, qui laissent toute la place aux expressions des visages et à la beauté des paysages. Un roman finalement optimiste me semble-t-il, et un agréable moment de lecture.
Titre en anglais : la bande dessinée n'est pas traduite en anglais, mais le roman dont elle est tirée est originellement paru en anglais sous le titre Into The Forest



Relecture de 2024 : Je ne me souvenais pas avoir lu cette bd, mais internet me dit que je l’ai lue en 2020. Effectivement, en la relisant, les différentes péripéties m’ont parue familières. Je semble l’avoir peut-être un peu moins apprécié que ce que suggère ma note de lecture de l’époque, mais elle demeure assez proche de mon ressenti lors de cette relecture. Je la reproduis donc ici :
Nos réserves disparaissent à vue d’œil.
C’est comme si nous n’étions qu’un paquet de besoins qui épuisent le monde.
Pas étonnant que l’économie se soit effondrée, s’il nous en faut autant à Eva et moi pour rester tout bonnement en vie. (p. 75).
J’avais entendu parler de ce livre, mais je n’ai pas pris le temps de le lire. Alors quand la bibliothèque de mon village a fait l’acquisition de cette adaptation graphique, j’ai sauté sur l’occasion. L’histoire est ici assez simple, avec ces deux sœurs qui se retrouvent dans un monde post-apocalyptique, mais sans apocalypse. Le monde tel que nous le connaissons a fini de fonctionner, c’est tout, c’est un fait. Les événements s’enchaînent finalement assez rapidement, et l’on n’a pas le temps de s’ennuyer dans ce huis-clos forestier où tout tourne autour de la façon dont ces deux sœurs s’adaptent à leurs nouvelles conditions de vie, avec des moments d’espoir et des moments de découragement.
Simple dans le propos, jamais trop didactique, et très beau dans les dessins. Des dessins au crayon, en noir et blanc, qui laissent toute la place aux expressions des visages et à la beauté des paysages. Un roman finalement optimiste me semble-t-il, et un agréable moment de lecture.
38raton-liseur
67. -. (-) La tempête de Marino Neri, traduit de l'italien par Hélène Dauniol-Remaud
Titre original : non précisé
Titre en anglais : non traduit


Je n’ai compris ni l’intérêt littéraire ni l’intérêt graphique de cette bande dessinée. Pourtant, la tempête, ça claque comme du Shakespeare. Et j’imagine qu’il doit y avoir un lien entre les éléments qui se déchaînent et les passions humaines exacerbées par l’inattendu et le huis clos. Mais j’ai attendu pendant toute ma lecture qu’elle commence enfin, et arrivée à la dernière page, j’ai été contente de ne plus avoir à attendre.
Titre original : non précisé
Titre en anglais : non traduit


Je n’ai compris ni l’intérêt littéraire ni l’intérêt graphique de cette bande dessinée. Pourtant, la tempête, ça claque comme du Shakespeare. Et j’imagine qu’il doit y avoir un lien entre les éléments qui se déchaînent et les passions humaines exacerbées par l’inattendu et le huis clos. Mais j’ai attendu pendant toute ma lecture qu’elle commence enfin, et arrivée à la dernière page, j’ai été contente de ne plus avoir à attendre.
39raton-liseur
68. -. (-) Plein ciel de Pierre-Roland Saint-Dizier (scéanrio) et Michaël Crosa (dessin)
Titre en anglais : non traduit



Une gentille bd, avec une gentille histoire et des gentils dessins. Une belle histoire de voisinage dans une barre d’immeuble, ce n’est pas ce qu’on nous décrit en général dans ces milieux urbains. Avec sa couverture qui fait un peu penser à La Vie mode d’emploi, c’est rafraîchissant et ça fait passer un moment sans prétention mais bien agréable.
Titre en anglais : non traduit



Une gentille bd, avec une gentille histoire et des gentils dessins. Une belle histoire de voisinage dans une barre d’immeuble, ce n’est pas ce qu’on nous décrit en général dans ces milieux urbains. Avec sa couverture qui fait un peu penser à La Vie mode d’emploi, c’est rafraîchissant et ça fait passer un moment sans prétention mais bien agréable.
40raton-liseur
69. 9g. (-) Ce que je sais de Rokia de Quitterie Simon (scéanrio) et Francesca Vartuli (dessin)
Titre en anglais : non traduit

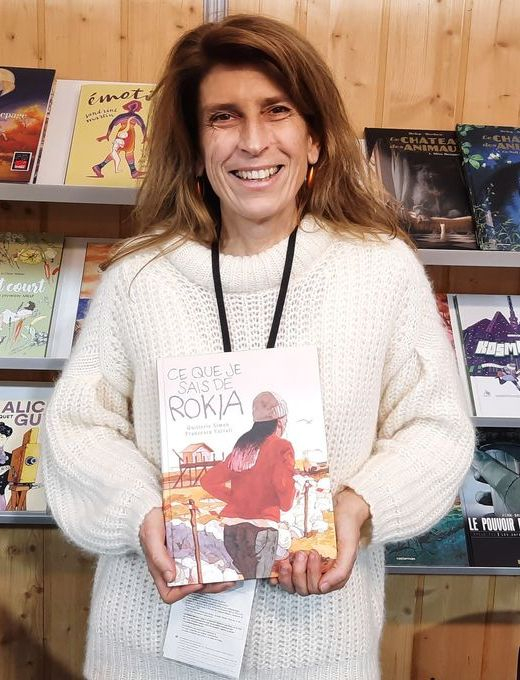

Quelle douceur et quelle délicatesse dans ces dessins à l’aquarelle qui accompagnent à merveille cette histoire. Une histoire elle aussi toutes en nuances, qui dit les hauts et les bas d’une expérience très particulière, celle de loger chez soi un migrant qui attend la régularisation de sa situation. Ou plutôt un migrante puisque Marion et sa famille accueillent Rokia, une joyeuse Libérienne de 19 ans. On pourrait penser que devant tant de générosité, tout céderait, que tous les problèmes s’effaceraient et que toutes les blessures se refermeraient sous l’effet du baume de l’humanisme.
Mais ce n’est pas cela que cette bd veut raconter. Elle cherche plutôt à dire la difficulté de la solidarité en action. Ce n’est pas anodin d’ouvrir sa maison à un ou une inconnue, de partager ainsi son intimité et l’endroit où , en général, on baisse la garde et on n’est plus (ou moins, ou différemment) en représentation sociale, ce n’est pas rien. Et bien sûr, Marion accueille une personne qui a souffert et dont le parcours de vie est difficile à envisager. Alors non, les bons sentiments ne font pas tout, et c’est une relation très complexe qui se noue entre Marion et Rokia. Une relation qu’il me serait difficile de qualifier, mais qui aussi évolue au fil des pages, avec des moments de complicité et d’autres de grand froid, voire d’hostilité sourde, une relation qui n’est pas linéaire, où rien ne semble jamais acquis.
Cette bd est largement inspirée de l’expérience de l’autrice (mieux connue pour ses livres pour enfants) et ne restitue que le point de vue et le ressenti de son alter ego livresque qu’est Marion. Son mari est étrangement absent, sa fille aussi, mais c’est probablement par désir de ne pas parler à leur place. Et Rokia restera pour le lecteur la même énigme qu’elle est pour Marion. Ce livre ne tranche pas, n’a pas de thèse, et c’est bien ainsi.
Une très belle découverte fortuite que ce récit graphique, paru au début de l’année 2024 et qui gagnera à être connu et à être lu.
Titre en anglais : non traduit

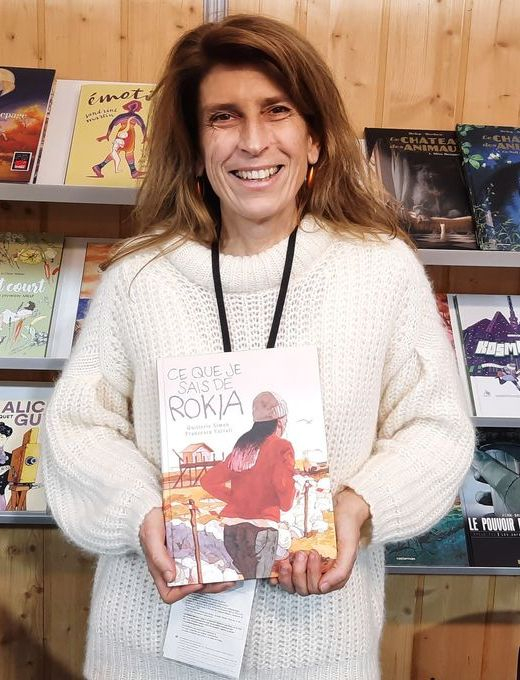

Quelle douceur et quelle délicatesse dans ces dessins à l’aquarelle qui accompagnent à merveille cette histoire. Une histoire elle aussi toutes en nuances, qui dit les hauts et les bas d’une expérience très particulière, celle de loger chez soi un migrant qui attend la régularisation de sa situation. Ou plutôt un migrante puisque Marion et sa famille accueillent Rokia, une joyeuse Libérienne de 19 ans. On pourrait penser que devant tant de générosité, tout céderait, que tous les problèmes s’effaceraient et que toutes les blessures se refermeraient sous l’effet du baume de l’humanisme.
Mais ce n’est pas cela que cette bd veut raconter. Elle cherche plutôt à dire la difficulté de la solidarité en action. Ce n’est pas anodin d’ouvrir sa maison à un ou une inconnue, de partager ainsi son intimité et l’endroit où , en général, on baisse la garde et on n’est plus (ou moins, ou différemment) en représentation sociale, ce n’est pas rien. Et bien sûr, Marion accueille une personne qui a souffert et dont le parcours de vie est difficile à envisager. Alors non, les bons sentiments ne font pas tout, et c’est une relation très complexe qui se noue entre Marion et Rokia. Une relation qu’il me serait difficile de qualifier, mais qui aussi évolue au fil des pages, avec des moments de complicité et d’autres de grand froid, voire d’hostilité sourde, une relation qui n’est pas linéaire, où rien ne semble jamais acquis.
Cette bd est largement inspirée de l’expérience de l’autrice (mieux connue pour ses livres pour enfants) et ne restitue que le point de vue et le ressenti de son alter ego livresque qu’est Marion. Son mari est étrangement absent, sa fille aussi, mais c’est probablement par désir de ne pas parler à leur place. Et Rokia restera pour le lecteur la même énigme qu’elle est pour Marion. Ce livre ne tranche pas, n’a pas de thèse, et c’est bien ainsi.
Une très belle découverte fortuite que ce récit graphique, paru au début de l’année 2024 et qui gagnera à être connu et à être lu.
41Dilara86
>39 raton-liseur: et >40 raton-liseur: Tous deux réservés à la bibliothèque !
42raton-liseur
>42 raton-liseur: Chouette, j'espère que ça te plaira. Et aussi qu'il te reste de la place pour réserver la prochaine...
43raton-liseur
The last graphic story in my binge graphic-reading, and probably the best one... This is my last read from July as well, so I am up-to-date on this thread (but not on Part 1...).
70. 10g. (-) The Talk de Darrin Bell, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cécile Hermellin
Titre original : The Talk


C’est moi qui ai demandé à la bibliothèque d’acheter cette bd, alors bien sûr, je l’ai empruntée dès qu’elle a été mise en rayon ! Il se trouve que j’avais entendu parler de ce que certains Afro-américains appellent « The Talk » quelques temps avant à la radio : une conversation que chaque parent noir se doit d’avoir avec son enfant un jour, pour lui expliquer quel comportement il doit adopter face à la police pour ne pas lui donner prise sur lui et risquer la bavure policière. Rien que l’idée qu’une telle étape dans l’éducation d’un enfant soit assez répandue pour avoir un nom est révoltant en soi, et je voulait donc lire cette bd dont le titre faisait directement référence à ce phénomène, dont on commence à se dire que, peut-être, en fait, il ne devrait pas même exister.
Finalement, la bd parle assez peu de cela, puisqu’en quelque sorte, Darrin Bell (qui semble assez connu aux Etats-Unis, comme caricaturiste notamment) se sert de cette fameuse conversation pour borner son discours, le faisant démarrer avec la fameuse conversation qu’il a eue enfant avec sa mère (blanche en l’occurrence, c’est d’ailleurs très intéressant) et le terminant avec celle qu’il se doit d’avoir, quelques décennies plus tard avec son propre fils. Entre ces deux « Talks », il nous décrit son expérience d’être une personne racisée aux Etats-Unis et son cheminement intellectuel par rapport à ce concept même de race.
Darrin Bell n’est pas donneur de leçon, il se peint en recherche, il montre d’autres points de vue que le sien, même s’il les questionne, par exemple celui de son père noir qui semble nier l’existence même de la question raciale problème (alors que sa mère blanche, elle, traque toute forme de racisme ordinaire ou de racisme patenté). Ce que décrit Darrin Bell paraît souvent tellement gros que c’en est difficilement croyable, et pourtant… C’est un livre qui montre qu’il y a encore beaucoup de chemin à faire et, s’il serait tentant de se dire que tout ça c’est aux Etats-Unis, c’est bien loin, il me semble qu’il faut plutôt y voir un miroir qui nous montre nos propres difficultés face à des questions similaires, même si le poids de l’histoire n’est pas le même de part et d’autre de l’Atlantique.
Un mot, avant de finir, sur le dessin, qui a rebuté semble-t-il pas mal de lecteurs et qui à moi aussi a paru bien peu travaillé. En fait, au bout de quelques dizaines de pages, j’ai fini par m’y habituer, et même par y voir un certain intérêt graphique car il y a un vrai jeu entre les personnages qui ne sont pas caractérisés (et qui sont donc en quelque sorte renvoyés uniquement à leur couleur de peau) et ceux qui sont un peu plus individualisés, qui ont une vraie existence en tant que personne. Et puis Darrin Bell a une capacité assez incroyable à donner une expression à ses personnages en trois coups de crayon. L’incrédulité dans le regard de certains enfants noirs quand on commence à leur expliquer qu’un enfant noir ne sera jamais traité comme un enfant blanc est assez saisissante.
Dans tous les cas, la bande dessinée est absolument captivante (je l’ai lue en une soirée et j’ai éteint tard ce soir-là parce que je ne pouvais pas la lâcher), elle pousse à construire et déconstruire notre attitude personnelle et les faits sociétaux et elle méritera une lecture et une relecture.
70. 10g. (-) The Talk de Darrin Bell, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cécile Hermellin
Titre original : The Talk


C’est moi qui ai demandé à la bibliothèque d’acheter cette bd, alors bien sûr, je l’ai empruntée dès qu’elle a été mise en rayon ! Il se trouve que j’avais entendu parler de ce que certains Afro-américains appellent « The Talk » quelques temps avant à la radio : une conversation que chaque parent noir se doit d’avoir avec son enfant un jour, pour lui expliquer quel comportement il doit adopter face à la police pour ne pas lui donner prise sur lui et risquer la bavure policière. Rien que l’idée qu’une telle étape dans l’éducation d’un enfant soit assez répandue pour avoir un nom est révoltant en soi, et je voulait donc lire cette bd dont le titre faisait directement référence à ce phénomène, dont on commence à se dire que, peut-être, en fait, il ne devrait pas même exister.
Finalement, la bd parle assez peu de cela, puisqu’en quelque sorte, Darrin Bell (qui semble assez connu aux Etats-Unis, comme caricaturiste notamment) se sert de cette fameuse conversation pour borner son discours, le faisant démarrer avec la fameuse conversation qu’il a eue enfant avec sa mère (blanche en l’occurrence, c’est d’ailleurs très intéressant) et le terminant avec celle qu’il se doit d’avoir, quelques décennies plus tard avec son propre fils. Entre ces deux « Talks », il nous décrit son expérience d’être une personne racisée aux Etats-Unis et son cheminement intellectuel par rapport à ce concept même de race.
Darrin Bell n’est pas donneur de leçon, il se peint en recherche, il montre d’autres points de vue que le sien, même s’il les questionne, par exemple celui de son père noir qui semble nier l’existence même de la question raciale problème (alors que sa mère blanche, elle, traque toute forme de racisme ordinaire ou de racisme patenté). Ce que décrit Darrin Bell paraît souvent tellement gros que c’en est difficilement croyable, et pourtant… C’est un livre qui montre qu’il y a encore beaucoup de chemin à faire et, s’il serait tentant de se dire que tout ça c’est aux Etats-Unis, c’est bien loin, il me semble qu’il faut plutôt y voir un miroir qui nous montre nos propres difficultés face à des questions similaires, même si le poids de l’histoire n’est pas le même de part et d’autre de l’Atlantique.
Un mot, avant de finir, sur le dessin, qui a rebuté semble-t-il pas mal de lecteurs et qui à moi aussi a paru bien peu travaillé. En fait, au bout de quelques dizaines de pages, j’ai fini par m’y habituer, et même par y voir un certain intérêt graphique car il y a un vrai jeu entre les personnages qui ne sont pas caractérisés (et qui sont donc en quelque sorte renvoyés uniquement à leur couleur de peau) et ceux qui sont un peu plus individualisés, qui ont une vraie existence en tant que personne. Et puis Darrin Bell a une capacité assez incroyable à donner une expression à ses personnages en trois coups de crayon. L’incrédulité dans le regard de certains enfants noirs quand on commence à leur expliquer qu’un enfant noir ne sera jamais traité comme un enfant blanc est assez saisissante.
Dans tous les cas, la bande dessinée est absolument captivante (je l’ai lue en une soirée et j’ai éteint tard ce soir-là parce que je ne pouvais pas la lâcher), elle pousse à construire et déconstruire notre attitude personnelle et les faits sociétaux et elle méritera une lecture et une relecture.
44SassyLassy
>32 raton-liseur: Always happy to see someone else reading RLS. This is not one I have read (as yet), but your review makes me think I should be looking for it.
45Dilara86
>42 raton-liseur: bien vu!
46baswood
>26 raton-liseur: I have read Trouillot's 2016 novel Kannjawou which I enjoyed and so it was good to read a review of a more recent novel.
47raton-liseur
>45 Dilara86: ;) I knew it! (but it was an easy bet!)
>46 baswood: Hi Barry! I should read another Trouillot as I really liked this one (it might be in my top reads of the year...), but I don't know which one. I've read the blurb for Kannjawou, as well as your review, and it sounds interesting. I might try this one, thanks for mentionning this book!
>46 baswood: Hi Barry! I should read another Trouillot as I really liked this one (it might be in my top reads of the year...), but I don't know which one. I've read the blurb for Kannjawou, as well as your review, and it sounds interesting. I might try this one, thanks for mentionning this book!
48Dilara86
My favourite Trouillot out of the 3 I've read is definitely Yanvalou pour Charlie. I remember being moved by it, but don't ask me for specifics - my brain is a sieve! Instead, here's the book's description from the publisher's website:
Jeune avocat d’affaires dévoré d’ambition, Mathurin D. Saint-Fort a voulu oublier ses origines pour se tenir désormais du meilleur côté possible de l’existence. Jusqu’au jour où fait irruption dans sa vie Charlie, un adolescent en cavale après une tentative de braquage, qui vient demander son aide au nom des attachements à leur même village natal. Débusqué, contraint de renouer avec le dehors, avec la douleur du souvenir et la misère d’autrui, l’élégant Mathurin D. Saint-Fort embarque, malgré lui, pour une aventure solidaire qui lui fait re-traverser, en compagnie de Charlie et de quelques autres gamins affolés, les cercles de la pauvreté, de la délinquance, de la révolte ou de la haine envers tout ce que lui-même incarne.
Mathurin, Charlie, Nathanaël, Anne : quatre voix se relaient ici pour dire, chacune à son échelle, le tribut qu’il incombe un jour à chacun de payer au passé, qu’il s’agisse de tirer un trait sur lui afin de contourner l’obstacle, de l’assujettir à une idéologie – ou, plus rarement, et quoi qu’il en coûte, de demeurer fidèle au “yanvalou”, ce salut à la terre ancestrale, en retrouvant les liens qui fondent une communauté.
Voyage initiatique au coeur de la désespérance, Yanvalou pour Charlie est sans aucun doute le roman de l’abandon des hommes par les hommes, et le chant qui réaffi rme la rédemption d’être ensemble – en Haïti comme ailleurs.
Jeune avocat d’affaires dévoré d’ambition, Mathurin D. Saint-Fort a voulu oublier ses origines pour se tenir désormais du meilleur côté possible de l’existence. Jusqu’au jour où fait irruption dans sa vie Charlie, un adolescent en cavale après une tentative de braquage, qui vient demander son aide au nom des attachements à leur même village natal. Débusqué, contraint de renouer avec le dehors, avec la douleur du souvenir et la misère d’autrui, l’élégant Mathurin D. Saint-Fort embarque, malgré lui, pour une aventure solidaire qui lui fait re-traverser, en compagnie de Charlie et de quelques autres gamins affolés, les cercles de la pauvreté, de la délinquance, de la révolte ou de la haine envers tout ce que lui-même incarne.
Mathurin, Charlie, Nathanaël, Anne : quatre voix se relaient ici pour dire, chacune à son échelle, le tribut qu’il incombe un jour à chacun de payer au passé, qu’il s’agisse de tirer un trait sur lui afin de contourner l’obstacle, de l’assujettir à une idéologie – ou, plus rarement, et quoi qu’il en coûte, de demeurer fidèle au “yanvalou”, ce salut à la terre ancestrale, en retrouvant les liens qui fondent une communauté.
Voyage initiatique au coeur de la désespérance, Yanvalou pour Charlie est sans aucun doute le roman de l’abandon des hommes par les hommes, et le chant qui réaffi rme la rédemption d’être ensemble – en Haïti comme ailleurs.
49raton-liseur
>48 Dilara86: Interesting as well. I'll keep the idea for latter, as I've already requested Kannjawou, Barry's recommendation, at the library.
What are the two other books by Lyonel Trouillot that you've read?
What are the two other books by Lyonel Trouillot that you've read?
50FlorenceArt
>43 raton-liseur: Wow, this sounds very interesting !
51raton-liseur
>50 FlorenceArt: Hi Florence! Indeed, a dense and powerful read!
52raton-liseur
A series of three books that were an horrible read. Just to sum up the coming three reviews: don't bother...
71. 49. (35) La Fosse aux vents, tome 1: Ceux de la “Galatée” de Roger Vercel
Titre en anglais : non traduit


Je ne sais plus du tout d’où me vient l’idée de lire cette trilogie de Roger Vercel, mais je l’ai cherchée avec patience chez les bouquinistes avant de la rassembler, toute dans la même édition, et j’ai profité de ces vacances tranquilles à la maison pour ouvrir enfin ces livres des années 50 qui ont bien vieilli et demeurent plutôt fragiles.
Je ne suis pas une inconditionnelle de Roger Vercel, il y a des livres que j’aime et d’autres qui ont trop vieilli ou que tout simplement j’aime moins. Pas de chance, malgré tout le temps que j’ai attendu avant de pouvoir lire ces livres, ils tombent du côté de ceux qui ont vieilli (la description des Canaques fait frémir, et je ne vous parle pas du regard porté sur les femmes…) et que j’aime moins.
Dans Ceux de la “Galatée”, il ne se passe pas grand-chose, c’est « juste » l’histoire d’un bateau et de son équipage, de la descente de l’Atlantique et du difficile passage du cap Horn. Cela pourrait être suffisant pour qui aime les histoires de bateaux (ce qui est mon cas), mais j’ai trouvé l’écriture un peu pesante, une litanie de mots techniques qui ne me dérangent pas d’habitude mais qui, cette fois, m’ont paru être là pour cacher le fait que l’auteur n’avait pas grand-chose à dire.
Puis dans la deuxième partie, on suit un personnage, Rolland, simple gabier que son second pousse pour qu’il devienne officier. Rolland n’est pas un personnage particulièrement aimable et qui n’a pas beaucoup l’air d’évoluer, ce qui donne peu d’intérêt aussi à cette deuxième moitié de livre. Mais bon, j’ai commencé cette trilogie, les deux autres tomes m’attendent, je ne peux que continuer sur ma lancée.
71. 49. (35) La Fosse aux vents, tome 1: Ceux de la “Galatée” de Roger Vercel
Titre en anglais : non traduit

Je ne sais plus du tout d’où me vient l’idée de lire cette trilogie de Roger Vercel, mais je l’ai cherchée avec patience chez les bouquinistes avant de la rassembler, toute dans la même édition, et j’ai profité de ces vacances tranquilles à la maison pour ouvrir enfin ces livres des années 50 qui ont bien vieilli et demeurent plutôt fragiles.
Je ne suis pas une inconditionnelle de Roger Vercel, il y a des livres que j’aime et d’autres qui ont trop vieilli ou que tout simplement j’aime moins. Pas de chance, malgré tout le temps que j’ai attendu avant de pouvoir lire ces livres, ils tombent du côté de ceux qui ont vieilli (la description des Canaques fait frémir, et je ne vous parle pas du regard porté sur les femmes…) et que j’aime moins.
Dans Ceux de la “Galatée”, il ne se passe pas grand-chose, c’est « juste » l’histoire d’un bateau et de son équipage, de la descente de l’Atlantique et du difficile passage du cap Horn. Cela pourrait être suffisant pour qui aime les histoires de bateaux (ce qui est mon cas), mais j’ai trouvé l’écriture un peu pesante, une litanie de mots techniques qui ne me dérangent pas d’habitude mais qui, cette fois, m’ont paru être là pour cacher le fait que l’auteur n’avait pas grand-chose à dire.
Puis dans la deuxième partie, on suit un personnage, Rolland, simple gabier que son second pousse pour qu’il devienne officier. Rolland n’est pas un personnage particulièrement aimable et qui n’a pas beaucoup l’air d’évoluer, ce qui donne peu d’intérêt aussi à cette deuxième moitié de livre. Mais bon, j’ai commencé cette trilogie, les deux autres tomes m’attendent, je ne peux que continuer sur ma lancée.
53raton-liseur
72. 50. (36) La Fosse aux vents, tome 2: La Peau du Diable de Roger Vercel
Titre en anglais : non traduit


Cela fait maintenant quelques années que Rolland est officier. Il se retrouve second sur l’Antonine, alors qu’il espérait être enfin nommé capitaine. Mais son intransigeance vis-à-vis de ses supérieurs et sa difficulté à les respecter n’en fait guère une personne aimée. Mais il s’avère vite que le capitaine de l’Antonine est malade et que le voyage jusqu’en Nouvelle Calédonie ne sera pas une partie de plaisir.
J’ai préféré ce deuxième tome de la série de La Fosse aux vents, où les relations entre les officiers sont plus intéressantes et riches que dans le tome précédent. Certes, c’est Rolland qui est le personnage principal de la série, mais la figure du capitaine Thirard est ce qui retient toute l’attention.
Mais hélas, ce qui se joue autour de ce capitaine malade mais grandi par sa relation aux hommes et à ses responsabilités n’arrive pas à me faire oublier les descriptions particulièrement avilissantes des habitants de Nouvelle Calédonie (autochtones simiesques, bagnards ou libérés nécessairement vils et infréquentables, femmes toutes prostituées ou descendantes de prostituées donc c’est tout comme…). Dommage que la bien pensence des années 50 imprègne autant ce récit car cela met mal à l’aise, et quand on lit après que Vercel aurait commis quelques écrits antisémites pendant la seconde guerre mondiale, eh bien c’est dommage de ne pas s’en étonner.
Titre en anglais : non traduit

Cela fait maintenant quelques années que Rolland est officier. Il se retrouve second sur l’Antonine, alors qu’il espérait être enfin nommé capitaine. Mais son intransigeance vis-à-vis de ses supérieurs et sa difficulté à les respecter n’en fait guère une personne aimée. Mais il s’avère vite que le capitaine de l’Antonine est malade et que le voyage jusqu’en Nouvelle Calédonie ne sera pas une partie de plaisir.
J’ai préféré ce deuxième tome de la série de La Fosse aux vents, où les relations entre les officiers sont plus intéressantes et riches que dans le tome précédent. Certes, c’est Rolland qui est le personnage principal de la série, mais la figure du capitaine Thirard est ce qui retient toute l’attention.
Mais hélas, ce qui se joue autour de ce capitaine malade mais grandi par sa relation aux hommes et à ses responsabilités n’arrive pas à me faire oublier les descriptions particulièrement avilissantes des habitants de Nouvelle Calédonie (autochtones simiesques, bagnards ou libérés nécessairement vils et infréquentables, femmes toutes prostituées ou descendantes de prostituées donc c’est tout comme…). Dommage que la bien pensence des années 50 imprègne autant ce récit car cela met mal à l’aise, et quand on lit après que Vercel aurait commis quelques écrits antisémites pendant la seconde guerre mondiale, eh bien c’est dommage de ne pas s’en étonner.
54raton-liseur
73. 51. (37) La Fosse aux vents, tome 3: Atalante de Roger Vercel
Titre en anglais : non traduit


Ah bah c’est le pompon (enfin, si je peux me permettre cette expression, on est dans la Marchande ici, pas dans la Royale) ! Rolland a enfin obtenu un commandement depuis quelques années, mais si c’est un torcheur (un capitaine qui sait aller vite et prendre des risques mesurés, sans forcément épargner ses hommes), ce n’est pas un capitaine forcément très apprécié de ses officiers ou de ses hommes d’équipage, et c’est aussi un homme las. La vie se déroule, de voyage en voyage, de port en port, sans diversité ni surprise, et Rolland subit plus qu’il ne vit.
Mais tout à coup, une femme apparaît, qui fascine Rolland et six semaines plus tard, le voilà marié et prêt à emmener sa femme avec lui dans son voyage à bord de l’Atalante, le fleuron de la flotte de son armateur. Mais Atalante, c’est l’héroïne grecque imbattable à la course (c’est du moins cette partie du mythe que retient Vercel ici). Et le capitaine Rolland n’hésitera pas quand il faudra choisir entre Geneviève, sa femme, et Atalante, son bateau.
Ce livre est dédié à plusieurs femmes, qui ont, comme Geneviève, accompagné leur mari capitaine dans leurs voyages au long cours. Je suppose donc que ce livre est censé leur rendre hommage. Et le portrait de Geneviève en jeune fille modeste et discrète mais volontaire et décidée commence plutôt bien, mais dès qu’elle met le pied sur le bateau, c’est terminé. Dépendante de son mari, sans volonté, une entrave potentielle à la capacité de jugement de son mari capitaine…
Alors peut-être que le livre veut montrer le tiraillement entre le devoir et le cœur, mais les relations de couple sont tellement écœurantes (je sais, Vercel est un breton des années 50, ni un lieu ni un temps très progressistes, mais cela ne justifie pas tout! ), la misogynie est telle que je suis tout simplement soulagée d’avoir fini cette trilogie, qui je crois marquera la fin de mon exploration de l’oeuvre de Roger Vercel.
Vraiment dommage cette série qui a très mal vieilli et qui cumule tous les poncifs du genre, que je suis pourtant souvent prête à excuser, mais je ne sais pas si je deviens plus chatouilleuse sur ces questions ou si là c’est vraiment trop.
Titre en anglais : non traduit

Ah bah c’est le pompon (enfin, si je peux me permettre cette expression, on est dans la Marchande ici, pas dans la Royale) ! Rolland a enfin obtenu un commandement depuis quelques années, mais si c’est un torcheur (un capitaine qui sait aller vite et prendre des risques mesurés, sans forcément épargner ses hommes), ce n’est pas un capitaine forcément très apprécié de ses officiers ou de ses hommes d’équipage, et c’est aussi un homme las. La vie se déroule, de voyage en voyage, de port en port, sans diversité ni surprise, et Rolland subit plus qu’il ne vit.
Mais tout à coup, une femme apparaît, qui fascine Rolland et six semaines plus tard, le voilà marié et prêt à emmener sa femme avec lui dans son voyage à bord de l’Atalante, le fleuron de la flotte de son armateur. Mais Atalante, c’est l’héroïne grecque imbattable à la course (c’est du moins cette partie du mythe que retient Vercel ici). Et le capitaine Rolland n’hésitera pas quand il faudra choisir entre Geneviève, sa femme, et Atalante, son bateau.
Ce livre est dédié à plusieurs femmes, qui ont, comme Geneviève, accompagné leur mari capitaine dans leurs voyages au long cours. Je suppose donc que ce livre est censé leur rendre hommage. Et le portrait de Geneviève en jeune fille modeste et discrète mais volontaire et décidée commence plutôt bien, mais dès qu’elle met le pied sur le bateau, c’est terminé. Dépendante de son mari, sans volonté, une entrave potentielle à la capacité de jugement de son mari capitaine…
Alors peut-être que le livre veut montrer le tiraillement entre le devoir et le cœur, mais les relations de couple sont tellement écœurantes (je sais, Vercel est un breton des années 50, ni un lieu ni un temps très progressistes, mais cela ne justifie pas tout! ), la misogynie est telle que je suis tout simplement soulagée d’avoir fini cette trilogie, qui je crois marquera la fin de mon exploration de l’oeuvre de Roger Vercel.
Vraiment dommage cette série qui a très mal vieilli et qui cumule tous les poncifs du genre, que je suis pourtant souvent prête à excuser, mais je ne sais pas si je deviens plus chatouilleuse sur ces questions ou si là c’est vraiment trop.
56raton-liseur
>55 Dilara86: Oui, j'aurais aussi pu parier que ceux-là n'iraient pas dans ta liste...
I have just started reading La Dure Loi du Karma/Life and Death are wearing me out by Mo Yan. It was on my list for the Asian reading challenge in 2022, so it's a long overdue read. I decided to read it now because I'm still on holidays at home for a few weeks, so an ideal time to start a 1000-page book.
As I am up to date on my July to August reviews, I expect this thread to be very quiet for a long time, the time necessary to read such a long book. But this might give me the time to finish writting my backlog of 20 reviews from the first half of 2024, and hopefully start again reading other CR threads, at last.
I have just started reading La Dure Loi du Karma/Life and Death are wearing me out by Mo Yan. It was on my list for the Asian reading challenge in 2022, so it's a long overdue read. I decided to read it now because I'm still on holidays at home for a few weeks, so an ideal time to start a 1000-page book.
As I am up to date on my July to August reviews, I expect this thread to be very quiet for a long time, the time necessary to read such a long book. But this might give me the time to finish writting my backlog of 20 reviews from the first half of 2024, and hopefully start again reading other CR threads, at last.
57labfs39
>56 raton-liseur: I liked Mo Yan's Red Sorghum, but found The Garlic Ballads so bleak as to be unpalatable. The concept of Life and Death are Wearing Me Out is interesting, and I look forward to your impressions as you go along. Have you read much else by him?
58raton-liseur
>57 labfs39: I've read Le Clan du sorgho/Red Sorghum in 2013 (thanks LT for your foolproof memory!) and did not like it: the story was too violent and the style was too intricate. but I believe I've changed as a reader so my feeling might be different this time.
And I've also read Le Radis de cristal/A Transparent Radish, a collection of short stories that was his first published work. It was a pre-LT read, but I remember liking it.
So I am not sure what I will feel about La Dure Loi du Karma/Life and Death are wearing me out but as you said, the concept is interesting, and intriguing.
The story begins in 1950, at the beginning of the communist era, so we are later in history compared to Le Clan du sorgho/Red Sorghum. The gore aspect is there, but I'd say gore rather than violent for the moment.
So difficult to predict if I will like it or not...
And I've also read Le Radis de cristal/A Transparent Radish, a collection of short stories that was his first published work. It was a pre-LT read, but I remember liking it.
So I am not sure what I will feel about La Dure Loi du Karma/Life and Death are wearing me out but as you said, the concept is interesting, and intriguing.
The story begins in 1950, at the beginning of the communist era, so we are later in history compared to Le Clan du sorgho/Red Sorghum. The gore aspect is there, but I'd say gore rather than violent for the moment.
So difficult to predict if I will like it or not...
59kjuliff
>58 raton-liseur: >57 labfs39: I saw the film Red Sorghum in the late 1980s. It was based on the book and won many awards. I remember thinking it was excellent.
60SassyLassy
Re Mo Yan
First of all here is a dormant group started by the much missed steventx: https://www.librarything.com/ngroups/13124/Read-Mo-Yan
It would be great to restart it.
Life and Death are Wearing Me Out, although bleak like all Mo's writing, had perhaps more of his humour than other of his books.
Red Sorghum (book and film) is what started me reading Mo Yan some time ago, and he is still one of my favourite authors.
The Garlic Ballads was another one of my favourite books by him.
For those who find his books too bleak, skip Frog completely.
First of all here is a dormant group started by the much missed steventx: https://www.librarything.com/ngroups/13124/Read-Mo-Yan
It would be great to restart it.
Life and Death are Wearing Me Out, although bleak like all Mo's writing, had perhaps more of his humour than other of his books.
Red Sorghum (book and film) is what started me reading Mo Yan some time ago, and he is still one of my favourite authors.
The Garlic Ballads was another one of my favourite books by him.
For those who find his books too bleak, skip Frog completely.
61raton-liseur
>60 SassyLassy: I won't be the one reviving the Mo Yan group, I think this book, La Dure Loi du Karma/Life and Death are Wearing Me Out, shows that I am not a Mo Yan reader...
Maybe, one day I'll try La Mélopée de l'ail paradisiaque/The Garlic Ballads (what a great title!) as, despite my reservation towards Mo Yan, intrigues me, but it won't be in a near future, for sure...
Maybe, one day I'll try La Mélopée de l'ail paradisiaque/The Garlic Ballads (what a great title!) as, despite my reservation towards Mo Yan, intrigues me, but it won't be in a near future, for sure...
62raton-liseur
74. -. (39) La Dure Loi du Karma de Mo Yan, traduit du chinois par Chantal Chen-Andro
Titre original : 生死疲劳 (Shēngsǐ píláo)
Titre en anglais : Life And Death Are Wearing Me Out


Je crois que ce livre est la victime collatérale d’une discussion que j’ai eue ces derniers jours avec M’sieur Raton à propos des livres et des séries télévisées, conversation de laquelle ressortait ma quasi-incapacité à abandonner un livre ou une série même si ça ne me plaisait pas. Et c’est vrai, j’ai tout le temps besoin d’aller jusqu’au bout, de donner sa chance à quelque chose qui m’intéressait suffisamment pour que je commence à le lire ou à le regarder, de continuer pour voir ce que tout cela donnerait et si, au bout du compte, cela prendrait forme et sens… Est-ce par esprit de contradiction, en tout cas j’ai décidé, et cette fois plus vite que d’habitude (pour mon dernier livre abandonné, il m’a fallu plusieurs semaines et presque 10 livres lus après l’avoir mis en pause pour me dire que non, finalement, ce n’était pas une pause mais un abandon…), d’arrêter les frais après plus de 200 pages lues tout de même, sur les 1 000 qu’en compte le livre. Mais je voyais bien que je procrastinais, je n’avais tout simplement pas envie de prendre mon livre et de le continuer, puis un soir j’ai décidé de faire une pause avec un autre bouquin… Je sais bien ce que cela veut dire, alors cette fois je ne me voile pas la face et je le dis tout net, c’est un abandon.
Maintenant, reste à essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi je me suis si prodigieusement ennuyée pendant cette lecture que je me suis arrêtée en cours de route. Mais en fait, tout est déjà dit, car le nœud du problème est là : cette lecture m’ennuie. Je trouvais l’idée d’utiliser le cycle des réincarnations pour parcourir 50 ans d’histoire chinoise (et quelle histoire !) très attrayante, mais que c’est long, que c’est poussif… Après une introduction pas très claire pendant laquelle on apprend tout de même que le propriétaire terrien (quelques ares, on est à l’échelle de ce qu’est la propriété en Chine) Ximen Nao a été exécuté, victime de l’avènement d’une ère nouvelle. Mais après avoir tellement exaspéré le roi des enfers, il gagne le droit de se réincarner, et nous voilà deux ans plus tard, en 1950, avec Ximen Nao qui naît à nouveau mais cette fois dans le corps d’un âne. Pour que tout cela soit un peu plus pimenté, il naît dans le même village, et devient même l’animal de son ancien valet-enfant trouvé-ils adoptif, qui est maintenant marié à sa première concubine, mère de ses enfants à lui Ximen Nao et d’un dernier-né, fils du valet Lan Lian. Pas clair ? C’est un peu normal, les relations entre les personnages sont intriquées, complexes, et si l’on ajoute le double statut du réincarné, à la fois ancien humain et réagissant parfois encore selon les codes de son ancienne place dans la société et à la fois actuel animal domestique et soumis aux instincts de son espèce, il y a de quoi s’emmêler un peu les pinceaux.
Mais au début, c’est amusant, justement, cet écheveau embrouillé de relations sociales passées et présentes. Et puis il faut ajouter à cela la présence dans le village d’un enfant tout juste né du nom de Mo Yan, qui deviendra écrivain et qui a écrit tout un tas de livre sur quelques-unes des péripéties secondaires évoquées dans ce livre : des livres dont les narrateurs, une des réincarnations de Ximen Nao et la personne avec qui il converse, nous citent abondamment des extraits, sauf que tous ces livres et tous ces extraits sont purement inventés, et que les narrateurs semblent trouver le petit trublion Mo Yan plutôt insupportable.
Encore une fois, tout cela est bien vu et amusant. Mais cela ne tient pas sur la longueur. Une fois que l’on a compris le coup de la réincarnation, une fois que l’on a souri quelques fois aux mentions taquines de Mo Yan enfant ou de Mo Yan écrivain d’œuvres fictives, eh bien le livre commence à tourner en rond (comme la roue du karma ?), le livre se répète et ne produit plus rien de nouveau, et c’est là que j’ai commencé à m’ennuyer. J’ai lu consciencieusement toute la vie de l’âne, mais quand ça a recommencé de la même façon avec le bœuf, je me suis dit que je n’allais pas encore « me farcir » le cochon, le chien, le singe et toute la ménagerie !
D’autant que ce que j’espérais trouver dans ce livre, c’était une évocation de l’histoire de la Chine. Et dans les années 50, avec le partage des terres, les débuts de la collectivisation, le Grand Bond en Avant, la production d’acier dans les campagnes, la Grande Famine, on ne peut pas dire que cette histoire soit monotone. Mais je n’ai rien appris à cette lecture : si c’étaient des événements que je connaissais, j’étais capable de les débusquer dans une allusion, au détour d’une phrase. Il y a probablement beaucoup de ces allusions que je n’ai pas vues, et donc ce que je ne sais pas, je ne le vois pas et je ne l’apprends pas. Peut-être est-ce plus un livre pour ceux qui connaissent l’histoire récente de la Chine bien mieux que moi, ou un livre pour ceux qui ont lu Mo Yan bien plus que moi, qui ont déjà visité toute cette époque en compagnie de l’auteur et pour qui cette œuvre apparaît alors comme une sorte de récapitulatif ou d’apothéose. Je ne sais, mais ce dont je suis sûre, c’est que ce n’est pas une lecture pour moi et je préfère m’arrêter là et laisser le bœuf Ximen Nao à ses labours.
Titre original : 生死疲劳 (Shēngsǐ píláo)
Titre en anglais : Life And Death Are Wearing Me Out


Je crois que ce livre est la victime collatérale d’une discussion que j’ai eue ces derniers jours avec M’sieur Raton à propos des livres et des séries télévisées, conversation de laquelle ressortait ma quasi-incapacité à abandonner un livre ou une série même si ça ne me plaisait pas. Et c’est vrai, j’ai tout le temps besoin d’aller jusqu’au bout, de donner sa chance à quelque chose qui m’intéressait suffisamment pour que je commence à le lire ou à le regarder, de continuer pour voir ce que tout cela donnerait et si, au bout du compte, cela prendrait forme et sens… Est-ce par esprit de contradiction, en tout cas j’ai décidé, et cette fois plus vite que d’habitude (pour mon dernier livre abandonné, il m’a fallu plusieurs semaines et presque 10 livres lus après l’avoir mis en pause pour me dire que non, finalement, ce n’était pas une pause mais un abandon…), d’arrêter les frais après plus de 200 pages lues tout de même, sur les 1 000 qu’en compte le livre. Mais je voyais bien que je procrastinais, je n’avais tout simplement pas envie de prendre mon livre et de le continuer, puis un soir j’ai décidé de faire une pause avec un autre bouquin… Je sais bien ce que cela veut dire, alors cette fois je ne me voile pas la face et je le dis tout net, c’est un abandon.
Maintenant, reste à essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi je me suis si prodigieusement ennuyée pendant cette lecture que je me suis arrêtée en cours de route. Mais en fait, tout est déjà dit, car le nœud du problème est là : cette lecture m’ennuie. Je trouvais l’idée d’utiliser le cycle des réincarnations pour parcourir 50 ans d’histoire chinoise (et quelle histoire !) très attrayante, mais que c’est long, que c’est poussif… Après une introduction pas très claire pendant laquelle on apprend tout de même que le propriétaire terrien (quelques ares, on est à l’échelle de ce qu’est la propriété en Chine) Ximen Nao a été exécuté, victime de l’avènement d’une ère nouvelle. Mais après avoir tellement exaspéré le roi des enfers, il gagne le droit de se réincarner, et nous voilà deux ans plus tard, en 1950, avec Ximen Nao qui naît à nouveau mais cette fois dans le corps d’un âne. Pour que tout cela soit un peu plus pimenté, il naît dans le même village, et devient même l’animal de son ancien valet-enfant trouvé-ils adoptif, qui est maintenant marié à sa première concubine, mère de ses enfants à lui Ximen Nao et d’un dernier-né, fils du valet Lan Lian. Pas clair ? C’est un peu normal, les relations entre les personnages sont intriquées, complexes, et si l’on ajoute le double statut du réincarné, à la fois ancien humain et réagissant parfois encore selon les codes de son ancienne place dans la société et à la fois actuel animal domestique et soumis aux instincts de son espèce, il y a de quoi s’emmêler un peu les pinceaux.
Mais au début, c’est amusant, justement, cet écheveau embrouillé de relations sociales passées et présentes. Et puis il faut ajouter à cela la présence dans le village d’un enfant tout juste né du nom de Mo Yan, qui deviendra écrivain et qui a écrit tout un tas de livre sur quelques-unes des péripéties secondaires évoquées dans ce livre : des livres dont les narrateurs, une des réincarnations de Ximen Nao et la personne avec qui il converse, nous citent abondamment des extraits, sauf que tous ces livres et tous ces extraits sont purement inventés, et que les narrateurs semblent trouver le petit trublion Mo Yan plutôt insupportable.
Encore une fois, tout cela est bien vu et amusant. Mais cela ne tient pas sur la longueur. Une fois que l’on a compris le coup de la réincarnation, une fois que l’on a souri quelques fois aux mentions taquines de Mo Yan enfant ou de Mo Yan écrivain d’œuvres fictives, eh bien le livre commence à tourner en rond (comme la roue du karma ?), le livre se répète et ne produit plus rien de nouveau, et c’est là que j’ai commencé à m’ennuyer. J’ai lu consciencieusement toute la vie de l’âne, mais quand ça a recommencé de la même façon avec le bœuf, je me suis dit que je n’allais pas encore « me farcir » le cochon, le chien, le singe et toute la ménagerie !
D’autant que ce que j’espérais trouver dans ce livre, c’était une évocation de l’histoire de la Chine. Et dans les années 50, avec le partage des terres, les débuts de la collectivisation, le Grand Bond en Avant, la production d’acier dans les campagnes, la Grande Famine, on ne peut pas dire que cette histoire soit monotone. Mais je n’ai rien appris à cette lecture : si c’étaient des événements que je connaissais, j’étais capable de les débusquer dans une allusion, au détour d’une phrase. Il y a probablement beaucoup de ces allusions que je n’ai pas vues, et donc ce que je ne sais pas, je ne le vois pas et je ne l’apprends pas. Peut-être est-ce plus un livre pour ceux qui connaissent l’histoire récente de la Chine bien mieux que moi, ou un livre pour ceux qui ont lu Mo Yan bien plus que moi, qui ont déjà visité toute cette époque en compagnie de l’auteur et pour qui cette œuvre apparaît alors comme une sorte de récapitulatif ou d’apothéose. Je ne sais, mais ce dont je suis sûre, c’est que ce n’est pas une lecture pour moi et je préfère m’arrêter là et laisser le bœuf Ximen Nao à ses labours.
63kjuliff
>62 raton-liseur: This looks really interesting and I’m tempted - but like you I don’t know a lot about recent Chinese history.
64labfs39
>62 raton-liseur: It sounds like the English title, Life and Death are Wearing Me Out, might be a caution to the reader that the book too will wear one out. Despite it not sounding as violent as some his other books which I have read, I am not adding this to my China reading list. Like you I may not have the background to appreciate his allusions, nor the patience for the entire zodiac. Thanks for taking one for the team, and good for you for bailing and moving on.
65Dilara86
>62 raton-liseur: The funny thing is, although this review pans the book, it contains all sorts of details that make it intriguing. So, now I'm quite tempted, even though I could never quite get into Mo Yan (not that I tried recently) :-D And it reminds me a bit of the more recent Le Banquet annuel de la Confrérie des fossoyeurs by Mathias Enard.
66raton-liseur
>63 kjuliff: You could try, I think it is really personnal and I can see why some readers would enjoy it.
>64 labfs39: Good point re. the title! :-)
>65 Dilara86: I understand what you mean: sometimes negative reaviews might make a book appealling to someone else.
Mathias Enard, another writer I have never tried, and I'm not sure I should or I want to...
>64 labfs39: Good point re. the title! :-)
>65 Dilara86: I understand what you mean: sometimes negative reaviews might make a book appealling to someone else.
Mathias Enard, another writer I have never tried, and I'm not sure I should or I want to...
67raton-liseur
And the book I read while moving away from China was a nice and light one, but not as nice as the first in the series.
75. 52. (-) Le Murder Club enquête, tome 2 : Le Jeudi suivant de Richard Osman, traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Sophie Alibert
Titre original : The Man Who Died Twice
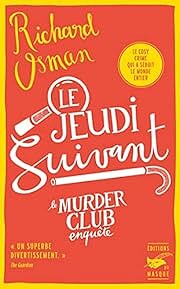

C’est toujours un peu dangereux, les deuxièmes tomes, surtout quand en fait ils sont plus dictés par le succès (inespéré, ou en tout cas dépassant les espérances) du premier tome. Et c’est le cas ici. Le Murder Club du Jeudi est un petit bijou, et Richard Osman s’est senti obligé de récidiver après l’enthousiasme suscité par son livre.
Et comme on peut le redouter dans ces cas-là, c’est moins bon. Tout ce qui faisait la saveur très particulière de ce livre s’est évaporée : la surprise d’abord, mais cela c’est inévitable et difficile à remplacer ; la description tendre des personnages (pas de petits vieux attachants dans les personnages secondaires alors que pour moi Bernard Cottle ou bien même Penny faisaient beaucoup pour l’intérêt du livre ; par contre, les Chris et les Donna restent, mais on a déjà fait un peu le tour de ces personnages et leur relation n’évolue pas et devient un peu forcée sur la durée ; l’humour doux-amer d’un regard sans concession sur la vieillesse qui ne se renouvelle pas non plus.
Et à la place, une intrigue qui prend plus le dessus alors que, franchement, ce n’est pas l’intérêt de ce livre qui n’a rien à faire dans la partie « romans policiers » d’une bibliothèque, il y a moins de mystère et de non-dits (le personnage d’Elizabeth, aux ressources infinies, perd ici tout de l’aura de mystère qui l’entourait), moins de surprises.
Soyons honnête, j’ai passé un assez bon moment de lecture, principalement parce que j’ai apprécié de retrouver le quatuor vieillissant et infernal, mais cela ne vaut pas le premier tome, et on aurait très bien pu laisser ces petits vieux à leur gentil club du jeudi sans les convier à nouveau dans cette équipée un peu échevelée (au sens d’une mise en pli de cheveux violets qui demande à être refaite). Maintenant, la question se pose : il y a deux autres tomes encore dans cette série. Que faire ? En réalité, poser la question, c’est déjà partiellement y répondre. Et comme j’ai découvert cette série grâce à une note de lecture enthousiaste qui portait sur le troisième tome, je sais que je vais chercher à me le procurer et que je serai contente de retrouver la plume candide de Joyce s’interrogeant avec le plus grand sérieux sur la meilleure façon de préparer cette nouvelle boisson, là, une tisane : faut-il laisser le sachet dans la tasse ou le retirer avant de servir la tasse ? Et est-ce que servir cette tisane à une agente du MI5 qui vient de tuer son premier méchant change la réponse à la question ? Si vous avez la réponse à ces questions cruciales (presque plus cruciales que de démasquer les méchants), rendez-vous à Cooper Chase un jeudi après-midi !
75. 52. (-) Le Murder Club enquête, tome 2 : Le Jeudi suivant de Richard Osman, traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Sophie Alibert
Titre original : The Man Who Died Twice
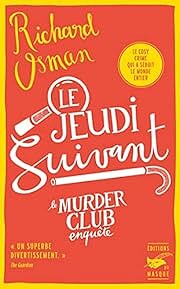

Donna s’agenouille et allume la lumière, Joyce songe à s’agenouiller mais, vraiment, se mettre à genoux passé l’âge de soixante-cinq ans n’est qu’une chimère, alors à la place, elle s’assoit sur la marche juste au-dessus. Elizabeth, quant à elle, s’agenouille. N’y a-t-il rien qu’elle soit incapable de faire ?
(p. 237, Chapitre 43).
C’est toujours un peu dangereux, les deuxièmes tomes, surtout quand en fait ils sont plus dictés par le succès (inespéré, ou en tout cas dépassant les espérances) du premier tome. Et c’est le cas ici. Le Murder Club du Jeudi est un petit bijou, et Richard Osman s’est senti obligé de récidiver après l’enthousiasme suscité par son livre.
Et comme on peut le redouter dans ces cas-là, c’est moins bon. Tout ce qui faisait la saveur très particulière de ce livre s’est évaporée : la surprise d’abord, mais cela c’est inévitable et difficile à remplacer ; la description tendre des personnages (pas de petits vieux attachants dans les personnages secondaires alors que pour moi Bernard Cottle ou bien même Penny faisaient beaucoup pour l’intérêt du livre ; par contre, les Chris et les Donna restent, mais on a déjà fait un peu le tour de ces personnages et leur relation n’évolue pas et devient un peu forcée sur la durée ; l’humour doux-amer d’un regard sans concession sur la vieillesse qui ne se renouvelle pas non plus.
Et à la place, une intrigue qui prend plus le dessus alors que, franchement, ce n’est pas l’intérêt de ce livre qui n’a rien à faire dans la partie « romans policiers » d’une bibliothèque, il y a moins de mystère et de non-dits (le personnage d’Elizabeth, aux ressources infinies, perd ici tout de l’aura de mystère qui l’entourait), moins de surprises.
Soyons honnête, j’ai passé un assez bon moment de lecture, principalement parce que j’ai apprécié de retrouver le quatuor vieillissant et infernal, mais cela ne vaut pas le premier tome, et on aurait très bien pu laisser ces petits vieux à leur gentil club du jeudi sans les convier à nouveau dans cette équipée un peu échevelée (au sens d’une mise en pli de cheveux violets qui demande à être refaite). Maintenant, la question se pose : il y a deux autres tomes encore dans cette série. Que faire ? En réalité, poser la question, c’est déjà partiellement y répondre. Et comme j’ai découvert cette série grâce à une note de lecture enthousiaste qui portait sur le troisième tome, je sais que je vais chercher à me le procurer et que je serai contente de retrouver la plume candide de Joyce s’interrogeant avec le plus grand sérieux sur la meilleure façon de préparer cette nouvelle boisson, là, une tisane : faut-il laisser le sachet dans la tasse ou le retirer avant de servir la tasse ? Et est-ce que servir cette tisane à une agente du MI5 qui vient de tuer son premier méchant change la réponse à la question ? Si vous avez la réponse à ces questions cruciales (presque plus cruciales que de démasquer les méchants), rendez-vous à Cooper Chase un jeudi après-midi !
68raton-liseur
And my first book from the "Rentrée littéraire", the French autumn book-publishing frenzy, is a short teen book, published by the very good Actes Sud jeunesse publisher, and scheduled for next october. Good, not great, but a difficult topic.
76. -. (-) Bâtardes de Rachel Corenblit
Titre en anglais : non traduit


Merci aux éditions Actes Sud jeunesse de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
Un sujet pas évident, celui d’une page noire de la Libération, avec ses tondues, et plus généralement, la question des secrets familiaux. Un sujet encore moins évident quand il s’agit d’un livre destiné à la jeunesse. L’autrice a décidé de l’aborder de façon très littéraire, avec un roman épistolaire, beaucoup de jolis images et des tournures de phrases éloignées du langage oral.
On reste dans une intrigue (que l’on devine vite, ce n’est pas le suspens qui fait l’intérêt du livre) très classique : l’humiliée de la Libération était véritablement amoureuse, mais elle paiera cet amour toute sa vie, car il y aura l’humiliation de la Libération, mais aussi le poids de la fille-mère. Puis il y aura ensuite cette idée de la reproduction familiale des traumatismes.
Et finalement, ce livre, à la trame attendue, réussit à se muer en une sorte de manifeste féministe dénonçant une société où la femme est nécessairement soumise et où les corps et les sentiments n’ont le droit d’exister que tant qu’ils se conforment aux désirs masculins.
Un livre qui semble à première vue innocent, mais qui par sa simplicité même permet de s’interroger, et de façon plus générale que la thématique initiale.
76. -. (-) Bâtardes de Rachel Corenblit
Titre en anglais : non traduit


Attendre l’accalmie sans protester.
Se résigner.
C’est notre sort, à toi et à moi.
(p. 20, “Mathilde (à Stéphanie)).
Merci aux éditions Actes Sud jeunesse de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
Un sujet pas évident, celui d’une page noire de la Libération, avec ses tondues, et plus généralement, la question des secrets familiaux. Un sujet encore moins évident quand il s’agit d’un livre destiné à la jeunesse. L’autrice a décidé de l’aborder de façon très littéraire, avec un roman épistolaire, beaucoup de jolis images et des tournures de phrases éloignées du langage oral.
On reste dans une intrigue (que l’on devine vite, ce n’est pas le suspens qui fait l’intérêt du livre) très classique : l’humiliée de la Libération était véritablement amoureuse, mais elle paiera cet amour toute sa vie, car il y aura l’humiliation de la Libération, mais aussi le poids de la fille-mère. Puis il y aura ensuite cette idée de la reproduction familiale des traumatismes.
Et finalement, ce livre, à la trame attendue, réussit à se muer en une sorte de manifeste féministe dénonçant une société où la femme est nécessairement soumise et où les corps et les sentiments n’ont le droit d’exister que tant qu’ils se conforment aux désirs masculins.
Un livre qui semble à première vue innocent, mais qui par sa simplicité même permet de s’interroger, et de façon plus générale que la thématique initiale.
69raton-liseur
Reading La Dure Loi du Karma / Life and Death are Wearing Me Out proved to be a not so positive experience. But because there is still some time before the end of the summer break, I have decided to choose again my book based on its length.
When I chose Mo Yan's book, I had two other contenders: La Chartreuse de Parme / The Charterhouse of Parma or Un monde pour Julius / A World for Julius.
So I have decided to read Harlem Quartet / Just Above My Head!
Not as chunky as Mo Yan's book, but by far a better read!
When I chose Mo Yan's book, I had two other contenders: La Chartreuse de Parme / The Charterhouse of Parma or Un monde pour Julius / A World for Julius.
So I have decided to read Harlem Quartet / Just Above My Head!
Not as chunky as Mo Yan's book, but by far a better read!
70labfs39
>69 raton-liseur: I'm glad you found something that appeals. Funny the way you say you had two other contenders to the Mo Yan, but chose a third one. :-)
71SassyLassy
>62 raton-liseur: Loved reading your thoughts on reading Life and Death are Wearing Me Out. Sorry the book didn't live up to expectations. I do think I prefer the title in French La Dure Loi du Karma
It seems after reading all the responses to >62 raton-liseur:, I am an n of one when it comes to Mo Yan. Quelle douleur!
It seems after reading all the responses to >62 raton-liseur:, I am an n of one when it comes to Mo Yan. Quelle douleur!
72raton-liseur
>70 labfs39: Well, you know how some of us are: plans are made not to be followed... I've finished Harlem Quartet / Just Above My Head yesterday evening, and it was quite an experience! Review to come today or within a few days.
>71 SassyLassy: Well, as >64 labfs39: said, at least, with the English title, you know what you are up to!
Joking aside, it seems that the English title is more literal than the French one. Not sure why the French translator decided to depart from the original title though.
>71 SassyLassy: Well, as >64 labfs39: said, at least, with the English title, you know what you are up to!
Joking aside, it seems that the English title is more literal than the French one. Not sure why the French translator decided to depart from the original title though.
73raton-liseur
78. 11g. (-) Salon de beauté de Quentin Zuttion
Titre en anglais : non traduit


Merci aux éditions Dupuis de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
C’est la couverture très étrange, puis le résumé qui m’a donné envie de lire ce livre. Et ce n’est qu’en commençant la lecture que je me suis aperçue qu’il s’agit de l’adaptation d’un roman. Bon, mais au fond cela ne change pas grand-chose, même si j’ai tendance à penser qu’il y a un peu trop d’adaptations sur le marché et que je préférerais plus d’œuvres originales, mais passons.
Le salon de beauté du titre, le Beauty Fish, est tenu par Jeshua et ses deux amis, Isai et Alex, tous les trois homosexuels et travestis. On sent bien que l’acceptation de leurs choix de vie par la population de leur village n’est pas complètement là, mais ils trouvent une certaine forme d’équilibre. Mais vient la rumeur d’une maladie, puis les premiers symptômes… Une étrange maladie, belle si elle n’était pas létale, qui fait apparaître des écailles de poisson verte et orange sur les corps atteints. Alors Jeshua transforme son salon de beauté en dernier refuge pour les hommes atteints.
Il n’est pas difficile de voir dans cette histoire une allégorie de l’épidémie de sida, avec la même peur, la même stigmatisation, la même incompréhension. Mais rien n’est asséné, tout est suggéré, à travers les personnages secondaires, à travers les attitudes et par le dessin. C’est une œuvre graphique toute en finesse, qui suggère plus qu’elle ne dit. On sent la souffrance et la solitude, même derrière les maquillages un peu trop voyants et les rires un peu trop forts.
Je ne suis pas certaines d’avoir compris toute la profondeur de toutes les allégories (pourquoi des écailles de poisson, par exemple ; le choix des couleurs a-t-il un sens…), j’ai parfois trouvé les dessins un peu trop crus, mais c’est une belle bd, un moment plein de tristesse mais aussi de beauté graphique, ce qui laisse un étrange sentiment à l’issue de cette lecture, entre contentement des yeux et amère mélancolie.
Petite note additionnelle : En écrivant cette note de lecture, je suis tombée sur la photo de l’auteur, et j’ai été frappée par la proximité entre la silhouette de l’auteur (sa coiffure faussement en pétard et ses membres plutôt frêles) et les attitudes de certains de ses personnages, principalement Jeshua, le personnage principal, mais d’autres aussi. Cette bande dessinée, pourtant adaptée d’un roman, doit emprunter beaucoup à son auteur, ou du moins résonner très profondément en lui.
Titre en anglais : non traduit


Merci aux éditions Dupuis de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
C’est la couverture très étrange, puis le résumé qui m’a donné envie de lire ce livre. Et ce n’est qu’en commençant la lecture que je me suis aperçue qu’il s’agit de l’adaptation d’un roman. Bon, mais au fond cela ne change pas grand-chose, même si j’ai tendance à penser qu’il y a un peu trop d’adaptations sur le marché et que je préférerais plus d’œuvres originales, mais passons.
Le salon de beauté du titre, le Beauty Fish, est tenu par Jeshua et ses deux amis, Isai et Alex, tous les trois homosexuels et travestis. On sent bien que l’acceptation de leurs choix de vie par la population de leur village n’est pas complètement là, mais ils trouvent une certaine forme d’équilibre. Mais vient la rumeur d’une maladie, puis les premiers symptômes… Une étrange maladie, belle si elle n’était pas létale, qui fait apparaître des écailles de poisson verte et orange sur les corps atteints. Alors Jeshua transforme son salon de beauté en dernier refuge pour les hommes atteints.
Il n’est pas difficile de voir dans cette histoire une allégorie de l’épidémie de sida, avec la même peur, la même stigmatisation, la même incompréhension. Mais rien n’est asséné, tout est suggéré, à travers les personnages secondaires, à travers les attitudes et par le dessin. C’est une œuvre graphique toute en finesse, qui suggère plus qu’elle ne dit. On sent la souffrance et la solitude, même derrière les maquillages un peu trop voyants et les rires un peu trop forts.
Je ne suis pas certaines d’avoir compris toute la profondeur de toutes les allégories (pourquoi des écailles de poisson, par exemple ; le choix des couleurs a-t-il un sens…), j’ai parfois trouvé les dessins un peu trop crus, mais c’est une belle bd, un moment plein de tristesse mais aussi de beauté graphique, ce qui laisse un étrange sentiment à l’issue de cette lecture, entre contentement des yeux et amère mélancolie.
Petite note additionnelle : En écrivant cette note de lecture, je suis tombée sur la photo de l’auteur, et j’ai été frappée par la proximité entre la silhouette de l’auteur (sa coiffure faussement en pétard et ses membres plutôt frêles) et les attitudes de certains de ses personnages, principalement Jeshua, le personnage principal, mais d’autres aussi. Cette bande dessinée, pourtant adaptée d’un roman, doit emprunter beaucoup à son auteur, ou du moins résonner très profondément en lui.
74raton-liseur
77. 53. (40) Harlem Quartet de James Baldwin, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Christiane Besse
Titre original : Just Above My Head
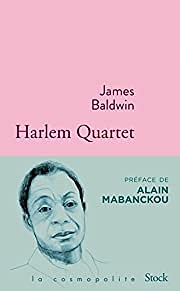

Un peu difficile de savoir où commencer cette note de lecture pour un roman qui se veut un peu un roman-monde, qui arrive sur la fin de la carrière bien remplie d’un écrivain protéiforme et qui semble rassembler la plupart de ses (nombreux) sujets de prédilection. Ce n’est peut-être pas la meilleure façon pour entrer en douceur dans le monde de James Baldwin, mais Baldwin ne se veut pas un écrivain de la douceur, alors finalement, c’est une bonne façon d’entrer de plain pied dans son univers et de se frotter à ses thèmes de prédilection : la condition noire, l’homosexualité, la religion, la pauvreté, la musique, etc., etc.
C’est une lecture qui bouscule. Un peu crue par rapport à ce que j’aime d’habitude, mais la crudité n’étant pas hors de propos, je me suis laissée faire. J’ai aimé la façon assez naturelle dont l’homosexualité est traitée : ce n’est pas explicitement accepté, mais le personnage principal, qui est homosexuel, sans le crier sur les toits et semblant tout de même craindre un peu la réaction de ses proches, ne se cache véritablement non plus. (J’ai d’ailleurs noté avec un peu d’amusement que, bien que le narrateur – qui n’est pas le personnage principal et qui n’est pas l’auteur – soit hétérosexuel, les hommes sont décrits avec plus de précision que les femmes. Certes, cela peut s’expliquer par la forte séparation des sexes dans la société, mais je penche plus, par coquetterie, pour un travers plus ou moins conscient de l’auteur).
Et puis surtout, je suis un peu tombée des nues quant à la situation des Noirs de New York. Je l’ai déjà dit dans une précédente note de lecture : on a souvent cette idée d’un Sud raciste et d’un Nord progressiste, mais la réalité est toute autre. Certes le Sud est pire, et la façon dont James Baldwin réussit à décrire la peur constante dans laquelle les Noirs vivent dans les Etats du Sud m’a fait frémir. Mais le Nord a aussi ses travers, et ce qui est décrit là, c’est une sorte de ségrégation de fait : les Noirs et les Blancs ne vivent tout simplement pas ensemble, ils se côtoient, et encore pas toujours car la ségrégation, dans les transports par exemple, semble aussi être en vigueur, mais ils s’ignorent et vivent dans deux sociétés imperméables l’une à l’autre à quelques exceptions près, femmes de ménages et autres.
On est dans les années 40 puis 50, avant les événements plus connus de l’opposition à la guerre du Vietnam et des marches pour les droits civiques. Le roman est donc intéressant pour cette atmosphère qui précède ces grands moments, là où tout est en germe sans qu’on le sache, là où tous les ingrédients sont déjà là et où l’on voit la prise de conscience (de certains personnages seulement, ou bien de façon différente selon les personnages) se faire peu à peu. C’est passionnant à lire, c’est glaçant dans ses aspects sociétaux, mais en même temps, c’est un livre plein de vie (même si c’est en quelque sorte un journal de deuil, celui d’un frère qui cherche à mieux approcher qui était son cadet maintenant disparu).
Il y a beaucoup de matière dans ce livre long et dense. C’est une lecture parfois un peu complexe, mais qui m’a passionnée de bout en bout. Je découvre James Baldwin avec ce roman, non à cause du centenaire de sa naissance, puisque je découvre qu’il est actuellement à l’honneur, mais c’est une coïncidence pour moi qui avait acheté ce livre il y a quelques années après avoir lu plusieurs notes de lecture intéressantes sur cet auteur dont je n’avais jamais entendu parler avant. Je ne pensais pas dire cela, mais je crois bien qu’il y aura d’autre livres de James Baldwin dans mes lectures futures. Probablement pas tout de suite, car il faut que je me remette de celle-là, mais dans quelques temps, car je suis curieuse de découvrir d’autres œuvres et de voir si elles ont la même intensité dramatique et la même force d’évocation dans l’écriture. Une découverte passionnante, et qui fera date.
Titre original : Just Above My Head
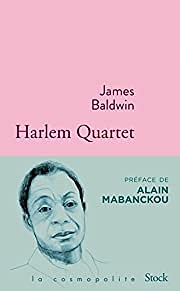

Un peu difficile de savoir où commencer cette note de lecture pour un roman qui se veut un peu un roman-monde, qui arrive sur la fin de la carrière bien remplie d’un écrivain protéiforme et qui semble rassembler la plupart de ses (nombreux) sujets de prédilection. Ce n’est peut-être pas la meilleure façon pour entrer en douceur dans le monde de James Baldwin, mais Baldwin ne se veut pas un écrivain de la douceur, alors finalement, c’est une bonne façon d’entrer de plain pied dans son univers et de se frotter à ses thèmes de prédilection : la condition noire, l’homosexualité, la religion, la pauvreté, la musique, etc., etc.
C’est une lecture qui bouscule. Un peu crue par rapport à ce que j’aime d’habitude, mais la crudité n’étant pas hors de propos, je me suis laissée faire. J’ai aimé la façon assez naturelle dont l’homosexualité est traitée : ce n’est pas explicitement accepté, mais le personnage principal, qui est homosexuel, sans le crier sur les toits et semblant tout de même craindre un peu la réaction de ses proches, ne se cache véritablement non plus. (J’ai d’ailleurs noté avec un peu d’amusement que, bien que le narrateur – qui n’est pas le personnage principal et qui n’est pas l’auteur – soit hétérosexuel, les hommes sont décrits avec plus de précision que les femmes. Certes, cela peut s’expliquer par la forte séparation des sexes dans la société, mais je penche plus, par coquetterie, pour un travers plus ou moins conscient de l’auteur).
Et puis surtout, je suis un peu tombée des nues quant à la situation des Noirs de New York. Je l’ai déjà dit dans une précédente note de lecture : on a souvent cette idée d’un Sud raciste et d’un Nord progressiste, mais la réalité est toute autre. Certes le Sud est pire, et la façon dont James Baldwin réussit à décrire la peur constante dans laquelle les Noirs vivent dans les Etats du Sud m’a fait frémir. Mais le Nord a aussi ses travers, et ce qui est décrit là, c’est une sorte de ségrégation de fait : les Noirs et les Blancs ne vivent tout simplement pas ensemble, ils se côtoient, et encore pas toujours car la ségrégation, dans les transports par exemple, semble aussi être en vigueur, mais ils s’ignorent et vivent dans deux sociétés imperméables l’une à l’autre à quelques exceptions près, femmes de ménages et autres.
On est dans les années 40 puis 50, avant les événements plus connus de l’opposition à la guerre du Vietnam et des marches pour les droits civiques. Le roman est donc intéressant pour cette atmosphère qui précède ces grands moments, là où tout est en germe sans qu’on le sache, là où tous les ingrédients sont déjà là et où l’on voit la prise de conscience (de certains personnages seulement, ou bien de façon différente selon les personnages) se faire peu à peu. C’est passionnant à lire, c’est glaçant dans ses aspects sociétaux, mais en même temps, c’est un livre plein de vie (même si c’est en quelque sorte un journal de deuil, celui d’un frère qui cherche à mieux approcher qui était son cadet maintenant disparu).
Il y a beaucoup de matière dans ce livre long et dense. C’est une lecture parfois un peu complexe, mais qui m’a passionnée de bout en bout. Je découvre James Baldwin avec ce roman, non à cause du centenaire de sa naissance, puisque je découvre qu’il est actuellement à l’honneur, mais c’est une coïncidence pour moi qui avait acheté ce livre il y a quelques années après avoir lu plusieurs notes de lecture intéressantes sur cet auteur dont je n’avais jamais entendu parler avant. Je ne pensais pas dire cela, mais je crois bien qu’il y aura d’autre livres de James Baldwin dans mes lectures futures. Probablement pas tout de suite, car il faut que je me remette de celle-là, mais dans quelques temps, car je suis curieuse de découvrir d’autres œuvres et de voir si elles ont la même intensité dramatique et la même force d’évocation dans l’écriture. Une découverte passionnante, et qui fera date.
75raton-liseur
79. 54. (41) Médée Kali, suivi de Sodome, ma douce de Laurent Gaudé
Titre en anglais : non traduit


Dans la lignée de mes lectures de réécritures du mythe de Médée, je ne pouvais que me plonger dans cette pièce de théâtre de celui qui est peut-être bien mon auteur français contemporain préféré. J’aime particulièrement chez lui la façon dont il s’approprie les mythes ou dont il crée les siens, ma route de lectrice devait donc immanquablement croiser ces deux courtes pièces de théâtre qui sont deux longs monologues féminins. Ils ne sont pas contemporains dans l’écriture, Médée Kali ayant été créée en 2003 et Sodome, ma douce en 2010 (en Irlande et en 2011 en France). Mais les éditions Actes Sud ont décidé de les réunir du fait de leur évidente parenté de forme et de ton. A la fin de ma lecture, je ne peux que regretter de ne pas avoir vu ces pièces jouées, car elles valent toutes les deux principalement par le flux de leur verbe, par la force des mots et la rage du ton.
Dans Médée Kali, comme le titre l’indique, Laurent Gaudé n’hésite pas à mélanger des figures issues de mythologies différentes : il y a la Médée grecque et la Kali hindoue bien sûr, mais aussila figure de la Gorgone , toutes ces figures inquiétantes mélangées en une seule femme. Et ici, personne n’essaie de dédouaner Médée, de lui trouver des excuses ou des circonstances atténuantes, Médée est certes une femme bafouée, trahie par Jason, mais elle assume sa vengeance et son crime jusqu’au bout car si elle revient sur la tombe de ses enfants, ce n’est pas pour pleurer, ce n’est pas la fibre maternelle qui l’appelle, au contraire, elle est là pour priver ses enfants de sépulture, le pire qu’il puisse arriver à un Grec de l’Antiquité, afin de parachever sa vengeance en effaçant jusqu’au lieu où Jason pourrait venir pleurer ses enfants perdus . C’est donc une femme forte jusqu’à l’extrême, emplie de sa rage et sourde à toute raison.
Dans Sodome, ma douce, la narratrice n’est pas nommée mais l’on comprend qu’il s’agit d’une princesse de cette cité dans le nom même semble une malédiction. Elle raconte comment la ville est tombée,non par une malédiction divine, mais par une traîtrise digne d’un cheval de Troie (encore un télescopage de mythes, décidemment) , elle raconte le sel, et elle raconte comment elle saura se venger.
Deux textes forts qui crient la rage et la vengeance au féminin, qui disent le désir de choisir la forme qu’elle veut donner à sa dignité et la garantir quel qu’en soit le prix pour soi et pour les autres, Pas de récupérations féministes des mythes ici (sauf à considérer que des femmes tellement fortes qu’elles vont au bout de leur folie et de leur vengeance sont des figures féministes), juste des émotions violentes à l’état pur, presque animales. A voir plus qu’à lire, ce doit être passionnant à jouer et magistral à regarder.
Titre en anglais : non traduit


Dans la lignée de mes lectures de réécritures du mythe de Médée, je ne pouvais que me plonger dans cette pièce de théâtre de celui qui est peut-être bien mon auteur français contemporain préféré. J’aime particulièrement chez lui la façon dont il s’approprie les mythes ou dont il crée les siens, ma route de lectrice devait donc immanquablement croiser ces deux courtes pièces de théâtre qui sont deux longs monologues féminins. Ils ne sont pas contemporains dans l’écriture, Médée Kali ayant été créée en 2003 et Sodome, ma douce en 2010 (en Irlande et en 2011 en France). Mais les éditions Actes Sud ont décidé de les réunir du fait de leur évidente parenté de forme et de ton. A la fin de ma lecture, je ne peux que regretter de ne pas avoir vu ces pièces jouées, car elles valent toutes les deux principalement par le flux de leur verbe, par la force des mots et la rage du ton.
Dans Médée Kali, comme le titre l’indique, Laurent Gaudé n’hésite pas à mélanger des figures issues de mythologies différentes : il y a la Médée grecque et la Kali hindoue bien sûr, mais aussi
Dans Sodome, ma douce, la narratrice n’est pas nommée mais l’on comprend qu’il s’agit d’une princesse de cette cité dans le nom même semble une malédiction. Elle raconte comment la ville est tombée,
Deux textes forts qui crient la rage et la vengeance au féminin, qui disent le désir de choisir la forme qu’elle veut donner à sa dignité et la garantir quel qu’en soit le prix pour soi et pour les autres, Pas de récupérations féministes des mythes ici (sauf à considérer que des femmes tellement fortes qu’elles vont au bout de leur folie et de leur vengeance sont des figures féministes), juste des émotions violentes à l’état pur, presque animales. A voir plus qu’à lire, ce doit être passionnant à jouer et magistral à regarder.
76raton-liseur
80. 55. (-) Les Saisons et les jours de Caroline Miller, traduit de l'américain par Michèle Valencia
Titre original : Lamb in His Bosom


J’ai entendu parler de ce livre il y a quelques temps déjà lorsque les éditions Belfont ont eu l’idée de le rééditer dans leur collection Vintage, mais je ne l’avais pas lu alors, et c’est seulement lorsque la bibliothèque de mon village l’a sorti de ses réserves dernièrement que je me suis dit qu’il était temps que je lise ce que j’avais vu présenté comme un classique américain méconnu, grandement admiré par Margaret Mitchell (et je viens tout juste de re-regarder Autant en emporte le vent, ça tombe bien…). En fait, d’après la préface de mon édition, du fait de son succès populaire (comme en témoignent les nombreuses rééditions après sa publication) et littéraire (le prix Pulitzer lui est attribué en 1934, une première pour un roman venu de Géorgie), son éditeur a recherché d’autres œuvres d’écrivains géorgiens, et c’est ainsi qu’a été publié Autant en emporte le vent, dont la notoriété éclipsera celle des Saisons et des Jours.
Pourtant, si le marketing littéraire nous incite à comparer ces deux œuvres, ce sont deux romans très différents. Les Saisons et les jours se passe disons une ou deux générations avant les déboires de Scarlett O’Hara, puisqu’au début du roman les échos de la guerre d’indépendance ne sont pas loin. Et puis surtout, Les Saisons et les jours est le roman de l’intérieur de la Géorgie, loin des grandes plantations de coton de la côte (même si l’on y cultive aussi du coton). C’est le roman de l’intérieur, mais aussi des pionniers, puisque les parents de Cean sont venus de la Caroline voisine pour s’installer sur une terre toute juste prise aux Indiens Creeks. En cela, le livre m’a paru plus proche de La Petite Maison dans la Prairie, de Laura Ingalls Wilder, que de Autant en emporte le vent. C’est la même vie en quasi autarcie, la même vie de labeur incessant, la même vie où tout est à construire, pierre à pierre, ou plutôt planche à planche, sillon à sillon. (Et puis le mari de Cean s’appelle Lonzo, diminutif d’Alonzo, et je n’ai pas pu, à chaque fois que je lisais son nom, ne pas penser à Almanzo – raccourci en Manzo, le mari de Laura Ingalls... C’est très probablement une coïncidence vues les dates de publications quasi concomitantes de ces deux livres, mais cela les a encore plus rapproché dans mon esprit).
Mais Les Saisons et les jours n’a pas l’insouciance enfantine de La Petite Maison dans la prairie, car c’est la vie d’une femme que l’on suit, la vie de Cean, depuis le jour de son mariage jusqu’à ses vieux jours. Et c’est toute la monotonie de cette vie que l’on lit dans ces pages, cette monotonie suggérée par le titre choisi pour l’édition française (un titre bien éloigné de son titre original, Lamb in His Bosom, « un agneau sur son sein », une citation de la Bible, dans le Livre d’Isaïe, où il est question de Dieu accueillant et protégeant ses créatures contre lui, mais j’imagine que le lectorat français est moins enclin à lire des livres avec une référence religieuse si explicite, d’où ce choix). Mais cette monotonie n’est qu’apparente, car Caroline Miller rend aussi très bien le temps qui passe : dans les corps qui se voûtent et les rides qui se creusent, faisant d’un homme ou d’une femme de quarante déjà un vieillard, mais aussi dans les changements presque imperceptibles des arbres qui poussent d’année en année, dans la communauté qui se structure autour d’une église et d’une école…
Et puis Les Saisons et les jours est peut-être plus sombre dans la façon dont il décrit les conditions de vie, car les instants de bonheur semblent bien peu nombreux et bien pâles au regard des difficultés quotidiennes et de la précarité constante. En faisant de Cean le personnage principal et en nous faisant partager ses pensées, on voit aussi à l’œuvre les pensées religieuses, la dichotomie entre les hommes et les femmes. Et puis, en creux, il y a la question de l’esclavage bien sûr. En creux, parce que ces paysans pionniers sont blancs certes, mais pauvres et bien incapables de posséder un esclave. Parce qu’ils ont des liens commerciaux avec la côte, ils connaissent l’existence des grandes plantations et ils envient les blancs qui n’ont pas besoin de travailler, vivent dans la soie et ont des chevaux magnifiques. Les Noirs sont vus comme une partie intégrante de ce système. Parce qu’ils envient les riches propriétaires, ils ne seraient pas contre posséder des esclaves comme eux (mais sont bien conscients de ne pas pouvoir supporter le coût d’une bouche supplémentaire à nourrir…). Et le racisme est le fruit d’une ignorance non feinte : Cean qui se dit que si les Indiens ne veulent pas mourir de faim ils n’ont qu’à se mettre à la culture du coton, ou bien ne pas comprendre que les Noirs qui sortent des bateaux sentent aussi mauvais à l’issue de leur traversée…
C’est un très beau témoignage, que les images d’Epinal de la culture commerciale du coton et de la guerre de Sécession ont complètement occulté. Cela redonne de la profondeur et de la complexité à l’image que je peux me faire du Sud et des Etats-Unis en général. C’est aussi un rappel du caractère véritablement récent de l’histoire (blanche) dans une grande partie de ce pays, d’une réalité tellement différente de ce qu’était notre XIXème siècle en Europe, où, même si l’uniformité n’était pas de mise non plus, l’intégration des réseaux commerciaux et sociaux étaient déjà bien avancée. Je ne sais pas si Les Saisons et les jours est encore considéré comme un classique aux Etats-Unis (il y a à peine plus de lecteurs qui possèdent ce livre sur LibraryThing que sur Babelio !), mais c’est un livre très intéressant, qui apprend beaucoup et qui, même s’il n’y souffle pas le grand vent de l’aventure, a beaucoup à nous dire et à nous apprendre.
Titre original : Lamb in His Bosom


Voilà ce que son mariage lui avait apporté – une pièce silencieuse hormis les voix douces des bébés et le tic-tac pressé d’une pendule. Et elle était satisfaite. Pourquoi avait-elle donc épousé Lonzo si ce n’était pour tenir sa maison et élever ses enfants ?
(p. 197, Chapitre 9).
Les hommes parlaient de l'Afrique, un pays où les gens étaient aussi noirs que des sangliers ; on les amenait en bateau et on les vendait. Mais Jake n'en achèterait pas quand il serait un homme, même s'il avait la poche pleine de pièces d'or. Quelqu'un affirmait qu'une cargaison de ces gens-là puait autant que de la charogne et, par temps calme, ça sentait plus mauvais qu'un troupeau de vaches qu'on aurait abattues et laissées pourrir sur place. Qu'est-ce qui les rendait noirs ? Qu'est-ce qui les faisait puer ?
J’ai entendu parler de ce livre il y a quelques temps déjà lorsque les éditions Belfont ont eu l’idée de le rééditer dans leur collection Vintage, mais je ne l’avais pas lu alors, et c’est seulement lorsque la bibliothèque de mon village l’a sorti de ses réserves dernièrement que je me suis dit qu’il était temps que je lise ce que j’avais vu présenté comme un classique américain méconnu, grandement admiré par Margaret Mitchell (et je viens tout juste de re-regarder Autant en emporte le vent, ça tombe bien…). En fait, d’après la préface de mon édition, du fait de son succès populaire (comme en témoignent les nombreuses rééditions après sa publication) et littéraire (le prix Pulitzer lui est attribué en 1934, une première pour un roman venu de Géorgie), son éditeur a recherché d’autres œuvres d’écrivains géorgiens, et c’est ainsi qu’a été publié Autant en emporte le vent, dont la notoriété éclipsera celle des Saisons et des Jours.
Pourtant, si le marketing littéraire nous incite à comparer ces deux œuvres, ce sont deux romans très différents. Les Saisons et les jours se passe disons une ou deux générations avant les déboires de Scarlett O’Hara, puisqu’au début du roman les échos de la guerre d’indépendance ne sont pas loin. Et puis surtout, Les Saisons et les jours est le roman de l’intérieur de la Géorgie, loin des grandes plantations de coton de la côte (même si l’on y cultive aussi du coton). C’est le roman de l’intérieur, mais aussi des pionniers, puisque les parents de Cean sont venus de la Caroline voisine pour s’installer sur une terre toute juste prise aux Indiens Creeks. En cela, le livre m’a paru plus proche de La Petite Maison dans la Prairie, de Laura Ingalls Wilder, que de Autant en emporte le vent. C’est la même vie en quasi autarcie, la même vie de labeur incessant, la même vie où tout est à construire, pierre à pierre, ou plutôt planche à planche, sillon à sillon. (Et puis le mari de Cean s’appelle Lonzo, diminutif d’Alonzo, et je n’ai pas pu, à chaque fois que je lisais son nom, ne pas penser à Almanzo – raccourci en Manzo, le mari de Laura Ingalls... C’est très probablement une coïncidence vues les dates de publications quasi concomitantes de ces deux livres, mais cela les a encore plus rapproché dans mon esprit).
Mais Les Saisons et les jours n’a pas l’insouciance enfantine de La Petite Maison dans la prairie, car c’est la vie d’une femme que l’on suit, la vie de Cean, depuis le jour de son mariage jusqu’à ses vieux jours. Et c’est toute la monotonie de cette vie que l’on lit dans ces pages, cette monotonie suggérée par le titre choisi pour l’édition française (un titre bien éloigné de son titre original, Lamb in His Bosom, « un agneau sur son sein », une citation de la Bible, dans le Livre d’Isaïe, où il est question de Dieu accueillant et protégeant ses créatures contre lui, mais j’imagine que le lectorat français est moins enclin à lire des livres avec une référence religieuse si explicite, d’où ce choix). Mais cette monotonie n’est qu’apparente, car Caroline Miller rend aussi très bien le temps qui passe : dans les corps qui se voûtent et les rides qui se creusent, faisant d’un homme ou d’une femme de quarante déjà un vieillard, mais aussi dans les changements presque imperceptibles des arbres qui poussent d’année en année, dans la communauté qui se structure autour d’une église et d’une école…
Et puis Les Saisons et les jours est peut-être plus sombre dans la façon dont il décrit les conditions de vie, car les instants de bonheur semblent bien peu nombreux et bien pâles au regard des difficultés quotidiennes et de la précarité constante. En faisant de Cean le personnage principal et en nous faisant partager ses pensées, on voit aussi à l’œuvre les pensées religieuses, la dichotomie entre les hommes et les femmes. Et puis, en creux, il y a la question de l’esclavage bien sûr. En creux, parce que ces paysans pionniers sont blancs certes, mais pauvres et bien incapables de posséder un esclave. Parce qu’ils ont des liens commerciaux avec la côte, ils connaissent l’existence des grandes plantations et ils envient les blancs qui n’ont pas besoin de travailler, vivent dans la soie et ont des chevaux magnifiques. Les Noirs sont vus comme une partie intégrante de ce système. Parce qu’ils envient les riches propriétaires, ils ne seraient pas contre posséder des esclaves comme eux (mais sont bien conscients de ne pas pouvoir supporter le coût d’une bouche supplémentaire à nourrir…). Et le racisme est le fruit d’une ignorance non feinte : Cean qui se dit que si les Indiens ne veulent pas mourir de faim ils n’ont qu’à se mettre à la culture du coton, ou bien ne pas comprendre que les Noirs qui sortent des bateaux sentent aussi mauvais à l’issue de leur traversée…
C’est un très beau témoignage, que les images d’Epinal de la culture commerciale du coton et de la guerre de Sécession ont complètement occulté. Cela redonne de la profondeur et de la complexité à l’image que je peux me faire du Sud et des Etats-Unis en général. C’est aussi un rappel du caractère véritablement récent de l’histoire (blanche) dans une grande partie de ce pays, d’une réalité tellement différente de ce qu’était notre XIXème siècle en Europe, où, même si l’uniformité n’était pas de mise non plus, l’intégration des réseaux commerciaux et sociaux étaient déjà bien avancée. Je ne sais pas si Les Saisons et les jours est encore considéré comme un classique aux Etats-Unis (il y a à peine plus de lecteurs qui possèdent ce livre sur LibraryThing que sur Babelio !), mais c’est un livre très intéressant, qui apprend beaucoup et qui, même s’il n’y souffle pas le grand vent de l’aventure, a beaucoup à nous dire et à nous apprendre.
77raton-liseur
81. 56. (42) Mes Sacrées Tantes de Bulbul Sharma, traduit de l'anglais (Inde) par Mélanie Basnel
Titre original : My Sainted Aunts
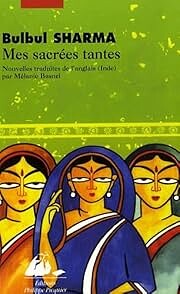

J’avais beaucoup aimé La Colère des aubergines, le premier recueil de Bulbul Sharma paru en France, que j’ai lu en 2021 (merci à mon site de lecture préféré de garder la mémoire de mes lectures pour moi !) et je savais que je voulais continuer à découvrir son œuvre, faite presqu’exclusivement de recueils de nouvelles. Mes Sacrées tantes semblait m’attendre tranquillement sur les étagères d’une librairie d’occasion que j’ai visité le dernier jour des vacances, pour faire quelque chose d’agréable et de rien que pour moi avant de reprendre le chemin de l’école… Et pour une fois, il ne m’a pas fallu trop longtemps entre le moment de mon achat et celui de ma lecture.
On retrouve dans ce livre le même sens de la formule de Bulbul Sharma. Rien que pour le plaisir, voici par exemple l’incipit de la toute première nouvelle : « Le jour de ses soixante-huit, soixante-dix, ou soixante-quinze ans (sa date de naissance était aussi incertaine que ses humeurs), Mayadevi décida de se rendre à Londres. » (Le pèlerinage de Mayadevi). C’est donc une lecture agréable, malgré la dureté de ce qui est décrit.
Et puis, en plaçant bon nombre de ses nouvelles dans la première moitié du XXème siècle, Bulbul Sharma décrit des vies de femmes qui sont encore plus atterrantes que ce que l’on en voit dans des histoires qui se passent plus récemment (même s’il existe probablement des zones où tout cela n’a pas beaucoup changé ou si, malgré bien les différences de pays, de langue et de religion, cela peut nous faire imaginer la vie de certaines femmes en Afghanistan aujourd’hui). On voit des femmes sans une seule once de liberté, complètement à la merci de la volonté de leur père puis de leur mari (en cela, les femmes riches ne sont pas mieux loties que des femmes de la classe moyenne, car ne sortant pas même pour faire des courses ou de la lessive, elle sont encore plus seules et isolées). Bulbul Sharma prend tout de même plaisir à montrer comment ces femmes tentent de secouer ce joug tellement lourd, comment certaines arrivent, grâce à leur immense courage, à se ménager un espace de liberté et d’autonomie.
Les nouvelles sont cependant peut-être moins abouties ou moins originales que dans La Colère des aubergines, et je ne suis pas surprise de m’apercevoir que ce livre, bien que publié en France plus tard, a été écrit avant. C’est encore peut-être celui d’une autrice dont la plume a besoin de s’aguerrir. Ce n’est donc peut-être pas le recueil par lequel commencer, mais il vaut tout de même la lecture et confirme mon intérêt pour cette autrice féministe indienne au talent si particulier.
J’ai toujours été un peu étonnée du prénom de cette autrice, Bulbul, qui me faisait penser à un oiseau tropical. Et effectivement, la page consacrée à l’auteur par Picquier sur son site internet explique que ce surnom lui a été donné dans son enfance. Difficile de réconcilier les nouvelles sombres qui sortent de l’imagination de cette autrice et le chant guilleret de ce petit oiseau, mais j’imagine que parfois il faut avoir beaucoup de joie de vivre pour affronter la dure réalité sans jamais baisser les bras, comme semble le faire Bulbul Sharma depuis des décennies.

Un Bulbul des jardins, je ne sais pas si c’est celui dont Bulbul Sharma tient son surnom, mais il semble être un des bulbuls communs en Inde.
Titre original : My Sainted Aunts
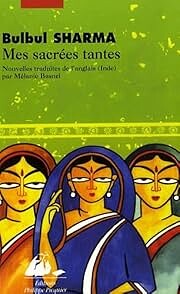

Le père de Mini, propriétaire de quatre hectares de champs fertiles, trente bœufs, vingt vaches et deux femmes, avait fait en sorte que sa fille adorée, cadette de sept garçons, ait un mariage dont on se souviendrait jusqu’à la fin des temps.
(p. 87, “Une très jeune mariée”).
J’avais beaucoup aimé La Colère des aubergines, le premier recueil de Bulbul Sharma paru en France, que j’ai lu en 2021 (merci à mon site de lecture préféré de garder la mémoire de mes lectures pour moi !) et je savais que je voulais continuer à découvrir son œuvre, faite presqu’exclusivement de recueils de nouvelles. Mes Sacrées tantes semblait m’attendre tranquillement sur les étagères d’une librairie d’occasion que j’ai visité le dernier jour des vacances, pour faire quelque chose d’agréable et de rien que pour moi avant de reprendre le chemin de l’école… Et pour une fois, il ne m’a pas fallu trop longtemps entre le moment de mon achat et celui de ma lecture.
On retrouve dans ce livre le même sens de la formule de Bulbul Sharma. Rien que pour le plaisir, voici par exemple l’incipit de la toute première nouvelle : « Le jour de ses soixante-huit, soixante-dix, ou soixante-quinze ans (sa date de naissance était aussi incertaine que ses humeurs), Mayadevi décida de se rendre à Londres. » (Le pèlerinage de Mayadevi). C’est donc une lecture agréable, malgré la dureté de ce qui est décrit.
Et puis, en plaçant bon nombre de ses nouvelles dans la première moitié du XXème siècle, Bulbul Sharma décrit des vies de femmes qui sont encore plus atterrantes que ce que l’on en voit dans des histoires qui se passent plus récemment (même s’il existe probablement des zones où tout cela n’a pas beaucoup changé ou si, malgré bien les différences de pays, de langue et de religion, cela peut nous faire imaginer la vie de certaines femmes en Afghanistan aujourd’hui). On voit des femmes sans une seule once de liberté, complètement à la merci de la volonté de leur père puis de leur mari (en cela, les femmes riches ne sont pas mieux loties que des femmes de la classe moyenne, car ne sortant pas même pour faire des courses ou de la lessive, elle sont encore plus seules et isolées). Bulbul Sharma prend tout de même plaisir à montrer comment ces femmes tentent de secouer ce joug tellement lourd, comment certaines arrivent, grâce à leur immense courage, à se ménager un espace de liberté et d’autonomie.
Les nouvelles sont cependant peut-être moins abouties ou moins originales que dans La Colère des aubergines, et je ne suis pas surprise de m’apercevoir que ce livre, bien que publié en France plus tard, a été écrit avant. C’est encore peut-être celui d’une autrice dont la plume a besoin de s’aguerrir. Ce n’est donc peut-être pas le recueil par lequel commencer, mais il vaut tout de même la lecture et confirme mon intérêt pour cette autrice féministe indienne au talent si particulier.
J’ai toujours été un peu étonnée du prénom de cette autrice, Bulbul, qui me faisait penser à un oiseau tropical. Et effectivement, la page consacrée à l’auteur par Picquier sur son site internet explique que ce surnom lui a été donné dans son enfance. Difficile de réconcilier les nouvelles sombres qui sortent de l’imagination de cette autrice et le chant guilleret de ce petit oiseau, mais j’imagine que parfois il faut avoir beaucoup de joie de vivre pour affronter la dure réalité sans jamais baisser les bras, comme semble le faire Bulbul Sharma depuis des décennies.

Un Bulbul des jardins, je ne sais pas si c’est celui dont Bulbul Sharma tient son surnom, mais il semble être un des bulbuls communs en Inde.
78raton-liseur
82. 57. (43) Requiem pour un paysan espagnol de Ramón J. Sender, traduit de l'espagnol par Jean-Paul Cortada
Titre original : Réquiem por un campesino español, initialement paru sous le titre Mosén Millán
Titre en anglais : Requiem for a Spanish Peasant


Je cherchais Hommage à la Catalogne d’Orwell dans une librairie d’occasion hier, que je n’ai pas trouvé, mais comme le libraire m’a dit de regarder aussi au rayon histoire de l’Espagne, je suis tombée sur ce livre, dont j’avais déjà entendu parler et puisque c’est un classique et qu’il parle de la même période, je me suis laissée tenter… Et comme il me fallait choisir un nouveau livre, j’en ai commencé la lecture dès hier soir. Une lecture courte puisque la traduction ne fait même pas cent pages dans mon édition (bilingue, mais le vocabulaire religieux et les mots de parler vernaculaire ne me permettent pas de le lire en espagnol. D’ailleurs, vues les notes, le ou la précédent(e) propriétaire n’est pas allé au-delà de la deuxième page de la version originale. J’espère qu’il ou elle a au moins pu lire – et apprécier – la version française, placée en tête dans ce livre) et me voilà donc déjà en train de rédiger cette note de lecture pour ce texte court mais fort.
Pas de mots en trop, au contraire, beaucoup d’ellipses dans les souvenirs de ce prêtre, Mosén Millán, qui se remémore la vie de Paco, pour qui il s’apprête à célébrer une messe de requiem. On suit en parallèle, et sans transition, les préparatifs et les allées et venues de l’enfant de chœur d’un côté et les souvenirs plein de tristesse et d’amertume du prêtre. C’est d’abord la vie dans un petit village d’Aragon qui se dévoile sous nos yeux, puis la grande histoire s’invite avec les échos des soubresauts des bouleversements qui agitent Madrid : le roi fuit, des élections municipales sont organisées… Tout à coup, il semble que des changements soient possibles, que la pauvreté ne soit plus une fatalité ou un dessein divin… Et certains s’engouffrent dans la brèche ainsi ouverte, mais on ne refuse pas de payer le fermage sans conséquence, et celles-ci ne tardent pas à se faire sentir, avec leur cortège de violences qui s’abattent sans distinction. Cette période des tous débuts de la Seconde République Espagnole est rarement évoquée dans la littérature, tout du moins dans la littérature que j’ai croisée jusqu’à présent, et rien que pour cela déjà ce livre est intéressant.
Mais il l’est aussi par plein d’autres aspects. La façon dont il est écrit, avec ses phrases courtes qui suggèrent plus qu’elles ne disent, et qui sont en cela d’une efficacité redoutable. L’absence de détails (pas de nom pour ce village, pas de date pour cette histoire) qui permet au drame de dépasser le contexte géographique et historique auquel il est pourtant lié. La tragédie qui se dessine, avec cette opposition éternelle entre une soif de justice sociale et des inégalités ancrées dans le lointain passé (le Paco de Sender n’est pas loin en cela du Figaro de Beaumarchais, même s’il sera moins chanceux quant à l’issue de son combat). Et puis bien sûr, nous lecteurs tout comme Ramón J. Sender auteur, nous connaissons le sort qui sera fait à cette République et aux espoirs qu’elle incarnait, alors on ne peut s’empêcher de voir dans ce requiem la prémonition de tout ce qui arrivera dans les années suivantes. Ce n’est pas encore la Guerre Civile, mais tous les acteurs sont déjà là, et ceux qui gagneront sont déjà en position de force.
Enfin, dans les dernières pages, je n’ai pu m’empêcher de penser au tableau de Goya, « Tres de mayo ». Bien sûr c’est un anachronisme puisque Paco, le paysan espagnol de notre histoire, sera exécuté plus de cent ans après ce qui est décrit dans ce tableau, mais c’est exactement la même scène : le même mur, la même nuit, la même lumière, la même population mi-assoupie mi-terrée chez elle, et la même incompréhension et le même désespoir dans les yeux des fusillés. La même figure un peu christique aussi, comme l’agneau immolé sur l’autel des privilèges et du conservatisme.
Un très beau texte, court et fort, qui mériterait d’être plus connu et plus lu, et qui a toute sa place parmi les classiques de la littérature espagnole contemporaine et les classiques sur la Guerre civile espagnole.
Voici une reproduction du tableau dont je parle dans cette note de lecture, « Tres de mayo », faisant à la répression du soulèvement du Dos de mayo, lorsque, en 1808, les madrilènes se sont rebellé contre l’occupation de la ville par les Français. Ce tableau, peint par Goya en 1814, est une de ses œuvres les plus célèbre. Il est exposé au musée du Prado, à Madrid.

Titre original : Réquiem por un campesino español, initialement paru sous le titre Mosén Millán
Titre en anglais : Requiem for a Spanish Peasant


Je cherchais Hommage à la Catalogne d’Orwell dans une librairie d’occasion hier, que je n’ai pas trouvé, mais comme le libraire m’a dit de regarder aussi au rayon histoire de l’Espagne, je suis tombée sur ce livre, dont j’avais déjà entendu parler et puisque c’est un classique et qu’il parle de la même période, je me suis laissée tenter… Et comme il me fallait choisir un nouveau livre, j’en ai commencé la lecture dès hier soir. Une lecture courte puisque la traduction ne fait même pas cent pages dans mon édition (bilingue, mais le vocabulaire religieux et les mots de parler vernaculaire ne me permettent pas de le lire en espagnol. D’ailleurs, vues les notes, le ou la précédent(e) propriétaire n’est pas allé au-delà de la deuxième page de la version originale. J’espère qu’il ou elle a au moins pu lire – et apprécier – la version française, placée en tête dans ce livre) et me voilà donc déjà en train de rédiger cette note de lecture pour ce texte court mais fort.
Pas de mots en trop, au contraire, beaucoup d’ellipses dans les souvenirs de ce prêtre, Mosén Millán, qui se remémore la vie de Paco, pour qui il s’apprête à célébrer une messe de requiem. On suit en parallèle, et sans transition, les préparatifs et les allées et venues de l’enfant de chœur d’un côté et les souvenirs plein de tristesse et d’amertume du prêtre. C’est d’abord la vie dans un petit village d’Aragon qui se dévoile sous nos yeux, puis la grande histoire s’invite avec les échos des soubresauts des bouleversements qui agitent Madrid : le roi fuit, des élections municipales sont organisées… Tout à coup, il semble que des changements soient possibles, que la pauvreté ne soit plus une fatalité ou un dessein divin… Et certains s’engouffrent dans la brèche ainsi ouverte, mais on ne refuse pas de payer le fermage sans conséquence, et celles-ci ne tardent pas à se faire sentir, avec leur cortège de violences qui s’abattent sans distinction. Cette période des tous débuts de la Seconde République Espagnole est rarement évoquée dans la littérature, tout du moins dans la littérature que j’ai croisée jusqu’à présent, et rien que pour cela déjà ce livre est intéressant.
Mais il l’est aussi par plein d’autres aspects. La façon dont il est écrit, avec ses phrases courtes qui suggèrent plus qu’elles ne disent, et qui sont en cela d’une efficacité redoutable. L’absence de détails (pas de nom pour ce village, pas de date pour cette histoire) qui permet au drame de dépasser le contexte géographique et historique auquel il est pourtant lié. La tragédie qui se dessine, avec cette opposition éternelle entre une soif de justice sociale et des inégalités ancrées dans le lointain passé (le Paco de Sender n’est pas loin en cela du Figaro de Beaumarchais, même s’il sera moins chanceux quant à l’issue de son combat). Et puis bien sûr, nous lecteurs tout comme Ramón J. Sender auteur, nous connaissons le sort qui sera fait à cette République et aux espoirs qu’elle incarnait, alors on ne peut s’empêcher de voir dans ce requiem la prémonition de tout ce qui arrivera dans les années suivantes. Ce n’est pas encore la Guerre Civile, mais tous les acteurs sont déjà là, et ceux qui gagneront sont déjà en position de force.
Enfin, dans les dernières pages, je n’ai pu m’empêcher de penser au tableau de Goya, « Tres de mayo ». Bien sûr c’est un anachronisme puisque Paco, le paysan espagnol de notre histoire, sera exécuté plus de cent ans après ce qui est décrit dans ce tableau, mais c’est exactement la même scène : le même mur, la même nuit, la même lumière, la même population mi-assoupie mi-terrée chez elle, et la même incompréhension et le même désespoir dans les yeux des fusillés. La même figure un peu christique aussi, comme l’agneau immolé sur l’autel des privilèges et du conservatisme.
Un très beau texte, court et fort, qui mériterait d’être plus connu et plus lu, et qui a toute sa place parmi les classiques de la littérature espagnole contemporaine et les classiques sur la Guerre civile espagnole.
Voici une reproduction du tableau dont je parle dans cette note de lecture, « Tres de mayo », faisant à la répression du soulèvement du Dos de mayo, lorsque, en 1808, les madrilènes se sont rebellé contre l’occupation de la ville par les Français. Ce tableau, peint par Goya en 1814, est une de ses œuvres les plus célèbre. Il est exposé au musée du Prado, à Madrid.

79raton-liseur
83. 58. (44) La Montgolfière de Willa Cather, traduit de l'anglais par Victor Llona
Titre original : Coming, Aphrodite!


J’ai découvert il y a de cela trois ans (merci à ce site pour sa mémoire plus fiable que la mienne en la matière !) Willa Cather, un nom qui m’était jusqu’alors complètement inconnu, avec O Pionners! (platement traduit Pionniers en français), et j’étais heureuse de prendre enfin le temps de la retrouver au gré de ce court roman trouvé par hasard sur les étagères d’une de mes librairies d’occasion préférées. Il y avait deux titres, et je me suis laissée tenter par les deux malgré ma « politique » de ne pas avoir plus d’un livre non lu d’un même auteur sur mes étagères. Mais bon, c’est de l’occasion, justement l’occasion ne se représentera peut-être pas, et les règles sont faites aussi pour qu’on y fasse des entorses.
Ce livre était mon deuxième choix, mais j’étais curieuse de ce que Willa Cather pouvait écrire dans un contexte urbain, puisque ce livre se passe à New York, dans le milieu bohème et artistique des années 20 (de celles du siècle passé, le XXème…).
Certes, il y a une réflexion sur ce qu’est l’art, la célébrité, et le lien entre les deux qui est bien moins évident qu’on ne pourrait le penser ou qu’on ne voudrait nous le faire croire. Mais je n’ai pas trouvé la relation entre les deux personnages très crédible, la fin est un peu trop rapide et puis je dois avouer que je n’ai pas trop compris l’importance de l’épisode de montgolfière (enfin si, je l’ai compris puisque c’est tout simplement une matérialisation de la différence de la façon dont les deux principaux personnages envisagent leur relation à la vie, mais je n’ai pas forcément vu le lien avec leur art par exemple). D’ailleurs, c’est amusant de voir que le titre français fait référence à cette épisode (certes central dans ce petit roman), alors que le titre anglais est plus énigmatique, « Coming Aphrodite! » (encore avec un point d’interrogation, Willa Cather a l’air de les aimer dans ses titres !), une référence je pense aux Aphrodite célèbres de la peinture, puisqu’un de nos personnages, Don Hedger est peintre et l’autre, Eden Bower de son nom de scène, est chanteuse et belle comme une déesse.
Un roman très court, qui me permet donc de découvrir une autre facette de Willa Cather, mais ce fut une lecture bien moins intéressante que la précédente. Je crois qu’il faut que je retourne à la Willa Cather des grands espaces, et fort heureusement, l’autre bouquin que j’ai d’elle sur mes étagères (et qui est maintenant le seul non lu de cette autrice, si je ne compte pas les livres électroniques gratuits sur ma liseuse…) a l’air plus dans la veine de ce que j’aime. Lecture à suivre, donc !
Titre original : Coming, Aphrodite!


J’ai découvert il y a de cela trois ans (merci à ce site pour sa mémoire plus fiable que la mienne en la matière !) Willa Cather, un nom qui m’était jusqu’alors complètement inconnu, avec O Pionners! (platement traduit Pionniers en français), et j’étais heureuse de prendre enfin le temps de la retrouver au gré de ce court roman trouvé par hasard sur les étagères d’une de mes librairies d’occasion préférées. Il y avait deux titres, et je me suis laissée tenter par les deux malgré ma « politique » de ne pas avoir plus d’un livre non lu d’un même auteur sur mes étagères. Mais bon, c’est de l’occasion, justement l’occasion ne se représentera peut-être pas, et les règles sont faites aussi pour qu’on y fasse des entorses.
Ce livre était mon deuxième choix, mais j’étais curieuse de ce que Willa Cather pouvait écrire dans un contexte urbain, puisque ce livre se passe à New York, dans le milieu bohème et artistique des années 20 (de celles du siècle passé, le XXème…).
Certes, il y a une réflexion sur ce qu’est l’art, la célébrité, et le lien entre les deux qui est bien moins évident qu’on ne pourrait le penser ou qu’on ne voudrait nous le faire croire. Mais je n’ai pas trouvé la relation entre les deux personnages très crédible, la fin est un peu trop rapide et puis je dois avouer que je n’ai pas trop compris l’importance de l’épisode de montgolfière (enfin si, je l’ai compris puisque c’est tout simplement une matérialisation de la différence de la façon dont les deux principaux personnages envisagent leur relation à la vie, mais je n’ai pas forcément vu le lien avec leur art par exemple). D’ailleurs, c’est amusant de voir que le titre français fait référence à cette épisode (certes central dans ce petit roman), alors que le titre anglais est plus énigmatique, « Coming Aphrodite! » (encore avec un point d’interrogation, Willa Cather a l’air de les aimer dans ses titres !), une référence je pense aux Aphrodite célèbres de la peinture, puisqu’un de nos personnages, Don Hedger est peintre et l’autre, Eden Bower de son nom de scène, est chanteuse et belle comme une déesse.
Un roman très court, qui me permet donc de découvrir une autre facette de Willa Cather, mais ce fut une lecture bien moins intéressante que la précédente. Je crois qu’il faut que je retourne à la Willa Cather des grands espaces, et fort heureusement, l’autre bouquin que j’ai d’elle sur mes étagères (et qui est maintenant le seul non lu de cette autrice, si je ne compte pas les livres électroniques gratuits sur ma liseuse…) a l’air plus dans la veine de ce que j’aime. Lecture à suivre, donc !
80labfs39
>76 raton-liseur: Despite being American, I have never heard of this book or author, but I do read less American literature than many.
>78 raton-liseur: I am currently reading a book set during the Spanish Civil War, and I'm realizing just how little Spanish history I know.
>79 raton-liseur: Willa Cather is one of the American authors who gives me an instant feeling of distaste whenever I think of her. To be fair, I have not read her since college when I took an American literature class with a teacher I did not like. I dislike all the authors we read in that class (Cather, Dreiser, Roth), but I am unsure whether it was because of the professor, the time period of American literature, or the authors. Incredibly biased of me, I know, but I have no desire to revisit them when their are so many other books calling my name. Even Dan/dchaikin's recent love affair with Cather's works cannot dissuade me!
>78 raton-liseur: I am currently reading a book set during the Spanish Civil War, and I'm realizing just how little Spanish history I know.
>79 raton-liseur: Willa Cather is one of the American authors who gives me an instant feeling of distaste whenever I think of her. To be fair, I have not read her since college when I took an American literature class with a teacher I did not like. I dislike all the authors we read in that class (Cather, Dreiser, Roth), but I am unsure whether it was because of the professor, the time period of American literature, or the authors. Incredibly biased of me, I know, but I have no desire to revisit them when their are so many other books calling my name. Even Dan/dchaikin's recent love affair with Cather's works cannot dissuade me!
81raton-liseur
>80 labfs39: Part of the marketing strategy around Les Saisons et les jours / Lamb in His Bosom is to say that it is a forgotten classic, so you prove them right! Nevertheless, it won the Pulitzer in 1934 (two years before Autant en emporte le vent / Gone with the wind was published), so it had some real success at that time.
I just bought another Spanish book on the Spanish Civil War!... But there are a lot of classics around this period of time that I have not read yet, notably L'espoir / Man's Hope by Malraux and Hommage à la Catalogne / Homage to Catalonia by Orwell. I have read a few other books, but it is a fascinating historical period so you can’t read too much, and it's hard to differentiate facts and myths, as this historical events have been a great factory of myths and legends. The interest about the Spanish Civil War might be stronger in France, as the exile of defeated Republicans was an important trend just before the second world war, and there is a multi-layered link between those two conflicts.
Too bad on the Willa Cather front. I had never heard about her before Dan’s reading marathon a few years ago, and I really enjoyed Pioneers!. But I totally get your point and if you miss on her, you’ll find a lot of other gems on your reading path!
I just bought another Spanish book on the Spanish Civil War!... But there are a lot of classics around this period of time that I have not read yet, notably L'espoir / Man's Hope by Malraux and Hommage à la Catalogne / Homage to Catalonia by Orwell. I have read a few other books, but it is a fascinating historical period so you can’t read too much, and it's hard to differentiate facts and myths, as this historical events have been a great factory of myths and legends. The interest about the Spanish Civil War might be stronger in France, as the exile of defeated Republicans was an important trend just before the second world war, and there is a multi-layered link between those two conflicts.
Too bad on the Willa Cather front. I had never heard about her before Dan’s reading marathon a few years ago, and I really enjoyed Pioneers!. But I totally get your point and if you miss on her, you’ll find a lot of other gems on your reading path!
82raton-liseur
84. 59. (-) Les Voisins, et autres nouvelles de Diane Oliver, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marguerite Capelle
Titre original : Neighbors and Other Stories


Merci aux éditions Buchet/Chastel de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
Ce livre est probablement le seul qu’on lira de Diane Oliver, car cette autrice des années 60 est morte bien trop tôt, à l’âge de 23 ans dans un accident de la route. Malgré cela, elle nous a laissé une collection d’une douzaine de nouvelles, dont seulement quatre ont été publiées de son vivant, dont la nouvelle titre de ce livre.
L’éditeur tente une promotion hasardeuse en comparant cette écrivaine en formation à un James Baldwin ou à une Zora Neale Hurston, d’une part parce que ce sont deux grandes pointures de la littérature noire américaine du XXème siècle, donc la comparaison met la barre très haut, et d’autre part parce qu’ils ont quand même un lectorat assez limité en France, et donc je ne sais pas si la référence parlera à beaucoup (peut-être un peu quand même puisque l’on fête – modestement – le centenaire de la naissance de Baldwin cette année. Promotion hasardeuse, donc peut-être, mais je crois que c’est le choix de la couverture qui moi m’a attirée. Je vois deux visuels sui traînent sur internet : celui directement copié de l’édition américaine, avec deux personnes affalées sur un fauteuil, pas mal certes, mais une autre choisie par Buchet/Chastel pour l’édition française, avec une fille dans les bras de sa mère, toutes les deux regardant le futur lecteur droit dans les yeux, avec un visage indéchiffrable, marqué d’un immense sérieux. Le visage de la petite semble comme un défi, elle semble nous dire qu’elle ne voit tout simplement pas pourquoi elle devrait s’excuser de vivre.
Ah oui, j’ai « oublié » de dire que sur ces deux couvertures, tous les personnages sont noirs. Parce que, dans la plupart des nouvelles de Diane Oliver, les personnages principaux sont noirs, mais pas toujours, et très souvent, elle ne le mentionne même pas, au lecteur de voir si c’est parce que c’est évident ou si c’est parce que cela ne devrait tout simplement pas être une information pertinente. Et en fait, cela rend ces nouvelles bien plus fortes parce que oui, en fonction des conditions de vie des personnages (leur lieu de vie, leur travail, leur accès à l’école ou aux soins, …), il est triste de constater que ce n’est pas la peine de dire qu’ils sont noirs, et c’est là que l’on se rend compte d’à quel point la ségrégation est implantée dans les pratiques et dans les mœurs. Ce n’est pas « Je suis noir donc je suis traité ainsi », mais bien « je suis traité ainsi donc il est évident que je suis noir », et si l’on y réfléchit un peu, ce n’est pas du tout la même chose…
Ces nouvelles sont donc très profondément ancrées dans leur temps (peu avant ou peu après la fin de l’abolition de la ségrégation raciale dans le Sud des Etats-Unis. Ce n’est pas un livre militant ou à thèse en soi, c’est un livre qui ne fait que constater ce que cette ségrégation signifie au quotidien, comme par exemple dans la nouvelle « Le Dispensaire », tellement triviale qu’elle en serre le cœur. Elle s’intéresse aussi à ce que s’investir pour la lutte contre les droits civiques veut dire d’un point de vue personnel ou familial. « Les Voisins » donne la parole à des parents face à leurs choix éducatifs : faire de son enfant le premier noir dans une école qui n’a pas abandonné les thèses confédérées, c’est un grand pas pour la cause noire, mais qu’est-ce que cela fait à un petit garçon, et qu’est-ce que cela fait ou dit de ses parents ? « Le Placard du dernier étage » nous fait côtoyer une jeune fille de 20 ans qui n’en peut plus d’être depuis des années la première Noire à faire ceci, la première Noire à faire cela… D’autres nouvelles montrent les parents qui s’inquiètent pour leurs enfants qui s’engagent politiquement, quitte à prendre des risques physiques ou tout simplement à mettre leur avenir en danger (manquer l’université, risquer de se voir retirer sa bourse d’étude…), comme dans « Au crépuscule » ou « Quand les pommes sont mûres ».
D’autres nouvelles montrent la ségrégation ou le racisme de façon décalée, comme la surprenante « Ici on ne sert pas de mint julep » (dont je n’ai d’ailleurs pas compris le titre, je ne dois pas avoir la ref. comme dirait M’ni Raton) qui se passe au fond des bois ou « Banago Kalt » qui, elle, se passe en Suisse lors d’un séjour d’échange.
Toutes les nouvelles ne sont pas de la même qualité, certaines non publiées auraient pu être un peu plus travaillées, mais la plupart m’ont vraiment beaucoup plu, par leur façon de regarder la question de la condition Noire de façon intime et décalée et, si la plupart des nouvelles traitent du même sujet, c’est toujours d’une façon originale et personnelle qui renouvelle toujours l’intérêt. Et puis, il faut le dire, quand même, l’humour très pince-sans-rire de Diane Oliver, ses petites sorties qui, l’air de rien, appuient là où le bas blessent, tout cela rend la lecture très réjouissante malgré la difficulté du sujet (comme la jeune fille qui doit décider de ce qu’elle va étudier à l’université. Elle ferait bien théâtre, mais elle ne se voit pas jouer la bonne dans toutes les pièces pendant les quatre du cursus…).
Tout cela pour dire, donc, que ce recueil de nouvelles vaut vraiment le coup que l’on s’y arrête. On peut y trouver une voix très personnelle et qui m’a semblé différente de ce que j’ai lu jusqu’à présent sur cette période. Un livre qui fait regretter qu’il reste le seul de la biographie de cette autrice qui était encore en devenir et pourtant déjà passionnante. Une très belle redécouverte récente (ce recueil n’a été publié qu’en ce début d’année aux Etats-Unis suite au travail de fourmi d’une employée d’une agence littéraire), que les éditions Buchet/Chastel ont eu la bonne idée de mettre à leur catalogue dès cette rentrée littéraire.
Titre original : Neighbors and Other Stories

Un jour ou l’autre, ils finiront par abolir la ségrégation partout, bien sûr. Je le sais. Mais quand on est raisonnable et qu’on a un avenir, on ne s’en mêle pas.
(p. 132, “Quand les pommes sont mûres”).
Merci aux éditions Buchet/Chastel de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
Ce livre est probablement le seul qu’on lira de Diane Oliver, car cette autrice des années 60 est morte bien trop tôt, à l’âge de 23 ans dans un accident de la route. Malgré cela, elle nous a laissé une collection d’une douzaine de nouvelles, dont seulement quatre ont été publiées de son vivant, dont la nouvelle titre de ce livre.
L’éditeur tente une promotion hasardeuse en comparant cette écrivaine en formation à un James Baldwin ou à une Zora Neale Hurston, d’une part parce que ce sont deux grandes pointures de la littérature noire américaine du XXème siècle, donc la comparaison met la barre très haut, et d’autre part parce qu’ils ont quand même un lectorat assez limité en France, et donc je ne sais pas si la référence parlera à beaucoup (peut-être un peu quand même puisque l’on fête – modestement – le centenaire de la naissance de Baldwin cette année. Promotion hasardeuse, donc peut-être, mais je crois que c’est le choix de la couverture qui moi m’a attirée. Je vois deux visuels sui traînent sur internet : celui directement copié de l’édition américaine, avec deux personnes affalées sur un fauteuil, pas mal certes, mais une autre choisie par Buchet/Chastel pour l’édition française, avec une fille dans les bras de sa mère, toutes les deux regardant le futur lecteur droit dans les yeux, avec un visage indéchiffrable, marqué d’un immense sérieux. Le visage de la petite semble comme un défi, elle semble nous dire qu’elle ne voit tout simplement pas pourquoi elle devrait s’excuser de vivre.
Ah oui, j’ai « oublié » de dire que sur ces deux couvertures, tous les personnages sont noirs. Parce que, dans la plupart des nouvelles de Diane Oliver, les personnages principaux sont noirs, mais pas toujours, et très souvent, elle ne le mentionne même pas, au lecteur de voir si c’est parce que c’est évident ou si c’est parce que cela ne devrait tout simplement pas être une information pertinente. Et en fait, cela rend ces nouvelles bien plus fortes parce que oui, en fonction des conditions de vie des personnages (leur lieu de vie, leur travail, leur accès à l’école ou aux soins, …), il est triste de constater que ce n’est pas la peine de dire qu’ils sont noirs, et c’est là que l’on se rend compte d’à quel point la ségrégation est implantée dans les pratiques et dans les mœurs. Ce n’est pas « Je suis noir donc je suis traité ainsi », mais bien « je suis traité ainsi donc il est évident que je suis noir », et si l’on y réfléchit un peu, ce n’est pas du tout la même chose…
Ces nouvelles sont donc très profondément ancrées dans leur temps (peu avant ou peu après la fin de l’abolition de la ségrégation raciale dans le Sud des Etats-Unis. Ce n’est pas un livre militant ou à thèse en soi, c’est un livre qui ne fait que constater ce que cette ségrégation signifie au quotidien, comme par exemple dans la nouvelle « Le Dispensaire », tellement triviale qu’elle en serre le cœur. Elle s’intéresse aussi à ce que s’investir pour la lutte contre les droits civiques veut dire d’un point de vue personnel ou familial. « Les Voisins » donne la parole à des parents face à leurs choix éducatifs : faire de son enfant le premier noir dans une école qui n’a pas abandonné les thèses confédérées, c’est un grand pas pour la cause noire, mais qu’est-ce que cela fait à un petit garçon, et qu’est-ce que cela fait ou dit de ses parents ? « Le Placard du dernier étage » nous fait côtoyer une jeune fille de 20 ans qui n’en peut plus d’être depuis des années la première Noire à faire ceci, la première Noire à faire cela… D’autres nouvelles montrent les parents qui s’inquiètent pour leurs enfants qui s’engagent politiquement, quitte à prendre des risques physiques ou tout simplement à mettre leur avenir en danger (manquer l’université, risquer de se voir retirer sa bourse d’étude…), comme dans « Au crépuscule » ou « Quand les pommes sont mûres ».
D’autres nouvelles montrent la ségrégation ou le racisme de façon décalée, comme la surprenante « Ici on ne sert pas de mint julep » (dont je n’ai d’ailleurs pas compris le titre, je ne dois pas avoir la ref. comme dirait M’ni Raton) qui se passe au fond des bois ou « Banago Kalt » qui, elle, se passe en Suisse lors d’un séjour d’échange.
Toutes les nouvelles ne sont pas de la même qualité, certaines non publiées auraient pu être un peu plus travaillées, mais la plupart m’ont vraiment beaucoup plu, par leur façon de regarder la question de la condition Noire de façon intime et décalée et, si la plupart des nouvelles traitent du même sujet, c’est toujours d’une façon originale et personnelle qui renouvelle toujours l’intérêt. Et puis, il faut le dire, quand même, l’humour très pince-sans-rire de Diane Oliver, ses petites sorties qui, l’air de rien, appuient là où le bas blessent, tout cela rend la lecture très réjouissante malgré la difficulté du sujet (comme la jeune fille qui doit décider de ce qu’elle va étudier à l’université. Elle ferait bien théâtre, mais elle ne se voit pas jouer la bonne dans toutes les pièces pendant les quatre du cursus…).
Tout cela pour dire, donc, que ce recueil de nouvelles vaut vraiment le coup que l’on s’y arrête. On peut y trouver une voix très personnelle et qui m’a semblé différente de ce que j’ai lu jusqu’à présent sur cette période. Un livre qui fait regretter qu’il reste le seul de la biographie de cette autrice qui était encore en devenir et pourtant déjà passionnante. Une très belle redécouverte récente (ce recueil n’a été publié qu’en ce début d’année aux Etats-Unis suite au travail de fourmi d’une employée d’une agence littéraire), que les éditions Buchet/Chastel ont eu la bonne idée de mettre à leur catalogue dès cette rentrée littéraire.
83raton-liseur
85. 12g. (-) Intrus à l'Etrange de Simon Hureau
Titre en anglais : non traduit


Merci aux éditions La Boîte à Bulles de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
Après quelques lectures plutôt intenses et sombres, j’avais envie de quelque chose de plus léger, quand les éditions de La Boîte à Bulles ont proposé ce livre sur netgalley. Coïncidence, quelques jours avant j’avais emprunté (et je n’ai pas encore lu !) L’Oasis, du même auteur. Je me suis dit qu’un petit polar rural avec de beaux dessins était exactement ce dont j’avais besoin, et je me suis laissée tenter.
Pour donner un peu de contexte, il me faut préciser que cette bd est en fait une nouvelle édition de la bd publiée par Simon Hureau en 2011 sous le même titre, et qui a gagné le Fauve Polar au festival d’Angoulême en 2012. Simon Hureau et son éditeur profite ainsi de l’engouement pour L’Oasis (qu’une fois encore, je n’ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder !) pour programmer cette réédition, mais pour apporter quelque chose de nouveau, c’est cette fois une version couleur qui nous est proposée.
Il m’est un peu difficile de parler du dessin puisque, netgalley oblige, c’est une lecture sur écran que j’ai faite, mais il m’a semblé que les couleurs étaient moins douces que dans L’Oasis, et moins douces aussi que sur la couverture. J’en ai été un peu embêtée car cette douceur faisait partie de ce qui m’avait initialement attirée vers cet auteur.
Pour ce qui est de l’histoire, je dois avouer avoir été assez déroutée par ce livre qui m’a emmenée le long de pistes auxquelles je ne m’attendais pas. J’imaginais un polar rural, dans une campagne où le principal problème est la disparition des services publics (allez, faisons un peu d’actualité) et la désertification. Mais non, ici c’est bien la Creuse profonde et isolée et dans une certaine mesure fière de l’être, mais c’est aussi la Creuse des militaires et des marginaux, une combinaison qui donne parfois de drôles de résultats. On arrive donc dans une histoire qu’il m’est difficile de qualifier de polar, déjà, et puis qui mélange un peu tous les genres, tout en se tenant plutôt bien et en suivant un développement cohérent bien que déroutant. C’est donc une bd un peu spéciale (le titre aurait dû me mettre la puce à l’oreille...), plutôt glauque aussi, et dans laquelle on n’a pas les réponses à toutes les questions de départ. Si l’on est prêt à ce genre d’ambiance et à ce genre d’étrangeté, alors on peut foncer, car ce sera une chouette lecture, originale et sombre tout en, même si cela paraît paradoxal, restant légère. Pour paraphraser le titre, un étrange objet littéraire et graphique, donc.
Titre en anglais : non traduit


Merci aux éditions La Boîte à Bulles de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
Après quelques lectures plutôt intenses et sombres, j’avais envie de quelque chose de plus léger, quand les éditions de La Boîte à Bulles ont proposé ce livre sur netgalley. Coïncidence, quelques jours avant j’avais emprunté (et je n’ai pas encore lu !) L’Oasis, du même auteur. Je me suis dit qu’un petit polar rural avec de beaux dessins était exactement ce dont j’avais besoin, et je me suis laissée tenter.
Pour donner un peu de contexte, il me faut préciser que cette bd est en fait une nouvelle édition de la bd publiée par Simon Hureau en 2011 sous le même titre, et qui a gagné le Fauve Polar au festival d’Angoulême en 2012. Simon Hureau et son éditeur profite ainsi de l’engouement pour L’Oasis (qu’une fois encore, je n’ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder !) pour programmer cette réédition, mais pour apporter quelque chose de nouveau, c’est cette fois une version couleur qui nous est proposée.
Il m’est un peu difficile de parler du dessin puisque, netgalley oblige, c’est une lecture sur écran que j’ai faite, mais il m’a semblé que les couleurs étaient moins douces que dans L’Oasis, et moins douces aussi que sur la couverture. J’en ai été un peu embêtée car cette douceur faisait partie de ce qui m’avait initialement attirée vers cet auteur.
Pour ce qui est de l’histoire, je dois avouer avoir été assez déroutée par ce livre qui m’a emmenée le long de pistes auxquelles je ne m’attendais pas. J’imaginais un polar rural, dans une campagne où le principal problème est la disparition des services publics (allez, faisons un peu d’actualité) et la désertification. Mais non, ici c’est bien la Creuse profonde et isolée et dans une certaine mesure fière de l’être, mais c’est aussi la Creuse des militaires et des marginaux, une combinaison qui donne parfois de drôles de résultats. On arrive donc dans une histoire qu’il m’est difficile de qualifier de polar, déjà, et puis qui mélange un peu tous les genres, tout en se tenant plutôt bien et en suivant un développement cohérent bien que déroutant. C’est donc une bd un peu spéciale (le titre aurait dû me mettre la puce à l’oreille...), plutôt glauque aussi, et dans laquelle on n’a pas les réponses à toutes les questions de départ. Si l’on est prêt à ce genre d’ambiance et à ce genre d’étrangeté, alors on peut foncer, car ce sera une chouette lecture, originale et sombre tout en, même si cela paraît paradoxal, restant légère. Pour paraphraser le titre, un étrange objet littéraire et graphique, donc.
84Dilara86
>82 raton-liseur: I hadn't heard of this author before but she sounds very interesting! I've wishlisted this short story collection, although I don't know when I'll get to it...
85raton-liseur
>84 Dilara86: I know, "So many books, so little time", but it's great you wishlisted it. I read few books from the "rentrée littéraire", but this one was really a good catch!
86raton-liseur
Petit bilan de début d’automne
Je voulais écrire une petite note récapitulative pour Septembre, mais Octobre s’installe et je ne me suis toujours pas mise à mon clavier…
J’avais fini le mois d’août assez contente de moi : plutôt frugale toute l’été en terme d’achat de livres, j’avais réussi à rattraper mon retard (en tout cas en terme de livres physiques), et j’en étais à 39 livres achetés pour 41 us, une toute petite marge, mais une marge quand même.
Et puis, en septembre, tout a déraillé… Ça a commencé dès le 1er septembre, qui était aussi le dernier jour des vacances scolaires. Pour conserver un air d’insouciance à cette veille de rentrée, je suis allée faire un tour au marché du livre de Bécherel. Je n’y avais pas mis les pieds de tout l’été, je pouvais me permettre cette petite escapade. Je n’y allais pas vraiment pour acheter des livres, mais j’avais quand même une petite liste au fond de mon sac. Résultat, 7 livres achetés, dont un seul était sur ma liste…
• Cassandre de Christa Wolf était sur ma liste parce que j’ai lu Médée de cette autrice plus tôt cette année, et que ce titre m’a été suggéré.
• Mes Sacrées Tantes de Bulbul Sharma et Destins obscurs de Willa Cather, ben ça tombe bien, j’ai envie de lire plus d’auteurs que je connais déjà.
• Les Girofliers de Zanzibar d'Adam Shafi Adam, parce que ce n’est pas tous les jours qu’on trouve un bouquin traduit du swahili, et puis Zanzibar, ce sont de chouettes souvenirs...
• Et puis Abdul Bashur, le rêveur de navires parce que c’est un titre d'Alvaro Mutis que je ne connaissais pas, et un jour j’aimerais bien lire tout Avaro Mutis.
• Ah et aussi Mutinerie à bord de Jacques Perret, parce que ce n’est pas facile de trouver du Jacques Perret et ma première expérience était plutôt une réussite.
• Et enfin pourquoi pas Chevaliers et Chatelaines de la mer de Georges G. Toudouze, un auteur breton que seuls ceux qui fréquentent les sites de livres électroniques libres de droit connaissent… (Mais là je me suis fait avoir, je croyais que c’était « le » Toudouze connu, mais il s’agit de son fils, qui a bâti sa carrière sur la réputation de son père. Tant pis, ce roman historique m’attire bien quand même).
Mais il y avait un petit problème. Raisonnable comme je suis, je n’ai pris qu’un livre de Bulbul Sharma et un de Willa Wather alors qu’il y en avait deux pour chacune de ces autrices. Ça m’a travaillé, et résultat, deux semaines plus tard, hop, un nouveau passage dans les librairies de Bécherel.
• Ouf, Maintenant que j'ai 50 ans de Bulbul Sharma et La Montgolfière de Willa Cather étaient toujours là. Et comme j’ai lu un livre de chacune de ces autrices au cours du mois de septembre, la règle du « pas plus d’un livre en attente par auteur » est respectée !
• Oui mais, cette fois, j’ai aussi trouvé Le Pays sans ombre d'Abdoulahman A. Waberi. Un livre de Djibouti, ça ne se refuse pas !
• Et puis, comme j’avais oublié de chercher Hommage à la Catalogne la dernière fois, je me suis retrouvée au rayon « guerre d’Espagne ». Je n’ai pas trouvé le bouquin d’Orwell mais je me suis laissée tenter par Requiem pour un paysan espagnol de Ramon J. Sender, un titre que je connaissais déjà de réputation.
Et puis après ça, deux passages à la librairie à Rennes, avec une rentrée littéraire dont je ne suis pas friande en soi, mais il y a toujours quelques livres qui me font envie dans la masse de ce qui est publié…
• Et me voilà avec Grand-peur et misère du IIIe Reich de Bertolt Brecht. Bon ça c’est parce que j’allais voir la pièce quelques jours après, et puis aussi Titus Andronicus, Jules César, Antoine et Cléopâtre, Coriolan de William Shakespeare, parce que là, on doit aller la voir en janvier prochain.
• Sans oublier Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire parce que même si ce n’est pas l’oeuvre poétique retenue par la prof de M’ni Raton pour le bac, c’est un recueil de poésie à avoir sur ses étagères (et à lire… pas juste pour la figuration !).
• Et bien sûr, Dors ton sommeil de brute, le nouveau livre de Carole Martinez, je ne pouvais pas passer à côté.
• Et, oh ! Printemps au coin cassé de Mario Benedetti est sorti cet été ! Je rêve de lire ce livre depuis que j’en ai étudié un extrait en cours d’espagnol en 4ème ou 3ème. J’ai même le livre en espagnol, et maintenant j’en ai une traduction, super !
• Et encore Ana non d'Agustin Gomez-Arcos, qui m’a été recommandé après ma lecture de Requiem pour un paysan espagnol, acheté plus tôt dans le mois et lu dans la foulée.
• Et puis, comme ça y est, mon quota est loin derrière et qu’il me reste encore plein d’envies, je me laisse tenter par Les Ames de feu d'Annie Francé-Harrar, un roman d’anticipation écrit par une pédologue allemande dans les années 20, trop intriguant pour que je passe à côté !
• Et parce qu’on en parle mais je préfère l’original, Les limites à la croissance (dans un monde fini) de Dennis Meadows, Donella Meadows et Jorgen Randers, que je lirai donc avec plus de 50 ans de retard.
• Et puisqu’on n’est plus à ça près, Près de la mer d'Abdulrazak Gurnah, encore une fois pour essayer de continuer à découvrir des auteurs dont j’ai aimé ma première lecture et Hommage à la Catalogne de George Orwell puisque je ne l’avais pas trouvé d’occasion.
Et encore, ils n’avaient pas Chroniques du pays des gens les plus heureux du monde de Wole Soyinka qui vient de paraître en poche, ni Lettre à ma fille de maya Angelou...
Et voilà, quatre passages en librairie plus tard, j’en suis à 60 livres physiques achetés (donc 19 en un mois, sans commentaire…) et seulement 44 livres lus (livres physiques présents sur mes étagères, pas toutes mes lectures de l’année). Une catastrophe… Je vais essayer de ne pas trop empirer les choses d’ici la fin de l’année, voire de résorber cet excès de 16 livres, mais je crois que cela va être un défi difficile à relever dans les quelques mois qui restent. Et puis, là, à la fin du mois d’octobre, il y a des vacances, donc il y aura bien au moins un passage en librairie. On ne s’en sort décidément pas. La seule solution : avoir plus de temps pour lire, je ne vois que ça !
Je voulais écrire une petite note récapitulative pour Septembre, mais Octobre s’installe et je ne me suis toujours pas mise à mon clavier…
J’avais fini le mois d’août assez contente de moi : plutôt frugale toute l’été en terme d’achat de livres, j’avais réussi à rattraper mon retard (en tout cas en terme de livres physiques), et j’en étais à 39 livres achetés pour 41 us, une toute petite marge, mais une marge quand même.
Et puis, en septembre, tout a déraillé… Ça a commencé dès le 1er septembre, qui était aussi le dernier jour des vacances scolaires. Pour conserver un air d’insouciance à cette veille de rentrée, je suis allée faire un tour au marché du livre de Bécherel. Je n’y avais pas mis les pieds de tout l’été, je pouvais me permettre cette petite escapade. Je n’y allais pas vraiment pour acheter des livres, mais j’avais quand même une petite liste au fond de mon sac. Résultat, 7 livres achetés, dont un seul était sur ma liste…
• Cassandre de Christa Wolf était sur ma liste parce que j’ai lu Médée de cette autrice plus tôt cette année, et que ce titre m’a été suggéré.
• Mes Sacrées Tantes de Bulbul Sharma et Destins obscurs de Willa Cather, ben ça tombe bien, j’ai envie de lire plus d’auteurs que je connais déjà.
• Les Girofliers de Zanzibar d'Adam Shafi Adam, parce que ce n’est pas tous les jours qu’on trouve un bouquin traduit du swahili, et puis Zanzibar, ce sont de chouettes souvenirs...
• Et puis Abdul Bashur, le rêveur de navires parce que c’est un titre d'Alvaro Mutis que je ne connaissais pas, et un jour j’aimerais bien lire tout Avaro Mutis.
• Ah et aussi Mutinerie à bord de Jacques Perret, parce que ce n’est pas facile de trouver du Jacques Perret et ma première expérience était plutôt une réussite.
• Et enfin pourquoi pas Chevaliers et Chatelaines de la mer de Georges G. Toudouze, un auteur breton que seuls ceux qui fréquentent les sites de livres électroniques libres de droit connaissent… (Mais là je me suis fait avoir, je croyais que c’était « le » Toudouze connu, mais il s’agit de son fils, qui a bâti sa carrière sur la réputation de son père. Tant pis, ce roman historique m’attire bien quand même).
Mais il y avait un petit problème. Raisonnable comme je suis, je n’ai pris qu’un livre de Bulbul Sharma et un de Willa Wather alors qu’il y en avait deux pour chacune de ces autrices. Ça m’a travaillé, et résultat, deux semaines plus tard, hop, un nouveau passage dans les librairies de Bécherel.
• Ouf, Maintenant que j'ai 50 ans de Bulbul Sharma et La Montgolfière de Willa Cather étaient toujours là. Et comme j’ai lu un livre de chacune de ces autrices au cours du mois de septembre, la règle du « pas plus d’un livre en attente par auteur » est respectée !
• Oui mais, cette fois, j’ai aussi trouvé Le Pays sans ombre d'Abdoulahman A. Waberi. Un livre de Djibouti, ça ne se refuse pas !
• Et puis, comme j’avais oublié de chercher Hommage à la Catalogne la dernière fois, je me suis retrouvée au rayon « guerre d’Espagne ». Je n’ai pas trouvé le bouquin d’Orwell mais je me suis laissée tenter par Requiem pour un paysan espagnol de Ramon J. Sender, un titre que je connaissais déjà de réputation.
Et puis après ça, deux passages à la librairie à Rennes, avec une rentrée littéraire dont je ne suis pas friande en soi, mais il y a toujours quelques livres qui me font envie dans la masse de ce qui est publié…
• Et me voilà avec Grand-peur et misère du IIIe Reich de Bertolt Brecht. Bon ça c’est parce que j’allais voir la pièce quelques jours après, et puis aussi Titus Andronicus, Jules César, Antoine et Cléopâtre, Coriolan de William Shakespeare, parce que là, on doit aller la voir en janvier prochain.
• Sans oublier Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire parce que même si ce n’est pas l’oeuvre poétique retenue par la prof de M’ni Raton pour le bac, c’est un recueil de poésie à avoir sur ses étagères (et à lire… pas juste pour la figuration !).
• Et bien sûr, Dors ton sommeil de brute, le nouveau livre de Carole Martinez, je ne pouvais pas passer à côté.
• Et, oh ! Printemps au coin cassé de Mario Benedetti est sorti cet été ! Je rêve de lire ce livre depuis que j’en ai étudié un extrait en cours d’espagnol en 4ème ou 3ème. J’ai même le livre en espagnol, et maintenant j’en ai une traduction, super !
• Et encore Ana non d'Agustin Gomez-Arcos, qui m’a été recommandé après ma lecture de Requiem pour un paysan espagnol, acheté plus tôt dans le mois et lu dans la foulée.
• Et puis, comme ça y est, mon quota est loin derrière et qu’il me reste encore plein d’envies, je me laisse tenter par Les Ames de feu d'Annie Francé-Harrar, un roman d’anticipation écrit par une pédologue allemande dans les années 20, trop intriguant pour que je passe à côté !
• Et parce qu’on en parle mais je préfère l’original, Les limites à la croissance (dans un monde fini) de Dennis Meadows, Donella Meadows et Jorgen Randers, que je lirai donc avec plus de 50 ans de retard.
• Et puisqu’on n’est plus à ça près, Près de la mer d'Abdulrazak Gurnah, encore une fois pour essayer de continuer à découvrir des auteurs dont j’ai aimé ma première lecture et Hommage à la Catalogne de George Orwell puisque je ne l’avais pas trouvé d’occasion.
Et encore, ils n’avaient pas Chroniques du pays des gens les plus heureux du monde de Wole Soyinka qui vient de paraître en poche, ni Lettre à ma fille de maya Angelou...
Et voilà, quatre passages en librairie plus tard, j’en suis à 60 livres physiques achetés (donc 19 en un mois, sans commentaire…) et seulement 44 livres lus (livres physiques présents sur mes étagères, pas toutes mes lectures de l’année). Une catastrophe… Je vais essayer de ne pas trop empirer les choses d’ici la fin de l’année, voire de résorber cet excès de 16 livres, mais je crois que cela va être un défi difficile à relever dans les quelques mois qui restent. Et puis, là, à la fin du mois d’octobre, il y a des vacances, donc il y aura bien au moins un passage en librairie. On ne s’en sort décidément pas. La seule solution : avoir plus de temps pour lire, je ne vois que ça !
87raton-liseur
~~~~ 🦝 ~ Octobre ~ 🦝 ~~~~
Allez, il est temps de s’atteler aux revues d’octobre, qui seront encore une fois un peu dans le désordre. J’ai lu beaucoup de nouvelles en septembre, parce que je lisais en parallèle un bouquin d’économie, La Dette publique des Economistes atterrés. Il me reste un bouquin de Sepúlveda à lire, même si j’ai fini celui sur la dette, mais octobre risque d’être un mois très varié puisque j’ai repris la lecture de bd et j’ai pas mal de livre de service presse qui me sont arrivés. Je commence donc sans plus tarder.
Allez, il est temps de s’atteler aux revues d’octobre, qui seront encore une fois un peu dans le désordre. J’ai lu beaucoup de nouvelles en septembre, parce que je lisais en parallèle un bouquin d’économie, La Dette publique des Economistes atterrés. Il me reste un bouquin de Sepúlveda à lire, même si j’ai fini celui sur la dette, mais octobre risque d’être un mois très varié puisque j’ai repris la lecture de bd et j’ai pas mal de livre de service presse qui me sont arrivés. Je commence donc sans plus tarder.
88raton-liseur
87. 13g. (-) Les Crieurs du Crime : la Belle Epoque du fait divers de Sylvain Venayre (scénario) et Hugues Micol (dessin)
Titre en anglais : non traduit



Merci aux éditions Delcourt de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
Début du XXème siècle, naissance de la presse moderne, et de façon concomitante, naissance du fait divers. Comment les deux sont-ils liés ? En nous faisant participer à l'enquête sur l'affaire Soleilland, qui plus est aux côtés d'un journaliste pas très dégourdi mais idéaliste, on voit la façon dont les journaux construisent le roman de cette histoire, comment ils le feuilletonisent et comment ils n'hésitent pas à se nourrir de rumeurs ou de ragots pour remplir leurs colonnes et faire frémir dans les chaumières. C'est intéressant et cela donne une perspective historique sur les débats actuels sur les médias. Encore une fois, on peut se dire que bien peu de choses ont changé, ce sont l'échelle et les moyens qui ne sont plus les mêmes.
Par contre, je trouve le titre un peu racoleur et le sous-titre encore plus, en même temps qu'il trompe un peu sur la marchandise. On se place ici uniquement du côté des faiseurs d'histoire que sont les journalistes, sur leurs méthodes et sur leur façon de faire appel aux sentiments des lecteurs. Mais rien n'est dit (même si on peut en partie le deviner) sur le sentiment d'insécurité. Il me semble avoir lu ailleurs que l'affaire Soleilland et ce crime sordide sur une fillette avait été pour une grande part dans l'échec de la loi de 1908 (un an plus tard donc) qui visait l'abolition de la peine de mort. Cet échec est évoqué, mais rien sur la façon dont les journaux ont pu participer à un sentiment d'insécurité ou à la diffusion d'un ordre moral qui expliquerait en quoi ces deux faits peuvent être liés (certes, peut-être pas facile comme question, mais je croyais que c'était ça que j'allais lire).
Je dois donc avouer que je suis donc un peu restée sur ma faim avec cette bd. Intéressante, mais peut-être un peu trop factuelle et superficielle pour ce que j'en attendais. En plus, les dessins m'ont parus assez étrange, j'ai souvent eu l'impression qu'ils étaient découpés en deux ou trois plans superposés, ou bien que les personnages avaient été posés dans le décor. L'ambiance du début du siècle est bien rendue, mais le traitement de la perspective donne une drôle d'impression un peu de théâtre de marionnette. C'est probablement voulu, mais cela m'a souvent déstabilisée au cours de ma lecture.
Intéressant donc, intriguant un peu, pas désagréable c'est sûr, même si je m'attendais à quelque chose de différent.
Titre en anglais : non traduit



Merci aux éditions Delcourt de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
Début du XXème siècle, naissance de la presse moderne, et de façon concomitante, naissance du fait divers. Comment les deux sont-ils liés ? En nous faisant participer à l'enquête sur l'affaire Soleilland, qui plus est aux côtés d'un journaliste pas très dégourdi mais idéaliste, on voit la façon dont les journaux construisent le roman de cette histoire, comment ils le feuilletonisent et comment ils n'hésitent pas à se nourrir de rumeurs ou de ragots pour remplir leurs colonnes et faire frémir dans les chaumières. C'est intéressant et cela donne une perspective historique sur les débats actuels sur les médias. Encore une fois, on peut se dire que bien peu de choses ont changé, ce sont l'échelle et les moyens qui ne sont plus les mêmes.
Par contre, je trouve le titre un peu racoleur et le sous-titre encore plus, en même temps qu'il trompe un peu sur la marchandise. On se place ici uniquement du côté des faiseurs d'histoire que sont les journalistes, sur leurs méthodes et sur leur façon de faire appel aux sentiments des lecteurs. Mais rien n'est dit (même si on peut en partie le deviner) sur le sentiment d'insécurité. Il me semble avoir lu ailleurs que l'affaire Soleilland et ce crime sordide sur une fillette avait été pour une grande part dans l'échec de la loi de 1908 (un an plus tard donc) qui visait l'abolition de la peine de mort. Cet échec est évoqué, mais rien sur la façon dont les journaux ont pu participer à un sentiment d'insécurité ou à la diffusion d'un ordre moral qui expliquerait en quoi ces deux faits peuvent être liés (certes, peut-être pas facile comme question, mais je croyais que c'était ça que j'allais lire).
Je dois donc avouer que je suis donc un peu restée sur ma faim avec cette bd. Intéressante, mais peut-être un peu trop factuelle et superficielle pour ce que j'en attendais. En plus, les dessins m'ont parus assez étrange, j'ai souvent eu l'impression qu'ils étaient découpés en deux ou trois plans superposés, ou bien que les personnages avaient été posés dans le décor. L'ambiance du début du siècle est bien rendue, mais le traitement de la perspective donne une drôle d'impression un peu de théâtre de marionnette. C'est probablement voulu, mais cela m'a souvent déstabilisée au cours de ma lecture.
Intéressant donc, intriguant un peu, pas désagréable c'est sûr, même si je m'attendais à quelque chose de différent.
89raton-liseur
88. -. (-) Albert Londres doit disparaître de Frédéric Kinder (scénario) et Brice Follet (dessin)
Titre en anglais : non traduit



J'ai écouté, il y a quelques semaines, un podcast sur la vie d'Albert Londres, alors cette bd qui vient d'arriver à la bibliothèque du village m'a paru tomber à point. Tentant de répondre à la question que tout le monde se pose (qu'est-ce qu'Albert Londres était allé faire en Chine, et sa mort est-elle accidentelle ou criminelle ?), cette bd penche bien sûr pour la thèse du complot. Si j'ai bien aimé le dessin et l'évocation de l'époque, celle des années 30 en Chine (trafic d'opium, guerre d'influence et commerciale entre pays européens, guerre de territoire entre Chinois et Japonais, guerre de pouvoir entre nationalistes et communistes, n'en jetez plus !), un moment de l'histoire en général peu connu en Europe, l'histoire en elle-même ne m'a pas vraiment emportée. C'est peut-être que je suis trop naïve, mais le côté un peu complotiste de tout cela, avec toutes les personnes que connaît Albert Londres mouillés d'une façon ou d'une autre dans cette histoire, les ficelles m'ont paru trop grosses. Un livre agréable à regarder, donc, agréable pour voyager, mais qui m'a un peu laissée sur le bord de la route.
Titre en anglais : non traduit



J'ai écouté, il y a quelques semaines, un podcast sur la vie d'Albert Londres, alors cette bd qui vient d'arriver à la bibliothèque du village m'a paru tomber à point. Tentant de répondre à la question que tout le monde se pose (qu'est-ce qu'Albert Londres était allé faire en Chine, et sa mort est-elle accidentelle ou criminelle ?), cette bd penche bien sûr pour la thèse du complot. Si j'ai bien aimé le dessin et l'évocation de l'époque, celle des années 30 en Chine (trafic d'opium, guerre d'influence et commerciale entre pays européens, guerre de territoire entre Chinois et Japonais, guerre de pouvoir entre nationalistes et communistes, n'en jetez plus !), un moment de l'histoire en général peu connu en Europe, l'histoire en elle-même ne m'a pas vraiment emportée. C'est peut-être que je suis trop naïve, mais le côté un peu complotiste de tout cela, avec toutes les personnes que connaît Albert Londres mouillés d'une façon ou d'une autre dans cette histoire, les ficelles m'ont paru trop grosses. Un livre agréable à regarder, donc, agréable pour voyager, mais qui m'a un peu laissée sur le bord de la route.
90labfs39
>86 raton-liseur: LOL. So I'm not the only one to get carried at way at times? Good to know! Think of it this way: you may have exceeded your cautious goals, but you have provided entertainment not only for yourself but for your CR friends too! Some great titles there. I look forward to your reviews when you get to them. I'm sure there are some book bullets lurking there for me.
91Dilara86
>86 raton-liseur: Toutes mes commisérations : ça pourrait être moi :-D Je n'avais jamais entendu parler de Annie Francé-Harrar mais clairement, il me la faut dans ma bibliothèque !
92raton-liseur
>90 labfs39: and >91 Dilara86: I knew I was not the only one... Now I feel better :)
And I'm glad I made you smile.
M'sieur Raton said I should see it as a shelf replenishment (I did not know we needed a shelf replenishment) for my retirement time. Do you think he was sarcastic?
My bad, Annie Francé-Harrar is not German, she is Austrian. The book sounds really intriguing, and I hope I'll start to read it soon.
And I'm glad I made you smile.
M'sieur Raton said I should see it as a shelf replenishment (I did not know we needed a shelf replenishment) for my retirement time. Do you think he was sarcastic?
My bad, Annie Francé-Harrar is not German, she is Austrian. The book sounds really intriguing, and I hope I'll start to read it soon.
93raton-liseur
90. -. (-) Matin brun de Franck Pavloff
Titre en anglais : Brown ou Brown morning


Je viens de relire cette courte nouvelle pour préparer un travail avec mes élèves. Je me souviens avoir été assez dubitative quand je l'avais lue, probablement en 2002, quand elle a été à la mode après le coup de tonnerre du 2nd tour de la présidentielle (mais la nouvelle a été initialement publiée en 1998). Mais je crois que j'en attendais trop à ce moment-là. C'est une nouvelle qui dit de façon limpide des choses complexes, en utilisant une allégorie, ou plus exactement c’est un apologue (un court récit narratif, didactique, démonstratif et fictif, à visée argumentative, dont se tire une vérité morale pratique, un enseignement pour le lecteur d'après la définition de Wikipédia), comme je l'ai découvert lors de mes rapides recherches.
Il ne faut donc pas en attendre une grande profondeur ou une grande complexité. Et il faut savoir replacer ce texte dans son contexte, celui d'un coup de gueule assumé de l'auteur effaré par les compromissions de la Droite avec le FN (je me demande, s'il était effaré en 1998, quel adjectif je pourrais utiliser pour ce qu'il doit être aujourd'hui…), et celui d'un texte qui, aujourd'hui, presque 25 ans plus tard, est je pense principalement à destination des jeunes.
L'ayant cette fois clairement lu dans cette optique, eh bien, je l'ai trouvé plutôt bien ficelé, et je crois que l'on va en faire une lecture intéressante cette semaine en classe…
Liens avec d’autres textes : Comme je lisais aussi ce week-end Grand-peur et misère du IIIème Reich de Brecht que j'ai pu aller voir au théâtre il y a peu, j'ai bien sûr vu des passerelles entre les deux, qui cherchent à décrire des réalités qui ont quelques similitudes, mais là on n'est plus sur le même lectorat et la même intention littéraire.
A retenir aussi, un parallèle (voire plus qu'un parallèle, Franck Pavloff a presque littéralement pris cette citation pour l'étendre au format d'une nouvelle) à faire avec la célèbre (mais mouvante) citation du pasteur Martin Niemöller, que je connaissais sans en connaître l'auteur :
« Quand ils sont venus chercher les ..., je n'ai rien dit, je n'étais pas ... . » On connaît la fin...
Titre en anglais : Brown ou Brown morning


Je viens de relire cette courte nouvelle pour préparer un travail avec mes élèves. Je me souviens avoir été assez dubitative quand je l'avais lue, probablement en 2002, quand elle a été à la mode après le coup de tonnerre du 2nd tour de la présidentielle (mais la nouvelle a été initialement publiée en 1998). Mais je crois que j'en attendais trop à ce moment-là. C'est une nouvelle qui dit de façon limpide des choses complexes, en utilisant une allégorie, ou plus exactement c’est un apologue (un court récit narratif, didactique, démonstratif et fictif, à visée argumentative, dont se tire une vérité morale pratique, un enseignement pour le lecteur d'après la définition de Wikipédia), comme je l'ai découvert lors de mes rapides recherches.
Il ne faut donc pas en attendre une grande profondeur ou une grande complexité. Et il faut savoir replacer ce texte dans son contexte, celui d'un coup de gueule assumé de l'auteur effaré par les compromissions de la Droite avec le FN (je me demande, s'il était effaré en 1998, quel adjectif je pourrais utiliser pour ce qu'il doit être aujourd'hui…), et celui d'un texte qui, aujourd'hui, presque 25 ans plus tard, est je pense principalement à destination des jeunes.
L'ayant cette fois clairement lu dans cette optique, eh bien, je l'ai trouvé plutôt bien ficelé, et je crois que l'on va en faire une lecture intéressante cette semaine en classe…
Liens avec d’autres textes : Comme je lisais aussi ce week-end Grand-peur et misère du IIIème Reich de Brecht que j'ai pu aller voir au théâtre il y a peu, j'ai bien sûr vu des passerelles entre les deux, qui cherchent à décrire des réalités qui ont quelques similitudes, mais là on n'est plus sur le même lectorat et la même intention littéraire.
A retenir aussi, un parallèle (voire plus qu'un parallèle, Franck Pavloff a presque littéralement pris cette citation pour l'étendre au format d'une nouvelle) à faire avec la célèbre (mais mouvante) citation du pasteur Martin Niemöller, que je connaissais sans en connaître l'auteur :
« Quand ils sont venus chercher les ..., je n'ai rien dit, je n'étais pas ... . » On connaît la fin...
94raton-liseur
89. 61. (-) Rire avec le diable de Bruno Patino
Titre en anglais : non traduit


Merci aux éditions Grasset de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
J'aime bien cette sorte de petite collection qui ne dit pas son nom que semble constituer Grasset depuis quelques temps. Des textes courts, à peine 100 pages, écrits par des journalistes (dans un style qui tient plus du reportage que de l’œuvre littéraire) et racontant un moment important de leur carrière, avec ses coulisses et ses résonances personnelles, avant, pendant ou après. J'avais commencé en 2020 avec La Traversée de Pyongyang de Marc Nexon, un superbe compte-rendu d'un non-reportage dans la capitale de la Corée du Nord. Ici, c'est Bruno Patino, alors jeune correspondant du Monde au Chili qui nous parle de l'entretien qu'il a pu avoir avec Pinochet, « le diable », le dictateur un tantinet déchu, en 1992. Il explique sa fascination pour les grandes figures politiques de l'Amérique Latine et revient sur la façon dont, pendant son adolescence, Pinochet était pour lui l'incarnation du mal.
Mais il semble conserver cette même vision un peu simpliste lorsqu'il parle, jeune adulte, de son travail au Chili, et aujourd'hui alors qu'il est un journaliste aguerri. Et c'est là que ce livre tombe un peu à plat : si j'ai beaucoup aimé la façon dont il parle de la formation de ses idéaux politiques, entre les figures du Che et de Pinochet, s'il est lucide sur la candeur qui pouvait le guider alors qu'il était jeune journaliste, il n'arrive pas, à mon sens, à mettre ces sortes de défauts à distance pour donner plus de portée ou plus de profondeur à son expérience. Finalement, il illustre de façon somme toute assez plate, et sans la citer, Anna Harendt et sa banalité du mal, et sa dernière partie pour remettre tout cela dans le contexte politique actuel, plus de 30 ans plus tard m'a semblé peu étayée (bien que je sois plutôt en accord avec ce qu'il dit) et plutôt convenue.
Finalement, voici un livre qui plaira peut-être surtout aux gens de ma génération ou de celle de Bruno Patino, qui avons connu cette fascination pour l'Amérique Latine sans peut-être complètement se l'expliquer alors, et qui se retrouveront dans les premières pages de ce court récit. Pour le reste, pas de grande révélation sur l’origine du mal ni de profonde réflexion sur le journalisme. A lire presque plus par nostalgie, on passera alors un bon moment.
Titre en anglais : non traduit


Merci aux éditions Grasset de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
J'aime bien cette sorte de petite collection qui ne dit pas son nom que semble constituer Grasset depuis quelques temps. Des textes courts, à peine 100 pages, écrits par des journalistes (dans un style qui tient plus du reportage que de l’œuvre littéraire) et racontant un moment important de leur carrière, avec ses coulisses et ses résonances personnelles, avant, pendant ou après. J'avais commencé en 2020 avec La Traversée de Pyongyang de Marc Nexon, un superbe compte-rendu d'un non-reportage dans la capitale de la Corée du Nord. Ici, c'est Bruno Patino, alors jeune correspondant du Monde au Chili qui nous parle de l'entretien qu'il a pu avoir avec Pinochet, « le diable », le dictateur un tantinet déchu, en 1992. Il explique sa fascination pour les grandes figures politiques de l'Amérique Latine et revient sur la façon dont, pendant son adolescence, Pinochet était pour lui l'incarnation du mal.
Mais il semble conserver cette même vision un peu simpliste lorsqu'il parle, jeune adulte, de son travail au Chili, et aujourd'hui alors qu'il est un journaliste aguerri. Et c'est là que ce livre tombe un peu à plat : si j'ai beaucoup aimé la façon dont il parle de la formation de ses idéaux politiques, entre les figures du Che et de Pinochet, s'il est lucide sur la candeur qui pouvait le guider alors qu'il était jeune journaliste, il n'arrive pas, à mon sens, à mettre ces sortes de défauts à distance pour donner plus de portée ou plus de profondeur à son expérience. Finalement, il illustre de façon somme toute assez plate, et sans la citer, Anna Harendt et sa banalité du mal, et sa dernière partie pour remettre tout cela dans le contexte politique actuel, plus de 30 ans plus tard m'a semblé peu étayée (bien que je sois plutôt en accord avec ce qu'il dit) et plutôt convenue.
Finalement, voici un livre qui plaira peut-être surtout aux gens de ma génération ou de celle de Bruno Patino, qui avons connu cette fascination pour l'Amérique Latine sans peut-être complètement se l'expliquer alors, et qui se retrouveront dans les premières pages de ce court récit. Pour le reste, pas de grande révélation sur l’origine du mal ni de profonde réflexion sur le journalisme. A lire presque plus par nostalgie, on passera alors un bon moment.
95labfs39
>94 raton-liseur: Too bad this feel flat. It sounds like it could have been an interesting piece.
96raton-liseur
>95 labfs39: It was not that bad, but could have been better.
97raton-liseur
95. 65. (48) Pasó por aquí de Eugene Manlove Rhodes, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Serge Chauvin
Titre original : Pasó por aquí


Après quelques lectures un peu exigeantes, j’avais envie de quelque chose de court et de léger pour commencer ces vacances automnales. Cette couverture a tout de suite attiré mon regard et un western en français, traduit de l’anglais et avec un titre en espagnol, je me suis dit que c’était exactement ce que je voulais ! Aussitôt acheté, aussitôt commencé et à peine quelques heures plus tard, fini.
Voici un auteur nouveau pour moi (pas étonnant, ce livre nouvellement paru en France est la première traduction de cet auteur disponible , alors qu’il date de 1926 dans la langue originelle). C’est un western original avec une première partie contemplative et pleine de la nostalgie d’un homme traversant des contrées qu’il a connues sauvages mais où les ranchs se multiplient désormais, reléguant la Conquête au domaine du souvenir et du pittoresque. La seconde partie s’intéresse plus directement aux hommes, et en dresse un portrait où les valeurs et la droiture sont importantes, même si cela nécessite parfois de contourner un peu la loi.
Et finalement, on se retrouve dans un western sans violence, et où, au fond, tout le monde agit avec honneur. Un livre qui est à la fois dans son genre, celui du western donc, qui est fixé depuis peu par des aînés et des contemporains de Rhodes, et qui le détourne puisque tous les ingrédients sont là (le shériff est même Pat Garrett, je ne le savais pas, mais c’est celui-là même qui a tué pour de vrai Billy the Kid !), mais Rhodes en fait quelque chose de plutôt original et de très agréable à lire.
Un chouette petit roman donc, qui respire le soleil torride et la poussière des montagnes du Nouveau Mexique. Et étrangement, un roman agréable à lire en ces journées pluvieuses où la couleur ocre vient des feuilles plutôt que des mesas soumises à l’érosion constante.
Titre original : Pasó por aquí


Après quelques lectures un peu exigeantes, j’avais envie de quelque chose de court et de léger pour commencer ces vacances automnales. Cette couverture a tout de suite attiré mon regard et un western en français, traduit de l’anglais et avec un titre en espagnol, je me suis dit que c’était exactement ce que je voulais ! Aussitôt acheté, aussitôt commencé et à peine quelques heures plus tard, fini.
Voici un auteur nouveau pour moi (pas étonnant, ce livre nouvellement paru en France est la première traduction de cet auteur disponible , alors qu’il date de 1926 dans la langue originelle). C’est un western original avec une première partie contemplative et pleine de la nostalgie d’un homme traversant des contrées qu’il a connues sauvages mais où les ranchs se multiplient désormais, reléguant la Conquête au domaine du souvenir et du pittoresque. La seconde partie s’intéresse plus directement aux hommes, et en dresse un portrait où les valeurs et la droiture sont importantes, même si cela nécessite parfois de contourner un peu la loi.
Et finalement, on se retrouve dans un western sans violence, et où, au fond, tout le monde agit avec honneur. Un livre qui est à la fois dans son genre, celui du western donc, qui est fixé depuis peu par des aînés et des contemporains de Rhodes, et qui le détourne puisque tous les ingrédients sont là (le shériff est même Pat Garrett, je ne le savais pas, mais c’est celui-là même qui a tué pour de vrai Billy the Kid !), mais Rhodes en fait quelque chose de plutôt original et de très agréable à lire.
Un chouette petit roman donc, qui respire le soleil torride et la poussière des montagnes du Nouveau Mexique. Et étrangement, un roman agréable à lire en ces journées pluvieuses où la couleur ocre vient des feuilles plutôt que des mesas soumises à l’érosion constante.
98raton-liseur
94. -. (-) Le Maître des livres, tome 1 de Umiharu Shinohara, traduit du japonais par Fabien Nabhan
Titre original : Toshokan no Aruji (図書館の主)
Titre en anglais : non traduit
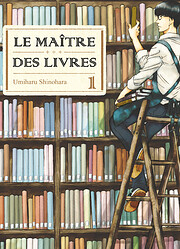

J’avais repéré ce titre en me disant que c’était vraiment un manga fait pour moi ! Je me suis aperçue il y a quelques semaines qu’une bibliothèque partenaire de celle du village l’avait dans ses rayons alors je n’ai pas hésité à la demander ! Bon, c’est mignon, mais quand même assez convenu et pas très crédible (ah, si un gamin qui aime s’en prendre à ses camarades pouvait reprendre le droit chemin en s’intéressant aux mots de Stevenson… Mais hélas pour beaucoup, les mots et le style sont des repoussoirs bien trop puissants…).
Et puis l’alternance entre des dessins relativement travaillés et d’autres qui sont presque des caricatures (notamment les personnages en colère, ou amoureux, dessinés en plus petit et avec des expressions très stéréotypées) ne m’a pas vraiment convaincue, mais peut-être que je ne maîtrise pas assez les codes du genre.
En fin de compte, je lirai peut-être d’autres tomes (d’après ce que j’ai vu, il y en a quand même 15. Ça ne vaut pas les plus de 100 tomes de One Piece, mais quand même !), mais ce sera principalement comme une lecture pour se reposer un peu, et sans en attendre beaucoup. Dommage, j’aurais bien aimé une belle ode à la lecture en manga !
Titre original : Toshokan no Aruji (図書館の主)
Titre en anglais : non traduit
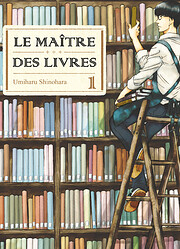

J’avais repéré ce titre en me disant que c’était vraiment un manga fait pour moi ! Je me suis aperçue il y a quelques semaines qu’une bibliothèque partenaire de celle du village l’avait dans ses rayons alors je n’ai pas hésité à la demander ! Bon, c’est mignon, mais quand même assez convenu et pas très crédible (ah, si un gamin qui aime s’en prendre à ses camarades pouvait reprendre le droit chemin en s’intéressant aux mots de Stevenson… Mais hélas pour beaucoup, les mots et le style sont des repoussoirs bien trop puissants…).
Et puis l’alternance entre des dessins relativement travaillés et d’autres qui sont presque des caricatures (notamment les personnages en colère, ou amoureux, dessinés en plus petit et avec des expressions très stéréotypées) ne m’a pas vraiment convaincue, mais peut-être que je ne maîtrise pas assez les codes du genre.
En fin de compte, je lirai peut-être d’autres tomes (d’après ce que j’ai vu, il y en a quand même 15. Ça ne vaut pas les plus de 100 tomes de One Piece, mais quand même !), mais ce sera principalement comme une lecture pour se reposer un peu, et sans en attendre beaucoup. Dommage, j’aurais bien aimé une belle ode à la lecture en manga !
99raton-liseur
92. 63. (-) Rendez-vous d'amour dans un pays en guerre de Luis Sepúlveda, traduit de l’espagnol (Chili) par François Gaudry
Titre original : Desencuentros
Titre en anglais : non traduit


Relecture de 2024 : J’ai relu ce premier recueil de nouvelles de Sepúlveda (dans l’ordre de ses parutions en France) dans le cadre de ma lecture au long cours de cet auteur. J’ai probablement mis un peu plus de temps à rentrer dedans que lors de ma première lecture qui remonte, d’après ce site, à 2012, mais c’est probablement que je n’étais pas vraiment dans le bon état d’esprit pour du Sepúlveda. Mais une fois passé les premières nouvelles, je me suis à nouveau laissée prendre dans les filets de ce conteur hors pair et nostalgique et je suis moi aussi partie à sa suite sur les routes des guérillas, des exils et des rêves.
Ma note de lecture d’alors restant d’actualité, je la recopie ici.
Omniprésente dictature, douce-amère résistance. Ce recueil de courtes nouvelles au titre nostalgique évoque tous les aspects de la résistance, celle de tous les jours, celle qui est lâche, celle qui se languit dans l'exode, celle qui rêve et celle qui meurt. Les rêves brisés qui continuent, l'espoir tué qui ne se résout pas à mourir.
Dans une seconde partie, il est plus question d'amour, moins de dictature, et il est étrange de voir le même fatalisme, la même résignation et le même espoir.
C'est peut-être un des livres les plus tristes que j'ai lus de Sepúlveda, mais il est aussi un des plus plein d'un espoir résigné mais tenace. C'est une leçon simple de sacrifice pour ses idées ou juste pour vivre. Une leçon qui ne lénifie pas, une leçon qui ne donne pas de leçon, chacun en titre ce qu'il veut, et pour moi ce sera peut-être de l'admiration pour cette force qui ne se dit pas et qui pousse chaque homme ordinaire à prendre sans s'en rendre compte, comme une évidence, la décision de courber l'échine ou de résister.
Les citations en exergue sont aussi très belles et donnent un éclairage supplémentaire aux nouvelles. Elles m'ont donné envie de découvrir d'autres écrivains, ce qui est rare pour moi après une simple lecture de citations. Peut-être pas le livre que je conseillerais pour une première lecture de Sepúlveda, il me semble que l'on profite mieux de ses nouvelles quand on connaît déjà ses thèmes de prédilection, mais très certainement un bon cru, au goût âpre et sucré d'un rhum ajouté de sucre de canne dans un retranchement rebelle de la forêt nicaraguayenne.
Titre original : Desencuentros
Titre en anglais : non traduit


Relecture de 2024 : J’ai relu ce premier recueil de nouvelles de Sepúlveda (dans l’ordre de ses parutions en France) dans le cadre de ma lecture au long cours de cet auteur. J’ai probablement mis un peu plus de temps à rentrer dedans que lors de ma première lecture qui remonte, d’après ce site, à 2012, mais c’est probablement que je n’étais pas vraiment dans le bon état d’esprit pour du Sepúlveda. Mais une fois passé les premières nouvelles, je me suis à nouveau laissée prendre dans les filets de ce conteur hors pair et nostalgique et je suis moi aussi partie à sa suite sur les routes des guérillas, des exils et des rêves.
Ma note de lecture d’alors restant d’actualité, je la recopie ici.
Omniprésente dictature, douce-amère résistance. Ce recueil de courtes nouvelles au titre nostalgique évoque tous les aspects de la résistance, celle de tous les jours, celle qui est lâche, celle qui se languit dans l'exode, celle qui rêve et celle qui meurt. Les rêves brisés qui continuent, l'espoir tué qui ne se résout pas à mourir.
Dans une seconde partie, il est plus question d'amour, moins de dictature, et il est étrange de voir le même fatalisme, la même résignation et le même espoir.
C'est peut-être un des livres les plus tristes que j'ai lus de Sepúlveda, mais il est aussi un des plus plein d'un espoir résigné mais tenace. C'est une leçon simple de sacrifice pour ses idées ou juste pour vivre. Une leçon qui ne lénifie pas, une leçon qui ne donne pas de leçon, chacun en titre ce qu'il veut, et pour moi ce sera peut-être de l'admiration pour cette force qui ne se dit pas et qui pousse chaque homme ordinaire à prendre sans s'en rendre compte, comme une évidence, la décision de courber l'échine ou de résister.
Les citations en exergue sont aussi très belles et donnent un éclairage supplémentaire aux nouvelles. Elles m'ont donné envie de découvrir d'autres écrivains, ce qui est rare pour moi après une simple lecture de citations. Peut-être pas le livre que je conseillerais pour une première lecture de Sepúlveda, il me semble que l'on profite mieux de ses nouvelles quand on connaît déjà ses thèmes de prédilection, mais très certainement un bon cru, au goût âpre et sucré d'un rhum ajouté de sucre de canne dans un retranchement rebelle de la forêt nicaraguayenne.
100Dilara86
>98 raton-liseur: Too bad this book wasn't as good as it could have been...
101raton-liseur
>100 Dilara86: Well, I am always drawn to books about books or libraries, but in the end, I feel I am quite often disappointed. Maybe I should start to avoid them?
102raton-liseur
91. 62. (46) Grand-peur et misère du IIIe Reich de Bertolt Brecht, traduit de l'allemand par Pierre Vesperini
Titre original : Furcht und Elend des Dritten Reiches
Titre en anglais : Fear and Misery of the Third Reich


J’ai eu la chance de voir cette pièce au théâtre il y a quelques semaines, dans la toute nouvelle mise en scène de Julie Duclos. Pièce de théâtre, mais surtout collection de scénettes qui, je l’ai appris grâce à la postface du traducteur, sont le fruit d’un patient travail de collecte d’articles et de témoignages entrepris par Brecht dès le début de son exil d’Allemagne. Dans une interview qui accompagnait le programme, Julie Duclos expliquait que ces différents tableaux, sans lien entre eux, s’intéressent au moment où le nazisme devient réalité, et réalité sombre bien sûr, dans la vie des personnages. C’est probablement un raccourci, mais en même temps un bon résumé de ce qu’est cette pièce.
J’ai mis un peu de temps à rentrer dans la pièce lorsque je l’ai lue, en partie à cause de l’absence de lien entre les tableaux. Mais j’ai fini par trouver un rythme de lecture satisfaisant et j’ai pu goûter à toute l’amertume que distillent ces scènes. On ne voit pas grand-chose de l’horreur du nazisme, à part quelques allusions aux camps de travail et aux méthodes musclées de la milice. Là où Brecht est particulièrement efficace, c’est effectivement dans la capacité à dépeindre comment la main-mise sur la société percole de façon insidieuse jusque dans le plus intime des vies. En cela, « La Femme Juive » (un des tableaux les plus célèbres, semble-t-il, et c’est justifié) et « Le Mouchard », sont les plus glaçants dans leur façon de mettre en scène l’altération des relations familiales à l’air du contrôle des esprits. D’autres font sourire, voire presque rire (jaune, bien sûr), comme « Physiciens » ; d’autres ne peuvent qu’atterrer, par exemple « Secours d’hiver », ou bien d’autres encore sont poignantes, comme « Trouver le droit » ou « Le Combattant de la première heure ».
Bien sûr, il n’est pas possible de lire ou de regarder cette pièce sans penser à la situation actuelle. Cette pièce a été écrite entre 1935 et 1938, donc bien avant le déploiement à grande échelle de la force nazie, ce qui peut-être la rend encore plus forte, car on réalise à quel point il n’a pas fallu beaucoup de temps pour que le nazisme s’infiltre dans les moindres interstices de la société, pour que ce ne soient plus seulement les opposants directs et les ennemis désignés, qui soient touchés par la férule nazie. Quand on pense à cette citation de Martin Niemöller, « Quand les nazis sont venus chercher les communistes / les syndicalistes / les juifs, je n’ai rien dit, je n’étais pas communiste / syndicaliste / juif. », on se rend compte qu’on est arrivé en à peine une poignée d’année à sa conclusion, « Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. »
La pièce a ensuite été créée en 1938 à Paris sous le nom énigmatique de 99 % (le score des nazis lors de leurs plébiscites, mais un titre suffisamment obscur pour ne pas froisser les autorités allemandes et passer l’étape de la censure, puis en 1945 aux Etats-Unis, avec le titre de The Private Life of The Master Race (quelque chose comme La Vie privée de la race dominante). Et Brecht, conscient que la valeur de témoignage de sa pièce ne s’éteignait pas avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, a dit que sa pièce « ne sera plus un acte d’accusation. Mais [elle] sera peut-être encore un avertissement ». On ne peut pas mieux dire, et on ne peut que lire cette pièce, ou aller la voir jouer.
Titre original : Furcht und Elend des Dritten Reiches
Titre en anglais : Fear and Misery of the Third Reich


J’ai eu la chance de voir cette pièce au théâtre il y a quelques semaines, dans la toute nouvelle mise en scène de Julie Duclos. Pièce de théâtre, mais surtout collection de scénettes qui, je l’ai appris grâce à la postface du traducteur, sont le fruit d’un patient travail de collecte d’articles et de témoignages entrepris par Brecht dès le début de son exil d’Allemagne. Dans une interview qui accompagnait le programme, Julie Duclos expliquait que ces différents tableaux, sans lien entre eux, s’intéressent au moment où le nazisme devient réalité, et réalité sombre bien sûr, dans la vie des personnages. C’est probablement un raccourci, mais en même temps un bon résumé de ce qu’est cette pièce.
J’ai mis un peu de temps à rentrer dans la pièce lorsque je l’ai lue, en partie à cause de l’absence de lien entre les tableaux. Mais j’ai fini par trouver un rythme de lecture satisfaisant et j’ai pu goûter à toute l’amertume que distillent ces scènes. On ne voit pas grand-chose de l’horreur du nazisme, à part quelques allusions aux camps de travail et aux méthodes musclées de la milice. Là où Brecht est particulièrement efficace, c’est effectivement dans la capacité à dépeindre comment la main-mise sur la société percole de façon insidieuse jusque dans le plus intime des vies. En cela, « La Femme Juive » (un des tableaux les plus célèbres, semble-t-il, et c’est justifié) et « Le Mouchard », sont les plus glaçants dans leur façon de mettre en scène l’altération des relations familiales à l’air du contrôle des esprits. D’autres font sourire, voire presque rire (jaune, bien sûr), comme « Physiciens » ; d’autres ne peuvent qu’atterrer, par exemple « Secours d’hiver », ou bien d’autres encore sont poignantes, comme « Trouver le droit » ou « Le Combattant de la première heure ».
Bien sûr, il n’est pas possible de lire ou de regarder cette pièce sans penser à la situation actuelle. Cette pièce a été écrite entre 1935 et 1938, donc bien avant le déploiement à grande échelle de la force nazie, ce qui peut-être la rend encore plus forte, car on réalise à quel point il n’a pas fallu beaucoup de temps pour que le nazisme s’infiltre dans les moindres interstices de la société, pour que ce ne soient plus seulement les opposants directs et les ennemis désignés, qui soient touchés par la férule nazie. Quand on pense à cette citation de Martin Niemöller, « Quand les nazis sont venus chercher les communistes / les syndicalistes / les juifs, je n’ai rien dit, je n’étais pas communiste / syndicaliste / juif. », on se rend compte qu’on est arrivé en à peine une poignée d’année à sa conclusion, « Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. »
La pièce a ensuite été créée en 1938 à Paris sous le nom énigmatique de 99 % (le score des nazis lors de leurs plébiscites, mais un titre suffisamment obscur pour ne pas froisser les autorités allemandes et passer l’étape de la censure, puis en 1945 aux Etats-Unis, avec le titre de The Private Life of The Master Race (quelque chose comme La Vie privée de la race dominante). Et Brecht, conscient que la valeur de témoignage de sa pièce ne s’éteignait pas avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, a dit que sa pièce « ne sera plus un acte d’accusation. Mais [elle] sera peut-être encore un avertissement ». On ne peut pas mieux dire, et on ne peut que lire cette pièce, ou aller la voir jouer.
103raton-liseur
96. -. (-) Le plus beau vœu de Mini-Taupe de Sang-Keun Kim, tadapté du coréen par Lim Yeong-hee
Titre original : non relevé
Titre en anglais : Little Mole's Wish


Merci aux éditions Sens dessus dessous de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
Encore des dessins tout doux. Je dis encore, parce que j’ai déjà lu un livre de cet auteur jeunesse coréen l’année dernière, Qui se cache dans la grotte ?. Les deux fois, ce sont les dessins qui ont d’abord attiré mon œil, et j’ai été heureuse de retrouver ces couleurs pastels, ces dégradés qui sont comme une jolie couverture sous laquelle se lover au côté d’un adulte qui nous lira cette histoire.
Et ici cela tombe bien, puisqu’on est dans la grande tradition des albums d’hiver. Mini-Taupe (qui a connu d’autres aventures, mais que moi je n’avais jamais rencontrée) se sent un peu seule et fait d’une boule de neige son nouvel ami. S’en suit une promesse, un vœu, une désillusion et puis une jolie fin.
Je n’ai pas retrouvé le caractère original du précédent livre de Sang-Keun Kim. Ici, il ne joue pas avec les genres, à part peut-être une fin assez ouverte, qui peut laisser place à des interprétations diverses. Le livre tient avant tout par ses dessins, par le dialogue entre ces dessins et le texte puisque le texte nous permet de plonger dans les pensées de Mini-Taupe alors que ce sont principalement les dessins qui nous informent sur ce qu’elle fait, et par cette douceur et cette nostalgie même qui se dégage de ce livre et de sa toute mignonne histoire avec une toute mignonne petite héroïne.
Titre original : non relevé
Titre en anglais : Little Mole's Wish


Merci aux éditions Sens dessus dessous de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
Encore des dessins tout doux. Je dis encore, parce que j’ai déjà lu un livre de cet auteur jeunesse coréen l’année dernière, Qui se cache dans la grotte ?. Les deux fois, ce sont les dessins qui ont d’abord attiré mon œil, et j’ai été heureuse de retrouver ces couleurs pastels, ces dégradés qui sont comme une jolie couverture sous laquelle se lover au côté d’un adulte qui nous lira cette histoire.
Et ici cela tombe bien, puisqu’on est dans la grande tradition des albums d’hiver. Mini-Taupe (qui a connu d’autres aventures, mais que moi je n’avais jamais rencontrée) se sent un peu seule et fait d’une boule de neige son nouvel ami. S’en suit une promesse, un vœu, une désillusion et puis une jolie fin.
Je n’ai pas retrouvé le caractère original du précédent livre de Sang-Keun Kim. Ici, il ne joue pas avec les genres, à part peut-être une fin assez ouverte, qui peut laisser place à des interprétations diverses. Le livre tient avant tout par ses dessins, par le dialogue entre ces dessins et le texte puisque le texte nous permet de plonger dans les pensées de Mini-Taupe alors que ce sont principalement les dessins qui nous informent sur ce qu’elle fait, et par cette douceur et cette nostalgie même qui se dégage de ce livre et de sa toute mignonne histoire avec une toute mignonne petite héroïne.
104labfs39
>99 raton-liseur: You say this is not the place to start with Luis Sepúlveda, I have not read him, where would you recommend beginning?
>102 raton-liseur: This sounds interesting. How was the production?
>103 raton-liseur: I appreciate your reviews of children's books, as I try to read my nieces as much world literature as I can.
>102 raton-liseur: This sounds interesting. How was the production?
>103 raton-liseur: I appreciate your reviews of children's books, as I try to read my nieces as much world literature as I can.
105raton-liseur
>104 labfs39: Re. Sepúlveda, his most famous work is Le Vieux qui lisait des romans d'amour / The Old Man Who Read Love Stories but this is not my favourite work at all.
Sepúlveda has two main inspiration lines: one is nature and ecology, the other is political emprisonment and exile. So I guess, it could depend on what you'd prefer. On the nature and ecology front, I would recommend Le monde du bout du monde but it's not translated in English... On the exile front, I would suggest Le Neveu d'Amérique / Patagonia Express or the wonderful L'Ombre de ce que nous avons été / The Shadow of What We Were. Un nom de torero / The Name of a Bullfighter is also a good place to start as it's a good one and it mixes a bit the idea of exile and the idea of ecology (and there is nothing about bullfight, except the name of the main character, Belmonte, which is the name of a famou bullfighter).
Re. Brecht, I think we all enjoyed the production, including M'ni Raton who was not that happy to come but ended up saying that it was not bad after all... The producer did a great job choosing the parts to be included and the order.
It was one of the first performances, so it was not all totally tied up, but that's ok. At the end, most of the audience stood up, but I feel it was more of an emotional reaction to the subject and what it means compared to today's politics in France and other countries. And I can't explain exactly why, but it did not feel right.
If you come and watch that play, I guess that you already have certain political views. By making a standing ovation, I felt like people were thinking it's just necessary to keep on saying that the far right wing is like nazism to convince people not to vote for them. But it is clear that today, this argument is not enough anymore. So it will take more than this play to change the political climate...
Not sure I am clear, but basically, yes it was a good play but it will have a limited impact, so I enjoyed it but it did not make anything to uplift my spirit...
Sepúlveda has two main inspiration lines: one is nature and ecology, the other is political emprisonment and exile. So I guess, it could depend on what you'd prefer. On the nature and ecology front, I would recommend Le monde du bout du monde but it's not translated in English... On the exile front, I would suggest Le Neveu d'Amérique / Patagonia Express or the wonderful L'Ombre de ce que nous avons été / The Shadow of What We Were. Un nom de torero / The Name of a Bullfighter is also a good place to start as it's a good one and it mixes a bit the idea of exile and the idea of ecology (and there is nothing about bullfight, except the name of the main character, Belmonte, which is the name of a famou bullfighter).
Re. Brecht, I think we all enjoyed the production, including M'ni Raton who was not that happy to come but ended up saying that it was not bad after all... The producer did a great job choosing the parts to be included and the order.
It was one of the first performances, so it was not all totally tied up, but that's ok. At the end, most of the audience stood up, but I feel it was more of an emotional reaction to the subject and what it means compared to today's politics in France and other countries. And I can't explain exactly why, but it did not feel right.
If you come and watch that play, I guess that you already have certain political views. By making a standing ovation, I felt like people were thinking it's just necessary to keep on saying that the far right wing is like nazism to convince people not to vote for them. But it is clear that today, this argument is not enough anymore. So it will take more than this play to change the political climate...
Not sure I am clear, but basically, yes it was a good play but it will have a limited impact, so I enjoyed it but it did not make anything to uplift my spirit...
106raton-liseur
93. 64. (47) Les Ames de feu d'Annie Francé-Harrar, traduit de l'allemand (Autriche) par Erwann Perchoc
Titre original : Feuerseelen
Titre en anglais : non traduit


Depuis que j’ai vu que ce livre était paru, à chaque fois que je le mentionne, on me répond : « Oh oui, il faut vraiment que je le lise, ça paraît tellement intriguant. » Alors, il était temps que je me mette effectivement à le lire. Parce que, intriguant, oui il l’est : un livre de SF allemand paru en 1920, et écrit par une pédologue. Ça fait beaucoup de choses inhabituelles, non ?
Je trouve, souvent, que la SF vieillit assez mal et qu’on ne peut apprécier la SF d’il y a quelques décennies que remise dans son contexte. C’est le cas ici. L’histoire n’est pas mirobolante et les trouvailles futuristes pas très originales (vues avec un siècle de distance). Mais l’intérêt de cette œuvre n’est pas là. Ou si, peut-être, justement. C’est le fait que l’histoire paraisse tellement proche de notre présent qui est glaçant, parce que bien sûr, cette civilisation fonce tête baissée vers la catastrophe.
Comment, effectivement, ne pas se reconnaître dans cette civilisation qui s’est elle-même baptisée Culture (avec une majuscule) et qui a relégué la Nature aussi loin que possible, faisant de tout ce qui a trait à l’agriculture ou à la nature quelque chose de dégradant, repoussant. Tout est artificiel dans ce monde : le travail pénible est fait par des robots (bon, ça, ça serait bien…), la nourriture est synthétisée à partir de l’atmosphère, la composition de l’air est modifiée, la météorologie est maîtrisée… Et tout cela s’accompagne comme il se doit d’une jolie petite dictature, mais tout cela évidemment pour le bien du peuple.
Alors comment ne pas penser à notre propre civilisation, dont le lien à la nature et aux réalités des cycles physiques, chimiques et biologiques s’étiole de plus en plus. Mais à force de puiser dans une ressource que l’on croit infinie mais qui ne l’est pas, les cycles se dérèglent, la machine Nature s’emballe, et les systèmes de vie artificiels s’effondrent comme le jeu de cartes qu’ils sont.
Rien de bien nouveau ici, sauf peut-être cette dénonciation de l’artificialisation à outrance, qui prend le contre-pied de certaines utopies technicistes, et que j’ai rarement vue être un ressort aussi prépondérant non de l’intrigue, mais de la chute d’un monde. Et c’est là, bien sûr que la profession de l’autrice se fait sentir.
Mais un point que j’ai particulièrement noté, c’est la relation entre les scientifiques et les politiques. Là aussi, j’imagine qu’il y a probablement une part d’expérience, mais il est intéressant de voir à quel point les relations décrites ne diffèrent guère de ce que l’on observe aujourd’hui entre les scientifiques du GIEC (ou d’autres instituts) et les politiciens. La même volonté de ne pas faire peur aux foules, de mettre la tête dans le sable en pensant que le pire n’adviendra pas tant qu’on fera semblant de l’ignorer.
Ce livre est finalement très intéressant par sa ressemblance avec notre monde actuel. Pas une ressemblance factuelle, mais une ressemblance dans les ressorts de sa société et de sa culture (je ne sais pas si Philippe Descola lira ce bouquin, mais cette dichotomie Nature-Culture poussée à outrance et dénoncée par cette façon même de la porter à son paroxysme m’a plus d’une fois rappelé comment ses travaux d’anthropologue ont fait bougé notre vision de ces concepts) et une ressemblance dans le lien entre pouvoir et savoir (ou plutôt recherche, ce n’est pas la même chose !).
Le fait que ce livre plus réaliste que futuriste condamne la société à s’effondrer dans un mélange de feu, de peur et de résignation n’est pas pour nous rassurer. On a un peu l’impression qu’avec nos rêves technicistes et nos chimères de démiurge, nous nous condamnons nous-mêmes à la disparition. Une lueur d’espoir semble demeurer tout de même dans le travail simple et en prise directe avec la terre. Je ne suis pas toujours très à l’aise avec la façon un peu caricaturale dont un certain « c’était mieux avant » est mis en scène. Personnellement, si un avenir est encore possible pour notre planète, je suis persuadée qu’il sera différent de notre présent, mais j’espère aussi qu’il sera différent de notre passé, que l’on pourra quand même garder quelques aspects positifs de notre société actuelle (l’accès facilité aux livres et aux autres formes de culture en étant un sur lequel on peut tous être d’accord ici, d’autres seront plus controversés mais sont pour moi positifs, comme un relâchement du lien entre sexe biologique et assignation genrée – je ne dis pas que tout cela est idéal dans notre société, mais il y a eu quelques évolutions depuis quelques décennies tout de même, je me prends parfois à espérer que là, on peut parler de progrès, même si c’est un processus et que le chemin à parcourir est encore bien long. Mais je m’éloigne vraiment trop de mon sujet, là...)
C’est un livre intriguant donc, la première impression est la bonne. Un livre intéressant aussi, à lire pour voir ce qu’une scientifique naturaliste d’il y a un siècle peut nous dire sur notre société d’aujourd’hui.
Titre original : Feuerseelen
Titre en anglais : non traduit


Depuis que j’ai vu que ce livre était paru, à chaque fois que je le mentionne, on me répond : « Oh oui, il faut vraiment que je le lise, ça paraît tellement intriguant. » Alors, il était temps que je me mette effectivement à le lire. Parce que, intriguant, oui il l’est : un livre de SF allemand paru en 1920, et écrit par une pédologue. Ça fait beaucoup de choses inhabituelles, non ?
Je trouve, souvent, que la SF vieillit assez mal et qu’on ne peut apprécier la SF d’il y a quelques décennies que remise dans son contexte. C’est le cas ici. L’histoire n’est pas mirobolante et les trouvailles futuristes pas très originales (vues avec un siècle de distance). Mais l’intérêt de cette œuvre n’est pas là. Ou si, peut-être, justement. C’est le fait que l’histoire paraisse tellement proche de notre présent qui est glaçant, parce que bien sûr, cette civilisation fonce tête baissée vers la catastrophe.
Comment, effectivement, ne pas se reconnaître dans cette civilisation qui s’est elle-même baptisée Culture (avec une majuscule) et qui a relégué la Nature aussi loin que possible, faisant de tout ce qui a trait à l’agriculture ou à la nature quelque chose de dégradant, repoussant. Tout est artificiel dans ce monde : le travail pénible est fait par des robots (bon, ça, ça serait bien…), la nourriture est synthétisée à partir de l’atmosphère, la composition de l’air est modifiée, la météorologie est maîtrisée… Et tout cela s’accompagne comme il se doit d’une jolie petite dictature, mais tout cela évidemment pour le bien du peuple.
Alors comment ne pas penser à notre propre civilisation, dont le lien à la nature et aux réalités des cycles physiques, chimiques et biologiques s’étiole de plus en plus. Mais à force de puiser dans une ressource que l’on croit infinie mais qui ne l’est pas, les cycles se dérèglent, la machine Nature s’emballe, et les systèmes de vie artificiels s’effondrent comme le jeu de cartes qu’ils sont.
Rien de bien nouveau ici, sauf peut-être cette dénonciation de l’artificialisation à outrance, qui prend le contre-pied de certaines utopies technicistes, et que j’ai rarement vue être un ressort aussi prépondérant non de l’intrigue, mais de la chute d’un monde. Et c’est là, bien sûr que la profession de l’autrice se fait sentir.
Mais un point que j’ai particulièrement noté, c’est la relation entre les scientifiques et les politiques. Là aussi, j’imagine qu’il y a probablement une part d’expérience, mais il est intéressant de voir à quel point les relations décrites ne diffèrent guère de ce que l’on observe aujourd’hui entre les scientifiques du GIEC (ou d’autres instituts) et les politiciens. La même volonté de ne pas faire peur aux foules, de mettre la tête dans le sable en pensant que le pire n’adviendra pas tant qu’on fera semblant de l’ignorer.
Ce livre est finalement très intéressant par sa ressemblance avec notre monde actuel. Pas une ressemblance factuelle, mais une ressemblance dans les ressorts de sa société et de sa culture (je ne sais pas si Philippe Descola lira ce bouquin, mais cette dichotomie Nature-Culture poussée à outrance et dénoncée par cette façon même de la porter à son paroxysme m’a plus d’une fois rappelé comment ses travaux d’anthropologue ont fait bougé notre vision de ces concepts) et une ressemblance dans le lien entre pouvoir et savoir (ou plutôt recherche, ce n’est pas la même chose !).
Le fait que ce livre plus réaliste que futuriste condamne la société à s’effondrer dans un mélange de feu, de peur et de résignation n’est pas pour nous rassurer. On a un peu l’impression qu’avec nos rêves technicistes et nos chimères de démiurge, nous nous condamnons nous-mêmes à la disparition. Une lueur d’espoir semble demeurer tout de même dans le travail simple et en prise directe avec la terre. Je ne suis pas toujours très à l’aise avec la façon un peu caricaturale dont un certain « c’était mieux avant » est mis en scène. Personnellement, si un avenir est encore possible pour notre planète, je suis persuadée qu’il sera différent de notre présent, mais j’espère aussi qu’il sera différent de notre passé, que l’on pourra quand même garder quelques aspects positifs de notre société actuelle (l’accès facilité aux livres et aux autres formes de culture en étant un sur lequel on peut tous être d’accord ici, d’autres seront plus controversés mais sont pour moi positifs, comme un relâchement du lien entre sexe biologique et assignation genrée – je ne dis pas que tout cela est idéal dans notre société, mais il y a eu quelques évolutions depuis quelques décennies tout de même, je me prends parfois à espérer que là, on peut parler de progrès, même si c’est un processus et que le chemin à parcourir est encore bien long. Mais je m’éloigne vraiment trop de mon sujet, là...)
C’est un livre intriguant donc, la première impression est la bonne. Un livre intéressant aussi, à lire pour voir ce qu’une scientifique naturaliste d’il y a un siècle peut nous dire sur notre société d’aujourd’hui.
107raton-liseur
97. 66. (-) Maï, une femme effacée de Geetanjali Shree, traduit du hindi (Inde) par Annie Montaut
Titre original : Mai
Titre en anglais : Mai:Silently Mother


Merci aux éditions Des femmes - Antoinette Fouque de m’avoir permis de découvrir ce livre, via la masse critique de Babelio.
J’ai écouté une interview de cette autrice il y a trois-quatre mois dans mon émission préférée de RFI, Littérature sans frontières, et j’avais failli me laisser tenter par ce livre, écrit en hindi (donc dont le lectorat prioritaire n’est clairement pas occidental, et c’est un point qu’il me paraît important de souligner) et qui semblait présenter une vision du féminisme à l’indienne plus complexe que ce que l’on pourrait entrapercevoir après un rapide coup d’œil. Mais ce n’est que quand ce titre est apparu dans la liste pour la Masse critique de la rentrée que je me suis dit que les atermoiements n’étaient plus de mise et qu’il fallait que je franchisse enfin le pas. Et me voilà, quelques semaines plus tard, de l’autre côté de ce livre.
Un livre qui se passe dans une Inde rurale, dans une famille à la fois aisée (ce sont des propriétaires terriens) et du bon côté dans le système des castes (même si leur caste précise n’est pas mentionnée). L’époque m’a paru plus difficile à déterminer : les grands bouleversements politiques ne sont même pas évoqués (il est bien question d’une guerre à un moment, mais je ne sais pas laquelle…), tant ils ont peu de résonance dans le mode de vie de cette famille. Ce sont les changements dans la vie quotidienne qui pourraient nous éclairer, mais je ne sais pas quand les réfrigérateurs sont arrivés dans le quotidien des familles aisées rurales de cette partie de l’Inde. Un lecteur indien le saurait, mais moi non… Donc on est quelque part dans la moitié du XXème siècle, mais je ne pourrai pas être plus précise.
Et dans ce lieu et dans ce temps, une jeune femme, Sounaïna, raconte son enfance et ses premières années d’adulte. Une enfance entre un grand-père distant et inflexible, une grand-mère geignarde et capricieuse, un père absent et sans consistance. Et surtout, une enfance avec une mère aimante et, comme le souligne le titre, effacée. Car la narratrice ne fait pas le portrait de ses années à elle, elle utilise la trame de son enfance pour nous raconter sa mère. Une femme indienne dans le plus pur respect de la tradition : aux ordres de tous dans la maison, qui s’oublie en permanence pour servir les autres et qui ne reçoit pour cela aucun remerciement, mais même au contraire des plaintes quasi permanentes parce qu’elle n’en fait jamais assez ; une femme toujours voilée modestement dans son pardah, qui ne lève jamais les yeux et n’émet jamais une plainte.
Sounaïna, ainsi que son frère Soubodh, sont élevés de façon étrange, dans une famille traditionnelle et qui veut maintenir ces traditions, tout en ayant une fascination pour la culture du colon (ou ex-colon, je pense que le statut change au cours du livre, même si je ne sais pas exactement où). Ils vont donc dans des écoles anglaises, parlent parfois mieux l’anglais que l’hindi (ou le dialecte de la grand-mère). Si l’on voit vite que les contraintes sont différentes pour le garçon et pour la fille, on voit rapidement les injonctions contradictoires auxquelles est soumise Sounaïna, qui doit d’un côté être modeste, se dérober aux regards dès que quelqu’un pénètre dans la maison et espérer faire un bon mariage arrangé, mais qui apprendre à danser tant que c’est sur de la musique anglaise et même porter des vêtements à la mode occidentale.
Mais cette position entre les deux cultures leur révèle à quel point leur mère est elle engluée dans les contraintes de la tradition et ils se jurent, dès leur plus jeune âge, de l’arracher à cette condition. Et c’est cette relation particulière et asymétrique entre les enfants et leur mère qui fait la trame de ce récit. On voit les enfants tenter de comprendre ce qui enferme leur mère et chercher à déjouer ces pièges. Et à travers tous ces gestes, petits mais lourds de sens, que l’on comprend mieux le fonctionnement de cette famille. Et bien sûr, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Les résistances sont bien sûr dans les membres de la famille, mais aussi, et c’est là que ce portrait de femme est original, en Maï elle-même. Ses enfants veulent la sauver mais elle, veut-elle être sauvée ?
Et c’est alors que se peint un portrait tout en nuances, d’une femme à la fois soumise aux traditions, mais qui accepte cette soumission, qui en fait une sorte de colonne vertébrale de sa vie (une image ironique, lorsque l’on sait que Maï aura très vite le dos abîmé et douloureux de rester tout le temps courbée pour accomplir ses innombrables tâches domestiques. Une femme aussi, qui si elle accepte son sort, une vraie acceptation, pas une résignation, veut permettre à ses enfants de s’envoler et à sa fille de connaître un autre destin. Et pour cela, elle sait aussi jouer de sa position dans le foyer et finalement, on s’aperçoit que, lorsqu’il ne s’agit pas directement d’elle, elle sait tourner la situation à l’avantage qu’elle est déterminée à obtenir.
Malgré ce que je viens d’écrire, ce livre n’est en aucun cas un livre qui nierait le féminisme (si c’était le cas, il n’aurait pas été publié par les éditions Des femmes !). C’est un livre qui montre qu’il y a plusieurs voies de réalisation pour une femme, que l’émancipation est un chemin personnel et que l’accomplissement de soi est un choix qui appartient à chacun. En définitive, et malgré le titre, il me semble qu’il y a deux femmes qui occupent le centre de ce récit : la Maï du titre et la Sounaïna narratrice, la mère et la fille, qui toutes deux, à une génération d’écart et une éducation de différence, doivent apprendre à faire leur chemin et à affirmer leurs choix, dans un monde qui évolue et qui présente des opportunités autant que des contraintes. Un livre qui, malgré les apparences, est complexe et qui donne à réfléchir.
Titre original : Mai
Titre en anglais : Mai:Silently Mother


Merci aux éditions Des femmes - Antoinette Fouque de m’avoir permis de découvrir ce livre, via la masse critique de Babelio.
J’ai écouté une interview de cette autrice il y a trois-quatre mois dans mon émission préférée de RFI, Littérature sans frontières, et j’avais failli me laisser tenter par ce livre, écrit en hindi (donc dont le lectorat prioritaire n’est clairement pas occidental, et c’est un point qu’il me paraît important de souligner) et qui semblait présenter une vision du féminisme à l’indienne plus complexe que ce que l’on pourrait entrapercevoir après un rapide coup d’œil. Mais ce n’est que quand ce titre est apparu dans la liste pour la Masse critique de la rentrée que je me suis dit que les atermoiements n’étaient plus de mise et qu’il fallait que je franchisse enfin le pas. Et me voilà, quelques semaines plus tard, de l’autre côté de ce livre.
Un livre qui se passe dans une Inde rurale, dans une famille à la fois aisée (ce sont des propriétaires terriens) et du bon côté dans le système des castes (même si leur caste précise n’est pas mentionnée). L’époque m’a paru plus difficile à déterminer : les grands bouleversements politiques ne sont même pas évoqués (il est bien question d’une guerre à un moment, mais je ne sais pas laquelle…), tant ils ont peu de résonance dans le mode de vie de cette famille. Ce sont les changements dans la vie quotidienne qui pourraient nous éclairer, mais je ne sais pas quand les réfrigérateurs sont arrivés dans le quotidien des familles aisées rurales de cette partie de l’Inde. Un lecteur indien le saurait, mais moi non… Donc on est quelque part dans la moitié du XXème siècle, mais je ne pourrai pas être plus précise.
Et dans ce lieu et dans ce temps, une jeune femme, Sounaïna, raconte son enfance et ses premières années d’adulte. Une enfance entre un grand-père distant et inflexible, une grand-mère geignarde et capricieuse, un père absent et sans consistance. Et surtout, une enfance avec une mère aimante et, comme le souligne le titre, effacée. Car la narratrice ne fait pas le portrait de ses années à elle, elle utilise la trame de son enfance pour nous raconter sa mère. Une femme indienne dans le plus pur respect de la tradition : aux ordres de tous dans la maison, qui s’oublie en permanence pour servir les autres et qui ne reçoit pour cela aucun remerciement, mais même au contraire des plaintes quasi permanentes parce qu’elle n’en fait jamais assez ; une femme toujours voilée modestement dans son pardah, qui ne lève jamais les yeux et n’émet jamais une plainte.
Sounaïna, ainsi que son frère Soubodh, sont élevés de façon étrange, dans une famille traditionnelle et qui veut maintenir ces traditions, tout en ayant une fascination pour la culture du colon (ou ex-colon, je pense que le statut change au cours du livre, même si je ne sais pas exactement où). Ils vont donc dans des écoles anglaises, parlent parfois mieux l’anglais que l’hindi (ou le dialecte de la grand-mère). Si l’on voit vite que les contraintes sont différentes pour le garçon et pour la fille, on voit rapidement les injonctions contradictoires auxquelles est soumise Sounaïna, qui doit d’un côté être modeste, se dérober aux regards dès que quelqu’un pénètre dans la maison et espérer faire un bon mariage arrangé, mais qui apprendre à danser tant que c’est sur de la musique anglaise et même porter des vêtements à la mode occidentale.
Mais cette position entre les deux cultures leur révèle à quel point leur mère est elle engluée dans les contraintes de la tradition et ils se jurent, dès leur plus jeune âge, de l’arracher à cette condition. Et c’est cette relation particulière et asymétrique entre les enfants et leur mère qui fait la trame de ce récit. On voit les enfants tenter de comprendre ce qui enferme leur mère et chercher à déjouer ces pièges. Et à travers tous ces gestes, petits mais lourds de sens, que l’on comprend mieux le fonctionnement de cette famille. Et bien sûr, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Les résistances sont bien sûr dans les membres de la famille, mais aussi, et c’est là que ce portrait de femme est original, en Maï elle-même. Ses enfants veulent la sauver mais elle, veut-elle être sauvée ?
Et c’est alors que se peint un portrait tout en nuances, d’une femme à la fois soumise aux traditions, mais qui accepte cette soumission, qui en fait une sorte de colonne vertébrale de sa vie (une image ironique, lorsque l’on sait que Maï aura très vite le dos abîmé et douloureux de rester tout le temps courbée pour accomplir ses innombrables tâches domestiques. Une femme aussi, qui si elle accepte son sort, une vraie acceptation, pas une résignation, veut permettre à ses enfants de s’envoler et à sa fille de connaître un autre destin. Et pour cela, elle sait aussi jouer de sa position dans le foyer et finalement, on s’aperçoit que, lorsqu’il ne s’agit pas directement d’elle, elle sait tourner la situation à l’avantage qu’elle est déterminée à obtenir.
Malgré ce que je viens d’écrire, ce livre n’est en aucun cas un livre qui nierait le féminisme (si c’était le cas, il n’aurait pas été publié par les éditions Des femmes !). C’est un livre qui montre qu’il y a plusieurs voies de réalisation pour une femme, que l’émancipation est un chemin personnel et que l’accomplissement de soi est un choix qui appartient à chacun. En définitive, et malgré le titre, il me semble qu’il y a deux femmes qui occupent le centre de ce récit : la Maï du titre et la Sounaïna narratrice, la mère et la fille, qui toutes deux, à une génération d’écart et une éducation de différence, doivent apprendre à faire leur chemin et à affirmer leurs choix, dans un monde qui évolue et qui présente des opportunités autant que des contraintes. Un livre qui, malgré les apparences, est complexe et qui donne à réfléchir.
108raton-liseur
I have not read many graphic books since the beginning of the year, at least, less than usual, and I don't really know why. I just happened. But things might change from now on: I requested and received two graphic works from netgalley, and then the graphic novel prize season has started again in my village library. So in the past few days, I've read four graphic works in a row, and I should carry keep on reading more.
109raton-liseur
100. 15g. (-) Mémoires de gris de Sylvain Ferret
Titre en anglais : non traduit
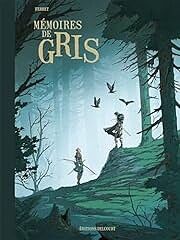

Merci aux éditions Delcourt de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
C’est la couverture qui m’a attirée, et surtout le résumé qui mêlait dans la même phrase carcan de la violence et rêve de liberté. Et cette bd, qui se passe dans un moyen âge fantasmé, tient toutes ses promesses. Le dessin est somptueux, un vrai régal pour les yeux malgré ses teintes très sombres, et l’histoire m’a parue plutôt originale, jouant avec les codes du genre. L’opposition entre un monde pétri d’une violence présente dans chaque rouage de la société et des personnages qui veulent dépasser leur condition et la place qui leur est assignée dans cette même société est présente, mais traitée avec sans manichéisme ni simplification. Tous les personnages sont torturés, tous ont un côté sombre, les héros au sens usuel du terme sont absents de ce roman graphique, ce qui rend la lecture à la fois captivante et surprenante.
Une très belle découverte, je crois que je vais voir si la bibliothèque de mon village peut l’acheter !
Titre en anglais : non traduit
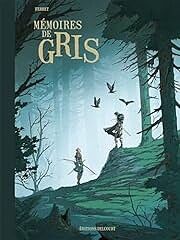

Merci aux éditions Delcourt de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
C’est la couverture qui m’a attirée, et surtout le résumé qui mêlait dans la même phrase carcan de la violence et rêve de liberté. Et cette bd, qui se passe dans un moyen âge fantasmé, tient toutes ses promesses. Le dessin est somptueux, un vrai régal pour les yeux malgré ses teintes très sombres, et l’histoire m’a parue plutôt originale, jouant avec les codes du genre. L’opposition entre un monde pétri d’une violence présente dans chaque rouage de la société et des personnages qui veulent dépasser leur condition et la place qui leur est assignée dans cette même société est présente, mais traitée avec sans manichéisme ni simplification. Tous les personnages sont torturés, tous ont un côté sombre, les héros au sens usuel du terme sont absents de ce roman graphique, ce qui rend la lecture à la fois captivante et surprenante.
Une très belle découverte, je crois que je vais voir si la bibliothèque de mon village peut l’acheter !
110raton-liseur
101. 16g. (-) Henri de Turenne : Sur le front de Corée de Stéphane Marchetti (scénario) et Rafael Ortiz (dessin)
Titre en anglais : non traduit



Merci aux éditions Dupuis de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
Il se trouve que j’ai lu quelques livres qui faisaient référence à la guerre de Corée ces derniers temps, le plus notable étant bien sûr celui de Han Kang, la nouvelle Prix Nobel de littérature, Impossibles adieux. Et je me faisais la réflexion que je connaissais bien peu cette page de l’histoire récente. Alors quand j’ai vu ce livre parmi les nouvelles publications des éditions Dupuis, je me suis dit que c’était une bonne façon pour commencer à remédier à mon ignorance. J’ai plus appris sur Henri de Turenne (que je ne connaissais pas du tout) que sur la guerre de Corée, mais vu l’angle de cette nouvelle collection « Prix Albert Londres » que viennent de lancer les éditions Dupuis, je suppose que c’est normal. Même si, peut-être, j’aurais préféré en apprendre plus sur le contenu des articles.
Ici, ce qui est principalement mis en avant, ce sont les difficiles conditions d’exercice du métier de journaliste de guerre. Le courage que cela demande, les risques qui peuvent aller jusqu’à la mort ou les camps de travail Nord-Coréens. On suit principalement Henri de Turenne dans son avancée au gré des actions militaires, dans les traces de l’armée américano-onusienne. La question de la responsabilité journalistique est aussi évoquée, bien que de façon assez légère, notamment à travers la tension entre droit d’informer et respect du secret militaire, ou bien lors d’un épisode assez marquant : Henri de Turenne est associé à un scoop par un collègue américain et assiste, caché, à des exécutions sommaires de sympathisants nord-coréens par l’armée sud-coréenne. Et il décide de ne pas écrire dessus, pensant que cela le rendrait complice. Que son rôle de spectateur passif lui pèse, à ce moment-là en particulier, je le comprends. Mais j’ai du mal à comprendre sa décision de ne pas rapporter cette information cruciale. N’est-ce pas se rendre complice aussi que de ne pas relayer cette information et donner alors une vision partiale de la situation ? Je ne trancherai pas, c’est trop facile à distance (géographique autant que temporelle), mais la question mérite d’être posée.
Au final, j’ai tout de même appris beaucoup sur cette guerre de Corée, même si je suis étonnée d’un détail dans les dessins : l’armée américaine est représentée principalement blanche alors que, dans mes lectures récentes, justement, il y a Harlem Quartet de James Baldwin. On pourrait me demander ce que cette référence fait dans cette note de lecture, mais si, justement, le narrateur, ainsi que certains de ses amis, part faire cette guerre de Corée et en parle d’une guerre faite en grande partie par les Noirs. Et pourtant, j’en ai vu peu dans les images. Y a-t-il ici un biais ? Je n’ai pas assez de connaissance pour trancher la question et j’espère que les deux auteurs ont fait assez de travail de recherche et se sont entourés de suffisamment de spécialistes pour valider leur travail sur le plan historique et factuel.
Des choses intéressantes dans cette bd, donc, et une nouvelle collection qui commence sous de bons auspices. Une lecture intéressant pour qui s’intéresse au journalisme et à ses conditions d’exercice ou qui s’intéresse aux moments clefs de notre histoire récente. Même si, comme le conclut cette bande dessinée, ce moment clef qu’a été la guerre de Corée, qui a duré 3 ans et a abouti à un bilan humain catastrophique, s’est conclu par « un retour au point de départ sur le 38e parallèle, qui divisait toujours la Corée en deux. Une guerre pour rien. » (p. 104)
Titre en anglais : non traduit



C’est ainsi que j’ai découvert un des aspects les plus cruels de la guerre : l’ami qui meurt brutalement. Sans prévenir.
(p. 34).
Merci aux éditions Dupuis de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
Il se trouve que j’ai lu quelques livres qui faisaient référence à la guerre de Corée ces derniers temps, le plus notable étant bien sûr celui de Han Kang, la nouvelle Prix Nobel de littérature, Impossibles adieux. Et je me faisais la réflexion que je connaissais bien peu cette page de l’histoire récente. Alors quand j’ai vu ce livre parmi les nouvelles publications des éditions Dupuis, je me suis dit que c’était une bonne façon pour commencer à remédier à mon ignorance. J’ai plus appris sur Henri de Turenne (que je ne connaissais pas du tout) que sur la guerre de Corée, mais vu l’angle de cette nouvelle collection « Prix Albert Londres » que viennent de lancer les éditions Dupuis, je suppose que c’est normal. Même si, peut-être, j’aurais préféré en apprendre plus sur le contenu des articles.
Ici, ce qui est principalement mis en avant, ce sont les difficiles conditions d’exercice du métier de journaliste de guerre. Le courage que cela demande, les risques qui peuvent aller jusqu’à la mort ou les camps de travail Nord-Coréens. On suit principalement Henri de Turenne dans son avancée au gré des actions militaires, dans les traces de l’armée américano-onusienne. La question de la responsabilité journalistique est aussi évoquée, bien que de façon assez légère, notamment à travers la tension entre droit d’informer et respect du secret militaire, ou bien lors d’un épisode assez marquant : Henri de Turenne est associé à un scoop par un collègue américain et assiste, caché, à des exécutions sommaires de sympathisants nord-coréens par l’armée sud-coréenne. Et il décide de ne pas écrire dessus, pensant que cela le rendrait complice. Que son rôle de spectateur passif lui pèse, à ce moment-là en particulier, je le comprends. Mais j’ai du mal à comprendre sa décision de ne pas rapporter cette information cruciale. N’est-ce pas se rendre complice aussi que de ne pas relayer cette information et donner alors une vision partiale de la situation ? Je ne trancherai pas, c’est trop facile à distance (géographique autant que temporelle), mais la question mérite d’être posée.
Au final, j’ai tout de même appris beaucoup sur cette guerre de Corée, même si je suis étonnée d’un détail dans les dessins : l’armée américaine est représentée principalement blanche alors que, dans mes lectures récentes, justement, il y a Harlem Quartet de James Baldwin. On pourrait me demander ce que cette référence fait dans cette note de lecture, mais si, justement, le narrateur, ainsi que certains de ses amis, part faire cette guerre de Corée et en parle d’une guerre faite en grande partie par les Noirs. Et pourtant, j’en ai vu peu dans les images. Y a-t-il ici un biais ? Je n’ai pas assez de connaissance pour trancher la question et j’espère que les deux auteurs ont fait assez de travail de recherche et se sont entourés de suffisamment de spécialistes pour valider leur travail sur le plan historique et factuel.
Des choses intéressantes dans cette bd, donc, et une nouvelle collection qui commence sous de bons auspices. Une lecture intéressant pour qui s’intéresse au journalisme et à ses conditions d’exercice ou qui s’intéresse aux moments clefs de notre histoire récente. Même si, comme le conclut cette bande dessinée, ce moment clef qu’a été la guerre de Corée, qui a duré 3 ans et a abouti à un bilan humain catastrophique, s’est conclu par « un retour au point de départ sur le 38e parallèle, qui divisait toujours la Corée en deux. Une guerre pour rien. » (p. 104)
111raton-liseur
99. 14g. (-) Lebensborn d’Isabelle Maroger
Titre en anglais : non traduit

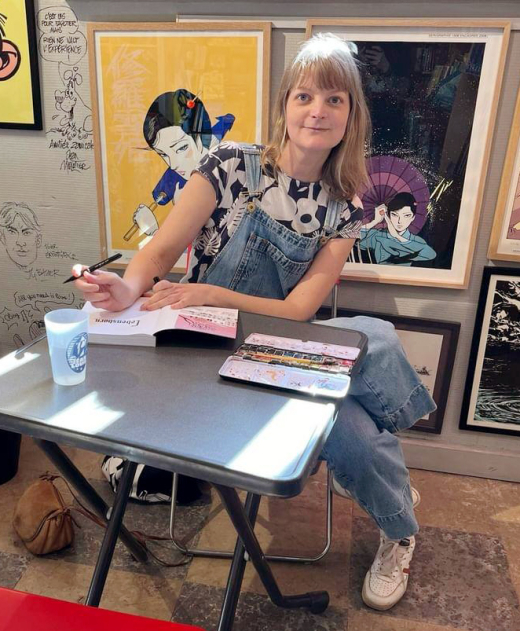
Une bd sur un sujet peu connu, celui des pouponnières nazies, comme si l’autre phase de l’eugénisme (le massacre des Juifs étant le côté destructif, ici on est dans le côté de la construction – pas au sens positif du terme, on s’entend bien…) était encore plus difficile à avaler que le premier. C’est sûr qu’assimiler les femmes aryennes à des poules pondeuses et les soldats allemands à des inséminateurs, ce n’est pas glorieux non plus.
Cette bd a donc le mérite de mettre en avant un sujet méconnu. Mais c’est avant tout une histoire familiale qui nous est racontée, celle d’une femme qui, alors déjà au mitan de sa vie, se met à chercher des informations sur les conditions de sa naissance et de son adoption, et découvre d’où elle vient biologiquement. Cette histoire vraie est celle de la mère de l’autrice, et, comme elle, on vit donc cette histoire un peu par procuration, en restant le plus souvent dans le factuel.
Je dois avouer que c’est justement la raison qui a fait que j’ai eu la sensation de rester en dehors de cette bd, qui ne choisit pas entre témoignage historique (et les informations sur les Lebensborn, les fontaines de vie, sont assez générales) et expérience personnelle et familiale. Outre la question des pouponnières nazies, c’est aussi la question de l’adoption qui est posée, de même que le sort des filles-mères, comme l’on disait à l’époque.
Le dessin a quelque chose d’assez naïf, qui va bien avec la position de jeune observatrice de la narratrice et auteur, mais il est peut-être un peu trop simple et moderne à mon goût. Une bd à lire donc si on n’a jamais entendu parler des pouponnières nazies, ou bien si on aime les histoires de vie sans vouloir être submergé par les émotions.
Titre en anglais : non traduit

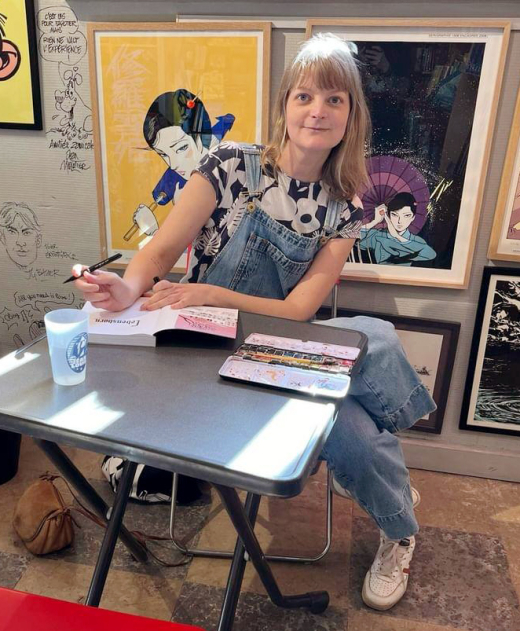
Une bd sur un sujet peu connu, celui des pouponnières nazies, comme si l’autre phase de l’eugénisme (le massacre des Juifs étant le côté destructif, ici on est dans le côté de la construction – pas au sens positif du terme, on s’entend bien…) était encore plus difficile à avaler que le premier. C’est sûr qu’assimiler les femmes aryennes à des poules pondeuses et les soldats allemands à des inséminateurs, ce n’est pas glorieux non plus.
Cette bd a donc le mérite de mettre en avant un sujet méconnu. Mais c’est avant tout une histoire familiale qui nous est racontée, celle d’une femme qui, alors déjà au mitan de sa vie, se met à chercher des informations sur les conditions de sa naissance et de son adoption, et découvre d’où elle vient biologiquement. Cette histoire vraie est celle de la mère de l’autrice, et, comme elle, on vit donc cette histoire un peu par procuration, en restant le plus souvent dans le factuel.
Je dois avouer que c’est justement la raison qui a fait que j’ai eu la sensation de rester en dehors de cette bd, qui ne choisit pas entre témoignage historique (et les informations sur les Lebensborn, les fontaines de vie, sont assez générales) et expérience personnelle et familiale. Outre la question des pouponnières nazies, c’est aussi la question de l’adoption qui est posée, de même que le sort des filles-mères, comme l’on disait à l’époque.
Le dessin a quelque chose d’assez naïf, qui va bien avec la position de jeune observatrice de la narratrice et auteur, mais il est peut-être un peu trop simple et moderne à mon goût. Une bd à lire donc si on n’a jamais entendu parler des pouponnières nazies, ou bien si on aime les histoires de vie sans vouloir être submergé par les émotions.
112raton-liseur
102. 17g. (-) Le Champ des possibles de Vero Cazot (scénario) et Anaïs Bernabé (dessin)
Titre en anglais : non traduit
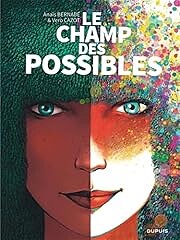


Une belle bd, qui attire par ses couleurs et son étrange couverture séparée en deux. Je l’ai commencée sans savoir du tout de quoi il était question, et je me suis retrouvée à naviguer entre monde virtuel et vie réelle (avec un traitement graphique plutôt intéressant et agréable pour permettre au lecteur de naviguer entre ces deux mondes sans jamais se perdre), et à être le témoin d’une sorte de triangle amoureux entre deux mondes. Etant plutôt conservatrice en ce qui concerne les relations amoureuses (je m’entends : chacun fait ce qu’il veut, dans la limite du consentement des uns et des autres, mais pour ma part, je m’en tiens à un type de relation tout ce qu’il y a de plus classique, et c’est ce qui me convient), j’ai eu beaucoup de mal à me projeter dans cette histoire, et notamment à entrer en empathie avec Harry.
Sinon, le livre est plutôt intéressant dans sa façon de proposer une articulation entre vie réelle (au sens physique du terme) et réalité virtuelle, et la possibilité que cette dernière pourrait offrir de vivre plusieurs vies à la fois (bien plus complètement que toute autre forme d’art, car n’est-ce pas ce que l’on dit de la littérature, souvent ? Et pourtant je n’ai pas l’impression de tromper M’sieur Raton ou même de vivre plusieurs histoires, plusieurs vies, en parallèle).
Une lecture qui dérange un peu donc, et qui me laisse assez perplexe, mais c’est plutôt une bonne chose j’imagine.
Titre en anglais : non traduit
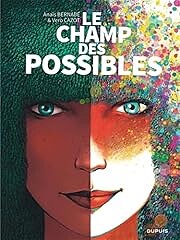


Une belle bd, qui attire par ses couleurs et son étrange couverture séparée en deux. Je l’ai commencée sans savoir du tout de quoi il était question, et je me suis retrouvée à naviguer entre monde virtuel et vie réelle (avec un traitement graphique plutôt intéressant et agréable pour permettre au lecteur de naviguer entre ces deux mondes sans jamais se perdre), et à être le témoin d’une sorte de triangle amoureux entre deux mondes. Etant plutôt conservatrice en ce qui concerne les relations amoureuses (je m’entends : chacun fait ce qu’il veut, dans la limite du consentement des uns et des autres, mais pour ma part, je m’en tiens à un type de relation tout ce qu’il y a de plus classique, et c’est ce qui me convient), j’ai eu beaucoup de mal à me projeter dans cette histoire, et notamment à entrer en empathie avec Harry.
Sinon, le livre est plutôt intéressant dans sa façon de proposer une articulation entre vie réelle (au sens physique du terme) et réalité virtuelle, et la possibilité que cette dernière pourrait offrir de vivre plusieurs vies à la fois (bien plus complètement que toute autre forme d’art, car n’est-ce pas ce que l’on dit de la littérature, souvent ? Et pourtant je n’ai pas l’impression de tromper M’sieur Raton ou même de vivre plusieurs histoires, plusieurs vies, en parallèle).
Une lecture qui dérange un peu donc, et qui me laisse assez perplexe, mais c’est plutôt une bonne chose j’imagine.
113raton-liseur
104. 18g. (-) Je suis leur silence de Jordi Lafebre, traduit de l’espagnol par Geneviève Maubille
Titre original : Soy su silencio
Titre en anglais : non traduit


Amusant ! Un cosy mystery que ne renierait sûrement pas Miss Marple, même si on est ici sous le soleil de Barcelone (bien présent dans le choix de la palette de couleurs) et si Eva, l’héroïne, est bien plus sexy, fumeuse et jeune que Jessica Fletcher ! Et puis elle est psychiatre aussi, ce qui lui donne très envie de dresser le portrait psychologique de l’assassin du magnat de l’alcool qu’est Francesc Monturós. Et puis il faut dire que la police en a fait une suspecte idéale et qu’en plus elle est en rendez-vous avec un collègue psychiatre qui doit évaluer si elle peut continuer à exercer ou pas, donc elle n’a pas intérêt à se louper !
Pas un personnage qui soit complètement équilibré et sain d’esprit dans cette bd, sauf peut-être l’enquêtrice qui ressemble à Angela Merkel. Mais c’est ce qui en fait toute la saveur : des dessins efficaces, des personnages un brin caricaturaux mais c’est assumé et ça tient la route sur la longueur de cette bd, une histoire qui paraît d’abord partir dans tous les sens mais dont on finit pas bien saisir les différents fils.
J’ai été étonnée de découvrir que je connaissais déjà cet auteur, dont j’ai lu Malgré tout il y a quelques temps maintenant. Ce n’est pas forcément de la grande littérature, mais les deux fois on peut dire qu’il a trouvé des scénarios originaux, et qu’il sait jouer avec son lecteur d’une façon agréable et inattendue.
Amusant, donc, et plus titillant qu’on ne pourrait le penser au premier abord. Une belle idée pour passer un bon moment de lecture en contrepoint de ces après-midi qui commencent à s’assombrir et à refroidir !
Titre original : Soy su silencio
Titre en anglais : non traduit


Amusant ! Un cosy mystery que ne renierait sûrement pas Miss Marple, même si on est ici sous le soleil de Barcelone (bien présent dans le choix de la palette de couleurs) et si Eva, l’héroïne, est bien plus sexy, fumeuse et jeune que Jessica Fletcher ! Et puis elle est psychiatre aussi, ce qui lui donne très envie de dresser le portrait psychologique de l’assassin du magnat de l’alcool qu’est Francesc Monturós. Et puis il faut dire que la police en a fait une suspecte idéale et qu’en plus elle est en rendez-vous avec un collègue psychiatre qui doit évaluer si elle peut continuer à exercer ou pas, donc elle n’a pas intérêt à se louper !
Pas un personnage qui soit complètement équilibré et sain d’esprit dans cette bd, sauf peut-être l’enquêtrice qui ressemble à Angela Merkel. Mais c’est ce qui en fait toute la saveur : des dessins efficaces, des personnages un brin caricaturaux mais c’est assumé et ça tient la route sur la longueur de cette bd, une histoire qui paraît d’abord partir dans tous les sens mais dont on finit pas bien saisir les différents fils.
J’ai été étonnée de découvrir que je connaissais déjà cet auteur, dont j’ai lu Malgré tout il y a quelques temps maintenant. Ce n’est pas forcément de la grande littérature, mais les deux fois on peut dire qu’il a trouvé des scénarios originaux, et qu’il sait jouer avec son lecteur d’une façon agréable et inattendue.
Amusant, donc, et plus titillant qu’on ne pourrait le penser au premier abord. Une belle idée pour passer un bon moment de lecture en contrepoint de ces après-midi qui commencent à s’assombrir et à refroidir !
114labfs39
Fantastic reading, as always!
>105 raton-liseur: First, regarding Sepúlveda, I think I will look for Patagonia Express. I just read his Wikipedia page and think reading a biography of him would be very interesting. Quite the life.
>106 raton-liseur: So many of the books you mention that I would like to read are not yet translated into English. Nevertheless I am tempted to try Mémoires de gris, because of the beautiful cover, and Henri de Turenne : Sur le front de Corée, given my interest in Joe Sacco's work. I would need to purchase the books from France, however, and Mémoires de gris is 79USD and Sur le front de Corée is 56USD plus shipping. Yikes!
>105 raton-liseur: First, regarding Sepúlveda, I think I will look for Patagonia Express. I just read his Wikipedia page and think reading a biography of him would be very interesting. Quite the life.
>106 raton-liseur: So many of the books you mention that I would like to read are not yet translated into English. Nevertheless I am tempted to try Mémoires de gris, because of the beautiful cover, and Henri de Turenne : Sur le front de Corée, given my interest in Joe Sacco's work. I would need to purchase the books from France, however, and Mémoires de gris is 79USD and Sur le front de Corée is 56USD plus shipping. Yikes!
115raton-liseur
Le Neveu d'Amérique / Patagonia Express can be a good entry point, but I wonder to which extent it is true. There are too many quirky things to be all true. Sepulveda had a fantastic life, but I suspect he did add a few stories of his own here and there. (Which is not a bad thing as far as reading is concerned!).
I know lack of translation can be frustrating, and as I read quite a few press service books at the moment, a lot won't be translated in a near future... Mémoires de gris is good, maybe not your usual reading material, but why not. Regarding the Henri de Turenne book, I wonder why the connection with Joe Sacco came to your mind?
I know lack of translation can be frustrating, and as I read quite a few press service books at the moment, a lot won't be translated in a near future... Mémoires de gris is good, maybe not your usual reading material, but why not. Regarding the Henri de Turenne book, I wonder why the connection with Joe Sacco came to your mind?
116labfs39
>115 raton-liseur: I see that some people tagged Patagonia Express as nonfiction, but more tagged it as fiction. Interesting.
As for the Turenne book, the following made me think of Sacco:
Ici, ce qui est principalement mis en avant, ce sont les difficiles conditions d’exercice du métier de journaliste de guerre. Le courage que cela demande, les risques qui peuvent aller jusqu’à la mort ou les camps de travail Nord-Coréens. On suit principalement Henri de Turenne dans son avancée au gré des actions militaires, dans les traces de l’armée américano-onusienne. La question de la responsabilité journalistique est aussi évoquée
I'm unfamiliar with the term "press service books", do you mean what we call advance reader copies, books the publisher sends out before publication to try and create buzz?
As for the Turenne book, the following made me think of Sacco:
Ici, ce qui est principalement mis en avant, ce sont les difficiles conditions d’exercice du métier de journaliste de guerre. Le courage que cela demande, les risques qui peuvent aller jusqu’à la mort ou les camps de travail Nord-Coréens. On suit principalement Henri de Turenne dans son avancée au gré des actions militaires, dans les traces de l’armée américano-onusienne. La question de la responsabilité journalistique est aussi évoquée
I'm unfamiliar with the term "press service books", do you mean what we call advance reader copies, books the publisher sends out before publication to try and create buzz?
117raton-liseur
>116 labfs39: You're right, this is what I have written. The connection between Turenne and Sacco is interesting and made me think about it. However, the book does not go into a lot of details about this aspect. If you decide to read it, I hope you won't be disappointed.
Fun fact on Patagonia Express / Le Neveu d'Amérique, good that I don't classify books that way ;)
Sorry, I thought "press service" was an English term! We say "service presse" in French, and it sounds like a bad translation, so I just assumed it was translated from English... You're right, service presse" is more or less the equivalent of ARC.
Fun fact on Patagonia Express / Le Neveu d'Amérique, good that I don't classify books that way ;)
Sorry, I thought "press service" was an English term! We say "service presse" in French, and it sounds like a bad translation, so I just assumed it was translated from English... You're right, service presse" is more or less the equivalent of ARC.
118raton-liseur
86. 60. (45) La Dette publique : Précis d'économie citoyenne d'Eric Berr, Léo Charles, Arthur Jatteau, Jonathan Marie et Alban Pellegris pour le collectif des Economistes atterrés
Titre en anglais : non traduit


Oui, bah moi je suis une citoyenne atterrée. J’ai acheté ce livre avant tout le psychodrame de l’été dernier (et de l’automne actuel), alors qu’on parlait déjà de la dette et de l’impérieuse nécessité de la rembourser. Voulant entendre autre chose que le discours ultra dominant, qui va du « bon sens » brandi par nos ministres et aux « il va de soi » de Dominique Seux, l’indéboulonnable journaliste économique des matins de France Inter, je me suis tournée vers les Economistes atterrés, certaine de trouver un autre son de cloche et de pouvoir ainsi nourrir une réflexion un peu plus nuancée.
Eh bien je n’ai pas été déçue ! Il y avait bien sûr des choses dont je me doutais, mais la façon de ce groupe d’économistes envisagent la dette, la place de l’Etat dans la définition et la conduite d’une politique économique et d’une politique monétaire est passionnant. C’est certain, ce n’est pas du discours pré-mâché : plus d’une fois, il a fallu que je m’accroche et parfois même je pense être passée à côté de certains raisonnement ; pourtant j’ai un peu de culture économique. Mais il me semble bon de rendre sa complexité à une question qui l’est, et d’arrêter de prendre les citoyens que nous sommes pour des oies à gaver de bouillie toute faite. Rien que pour cela, déjà, cette lecture a été salutaire.
Ensuite, elle permet de remettre les choses dans leur contexte, de démonter les idées toutes faites et de redonner un peu de profondeur au débat. Déjà, commencer par remettre l’État dans son rôle d’État, c’est-à-dire à la fois une entité vouée à perdurer (et donc dont la nécessité de s’acquitter de sa dette n’est pas identique à celle d’un individu ou d’une société) et une entité dont le poids économique n’est pas neutre (et donc dont les choix ont une incidence quantifiable, et dans une certaine mesure prévisible, sur les équilibres économiques).
Il est dommage que les livres d’actualité vieillissent aussi vite (quel joli truisme…), car même si la deuxième édition ne date que de février 2024, j’aimerais entendre les arguments de ces économistes face aux dernières sorties médiatiques et politiques qui donnent l’impression que la situation est en train de s’emballer alors que les auteurs sont beaucoup plus mesurés, mais plus sur le mode « non, la situation n’est pas encore catastrophique ». Alors, six mois plus tard, le discours serait-il toujours le même ? Probablement en partie, parce qu’avant tout, ce livre appelle à considérer la dette publique pour ce qu’elle est, c’est-à-dire un outil, donc ni bonne ni mauvaise en soi, cela dépend juste de comment elle est utilisée. Il n’y a donc pas de honte à creuser la dette, lorsque c’est pour de la relance économique ou pour de l’investissement (tiens, de l’investissement dans la transition écologique par exemple…). Mais pour faire de la dette publique un outil au service de l’économie, et encore plus important au service de la société, cela demande peut-être (et le peut-être est en trop) le courage politique de remettre des régulations et des lois là où c’est nécessaire.
Je ne sais pas trop à quoi ressemble cette note de lecture. Ni un résumé ni une critique. Juste quelques idées éparses qui témoignent de mon désir, de mon besoin même, de retrouver un sens au débat que l’on dit encore démocratique. De retrouver un sens à la politique et à ses outils, qu’ils soient à réinventer ou non. On ne peut pas, quand on est un responsable politique déclarer comme allant de soit : « Il n’y a pas d’alternative. » Il y en a toujours une, et c’est la beauté de la politique de proposer une hiérarchie des valeurs et des combats (d’où la nécessité du débat politique et du choix). Il semble que pour l’instant, notre choix collectif est d’aller droit dans le mur, mais ça c’est un autre débat.
En attendant, si c’est certain que ce livre n’est ni pour les paresseux ni pour les néoclassiques, c’est une lecture prenante et pleine d’intérêt qui donne à penser, sur un sujet sur lequel je m’arrête rarement aussi longtemps, et cela fait du bien !
Titre en anglais : non traduit


Oui, bah moi je suis une citoyenne atterrée. J’ai acheté ce livre avant tout le psychodrame de l’été dernier (et de l’automne actuel), alors qu’on parlait déjà de la dette et de l’impérieuse nécessité de la rembourser. Voulant entendre autre chose que le discours ultra dominant, qui va du « bon sens » brandi par nos ministres et aux « il va de soi » de Dominique Seux, l’indéboulonnable journaliste économique des matins de France Inter, je me suis tournée vers les Economistes atterrés, certaine de trouver un autre son de cloche et de pouvoir ainsi nourrir une réflexion un peu plus nuancée.
Eh bien je n’ai pas été déçue ! Il y avait bien sûr des choses dont je me doutais, mais la façon de ce groupe d’économistes envisagent la dette, la place de l’Etat dans la définition et la conduite d’une politique économique et d’une politique monétaire est passionnant. C’est certain, ce n’est pas du discours pré-mâché : plus d’une fois, il a fallu que je m’accroche et parfois même je pense être passée à côté de certains raisonnement ; pourtant j’ai un peu de culture économique. Mais il me semble bon de rendre sa complexité à une question qui l’est, et d’arrêter de prendre les citoyens que nous sommes pour des oies à gaver de bouillie toute faite. Rien que pour cela, déjà, cette lecture a été salutaire.
Ensuite, elle permet de remettre les choses dans leur contexte, de démonter les idées toutes faites et de redonner un peu de profondeur au débat. Déjà, commencer par remettre l’État dans son rôle d’État, c’est-à-dire à la fois une entité vouée à perdurer (et donc dont la nécessité de s’acquitter de sa dette n’est pas identique à celle d’un individu ou d’une société) et une entité dont le poids économique n’est pas neutre (et donc dont les choix ont une incidence quantifiable, et dans une certaine mesure prévisible, sur les équilibres économiques).
Il est dommage que les livres d’actualité vieillissent aussi vite (quel joli truisme…), car même si la deuxième édition ne date que de février 2024, j’aimerais entendre les arguments de ces économistes face aux dernières sorties médiatiques et politiques qui donnent l’impression que la situation est en train de s’emballer alors que les auteurs sont beaucoup plus mesurés, mais plus sur le mode « non, la situation n’est pas encore catastrophique ». Alors, six mois plus tard, le discours serait-il toujours le même ? Probablement en partie, parce qu’avant tout, ce livre appelle à considérer la dette publique pour ce qu’elle est, c’est-à-dire un outil, donc ni bonne ni mauvaise en soi, cela dépend juste de comment elle est utilisée. Il n’y a donc pas de honte à creuser la dette, lorsque c’est pour de la relance économique ou pour de l’investissement (tiens, de l’investissement dans la transition écologique par exemple…). Mais pour faire de la dette publique un outil au service de l’économie, et encore plus important au service de la société, cela demande peut-être (et le peut-être est en trop) le courage politique de remettre des régulations et des lois là où c’est nécessaire.
Je ne sais pas trop à quoi ressemble cette note de lecture. Ni un résumé ni une critique. Juste quelques idées éparses qui témoignent de mon désir, de mon besoin même, de retrouver un sens au débat que l’on dit encore démocratique. De retrouver un sens à la politique et à ses outils, qu’ils soient à réinventer ou non. On ne peut pas, quand on est un responsable politique déclarer comme allant de soit : « Il n’y a pas d’alternative. » Il y en a toujours une, et c’est la beauté de la politique de proposer une hiérarchie des valeurs et des combats (d’où la nécessité du débat politique et du choix). Il semble que pour l’instant, notre choix collectif est d’aller droit dans le mur, mais ça c’est un autre débat.
En attendant, si c’est certain que ce livre n’est ni pour les paresseux ni pour les néoclassiques, c’est une lecture prenante et pleine d’intérêt qui donne à penser, sur un sujet sur lequel je m’arrête rarement aussi longtemps, et cela fait du bien !
119labfs39
>118 raton-liseur: I know very limit about economics, micro or macro, but the hysteria (in the US at least) about the debt seems disproportionate. I think part of it may stem from a lack of understanding about a global economy. I also think there is no general understanding of what the impact of getting to a zero debt economy would be. Good on you for trying to suss out the nuances.
120Dilara86
>107 raton-liseur: One for the wishlist!
>118 raton-liseur: I toyed with getting this book when it was published. I wished my library had it...
Really enjoying your posts, as always.
>118 raton-liseur: I toyed with getting this book when it was published. I wished my library had it...
Really enjoying your posts, as always.
121raton-liseur
>119 labfs39: Interesting to know you have the same crazy debates on debts as we do. We are made to believe France is the worst pupil in the classroom, but it seems not! (And it's not comforting to realise the same crayness is everywhere.)
>119 labfs39: and >120 Dilara86: I have now been suggested to read Dette : 5000 ans d'histoire / Debt: The First 5,000 Years by David Graeber. Not sure I'll find the energy for it, but I've wishlisted it to continue exploring the theme. The Economistes atterrés book is really worth a read.
>120 Dilara86: Glad I've picked your interest with Mai!
>119 labfs39: and >120 Dilara86: I have now been suggested to read Dette : 5000 ans d'histoire / Debt: The First 5,000 Years by David Graeber. Not sure I'll find the energy for it, but I've wishlisted it to continue exploring the theme. The Economistes atterrés book is really worth a read.
>120 Dilara86: Glad I've picked your interest with Mai!
122FlorenceArt
Debt: The First 5000 Years has been on my wishlist for a while, and now I have added La dette publique.
123Dilara86
>121 raton-liseur: >122 FlorenceArt: Another title on my wishlist!
124raton-liseur
>122 FlorenceArt: and >123 Dilara86: Eh, we are about to reach a quorum for a group read!
I've checked, the book is available in backpack format, by Babel/Actes Sud for 12.20 euros, or as an e-book by Des Liens qui libèrent at the cost of 10,99 euros. I might decide to buy it after all.
I've checked, the book is available in backpack format, by Babel/Actes Sud for 12.20 euros, or as an e-book by Des Liens qui libèrent at the cost of 10,99 euros. I might decide to buy it after all.
125LolaWalser
>111 raton-liseur:
A few years ago I listened on France Culture to a series about the Lebensborn project, specifically as it was realised in France, with French women as "the incubators". Some of the resulting children were still alive but not only were none "supermen", as a group they were notably disadvantaged, with developmental and mental problems. (No wonder, considering the rigours they were exposed to from birth in order to "steel" them.)
A few years ago I listened on France Culture to a series about the Lebensborn project, specifically as it was realised in France, with French women as "the incubators". Some of the resulting children were still alive but not only were none "supermen", as a group they were notably disadvantaged, with developmental and mental problems. (No wonder, considering the rigours they were exposed to from birth in order to "steel" them.)
126rachbxl
>125 LolaWalser: I wanted something to listen to while I did my ironing today so I looked this series up and I've listened to the first episode so far. It's a subject I was only vaguely aware of, and I certainly didn't know any of it took place in France. It's like listening to a particularly chilling dystopian audiobook...but it's not.
127LolaWalser
>126 rachbxl:
No, it's not. And when you think that already, in the US in the past two years alone, tens of thousands of unwanted children of rape have been born to women deprived of recourse to abortion; that billionaire Musk is selling the same eugenicist ideology the Nazis believed in; that he's in cahoots with anti-woman politicians rising around the globe... we're already in something very similar.
(Btw, the programme I listened to was from 2019: https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/une-histoire-particuliere-un-r...
I see there is something new posted, in connection to the BD in >111 raton-liseur:)
No, it's not. And when you think that already, in the US in the past two years alone, tens of thousands of unwanted children of rape have been born to women deprived of recourse to abortion; that billionaire Musk is selling the same eugenicist ideology the Nazis believed in; that he's in cahoots with anti-woman politicians rising around the globe... we're already in something very similar.
(Btw, the programme I listened to was from 2019: https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/une-histoire-particuliere-un-r...
I see there is something new posted, in connection to the BD in >111 raton-liseur:)
128Dilara86
>124 raton-liseur: I'd be interested in a group read, if there's enough traction for it!
>125 LolaWalser: >126 rachbxl: I also didn't know it happened of French soil. I'll listen to the programme.
>125 LolaWalser: >126 rachbxl: I also didn't know it happened of French soil. I'll listen to the programme.
129rachbxl
>127 LolaWalser: Yes, that's the programme I'm listening to. I still haven't finished, but as I listened yesterday it did strike me that it's so shocking that whilst it should be firmly in the past, there are echoes of it in the world today.
130raton-liseur
>125 LolaWalser:, >127 LolaWalser: Oh, thanks a lot for the link, I'll listen to it. The book talks about Norway, but I did not know it also existed in France!
>126 rachbxl: I like the way Isabelle Maroger presents the Lebensborn in her book, as the other face of the nazi ideolgy. We always think about the destruction of what did not fit in their ideal world (Jews, people with mental illnesses, homosexuals...), but the other side of the coin is building a population with all the desired features.
>128 Dilara86: Not sure we will have enought interest for a group read on Dette : 5000 ans d'histoire / Debt: The 5000 first years, but we could try. Do you think I should post something on the message board?
>126 rachbxl: I like the way Isabelle Maroger presents the Lebensborn in her book, as the other face of the nazi ideolgy. We always think about the destruction of what did not fit in their ideal world (Jews, people with mental illnesses, homosexuals...), but the other side of the coin is building a population with all the desired features.
>128 Dilara86: Not sure we will have enought interest for a group read on Dette : 5000 ans d'histoire / Debt: The 5000 first years, but we could try. Do you think I should post something on the message board?
131raton-liseur
107. 71. (-) Le Tableau du maître flamand d'Arturo Pérez-Reverte, traduit de l'espagnol par Yves Gonzalez-Quijano
Titre original : La tabla de Flandes
Titre en anglais : The Flanders Panel


Merci à la collection folio de m’avoir permis de découvrir ce livre, via la masse critique de Babelio.
Ce n’est pas une nouveauté que j’ai reçue dans le cadre de la dernière masse critique de Babelio, puisque ce livre a été publié en 1990 en Espagne et en 1993 en France, mais il fait aujourd’hui l’objet d’une réédition et c’est ce qui m’a valu le privilège de le recevoir et d’enfin le lire.
Commençons d’abord par un point de marketing. Ce roman est à mon avis classé à tort dans la catégorie thriller. En effet, pour moi, thriller est synonyme de suspens, d’actions qui s’enchaînent sans temps mort. On est loin de cela ici : c’est plutôt un roman cérébral, d’atmosphère et de réflexion. A plusieurs reprises il est fait allusion à Shelock Holmes, et c’est effectivement une filiation plus évidente. On n’est pas loin du roman policier victorien ou du cosy mystery, et cela correspond probablement bien plus à mes goûts littéraires qu’un vrai thriller.
Ceci dit, je dois avouer que ce titre n’est pas mon préféré d’Arturo Pérez-Reverte. C’est un auteur que j’aime énormément, donc je place la barre assez haut lorsqu’il s’agit de lui. Ici, j’ai un peu eu l’impression de lire un premier essai avant le magistral Club Dumas qui sera son prochain titre publié. C’est bien fait, on évolue avec plaisir dans cette mise en abyme d’intrigues, où l’on se demande, tout comme Borges qui est cité à plusieurs reprises, quel dieu est derrière le dieu qui meut le joueur d’échecs qui déplace la pièce. Il y a probablement l’auteur entre ces deux dieux, mais alors qui tient la plume qui écrit celui qui tient la plume ?
Ce titre est une des premières œuvres publiées par Arturo Pérez-Reverte, et c’est probablement le travail d’un auteur qui aguerrit peu à peu sa plume pour donner les splendides titres qui viendront ensuite. C’est déjà une belle réussite, un livre divertissant et agréable, joueur et érudit, un joli petit casse-tête pour les lecteurs qui aiment une certaine approche logique dans leurs lectures.
Titre original : La tabla de Flandes
Titre en anglais : The Flanders Panel


Merci à la collection folio de m’avoir permis de découvrir ce livre, via la masse critique de Babelio.
Ce n’est pas une nouveauté que j’ai reçue dans le cadre de la dernière masse critique de Babelio, puisque ce livre a été publié en 1990 en Espagne et en 1993 en France, mais il fait aujourd’hui l’objet d’une réédition et c’est ce qui m’a valu le privilège de le recevoir et d’enfin le lire.
Commençons d’abord par un point de marketing. Ce roman est à mon avis classé à tort dans la catégorie thriller. En effet, pour moi, thriller est synonyme de suspens, d’actions qui s’enchaînent sans temps mort. On est loin de cela ici : c’est plutôt un roman cérébral, d’atmosphère et de réflexion. A plusieurs reprises il est fait allusion à Shelock Holmes, et c’est effectivement une filiation plus évidente. On n’est pas loin du roman policier victorien ou du cosy mystery, et cela correspond probablement bien plus à mes goûts littéraires qu’un vrai thriller.
Ceci dit, je dois avouer que ce titre n’est pas mon préféré d’Arturo Pérez-Reverte. C’est un auteur que j’aime énormément, donc je place la barre assez haut lorsqu’il s’agit de lui. Ici, j’ai un peu eu l’impression de lire un premier essai avant le magistral Club Dumas qui sera son prochain titre publié. C’est bien fait, on évolue avec plaisir dans cette mise en abyme d’intrigues, où l’on se demande, tout comme Borges qui est cité à plusieurs reprises, quel dieu est derrière le dieu qui meut le joueur d’échecs qui déplace la pièce. Il y a probablement l’auteur entre ces deux dieux, mais alors qui tient la plume qui écrit celui qui tient la plume ?
Ce titre est une des premières œuvres publiées par Arturo Pérez-Reverte, et c’est probablement le travail d’un auteur qui aguerrit peu à peu sa plume pour donner les splendides titres qui viendront ensuite. C’est déjà une belle réussite, un livre divertissant et agréable, joueur et érudit, un joli petit casse-tête pour les lecteurs qui aiment une certaine approche logique dans leurs lectures.
132raton-liseur
110. 19g. (-) Pisse-Mémé de Cati Baur
Titre en anglais : non traduit


Le feel good (que je n’aime pas cette expression !) n’a bien sûr pas envahi que les livres de mots, la bd a aussi son comptant de titres qui répondent à ce cahier des charges. Celui-ci en fait partie et, comme souvent avec ce type de bouquin (que je lis rarement et en général plutôt suite à une erreur d’aiguillage), je me suis plutôt ennuyée. La bande de copines, qui ont toutes leurs difficultés mais dont l’amitié est plus forte que tout, se lancent dans un beau projet et bien sûr, même s’il y a quelques menues difficultés le long du chemin, tout va bien marcher et les problèmes vont presque s’évanouir au fil des pages… Avec cela, un dessin plutôt à la mode en ce moment mais qui moi ne m’intéresse pas…
J’ai lu cette bd parce qu’elle fait partie de la sélection pour le prix bd de ma bibliothèque, et je veux être une juré consciencieuse. Mais il est clair après ces quelques lignes que ce titre n’aura pas mon suffrage. J’imagine qu’elle peut plaire à ceux qui ont envie d’une tranche de guimauve et d’un livre facile (ce qui m’arrive aussi, je ne le nie pas), mais celui-là ne renouvelle pas le genre.
Titre en anglais : non traduit


Le feel good (que je n’aime pas cette expression !) n’a bien sûr pas envahi que les livres de mots, la bd a aussi son comptant de titres qui répondent à ce cahier des charges. Celui-ci en fait partie et, comme souvent avec ce type de bouquin (que je lis rarement et en général plutôt suite à une erreur d’aiguillage), je me suis plutôt ennuyée. La bande de copines, qui ont toutes leurs difficultés mais dont l’amitié est plus forte que tout, se lancent dans un beau projet et bien sûr, même s’il y a quelques menues difficultés le long du chemin, tout va bien marcher et les problèmes vont presque s’évanouir au fil des pages… Avec cela, un dessin plutôt à la mode en ce moment mais qui moi ne m’intéresse pas…
J’ai lu cette bd parce qu’elle fait partie de la sélection pour le prix bd de ma bibliothèque, et je veux être une juré consciencieuse. Mais il est clair après ces quelques lignes que ce titre n’aura pas mon suffrage. J’imagine qu’elle peut plaire à ceux qui ont envie d’une tranche de guimauve et d’un livre facile (ce qui m’arrive aussi, je ne le nie pas), mais celui-là ne renouvelle pas le genre.
133raton-liseur
103. 68. (-) Ma Grand-mère était un homme de Mahamat-Saleh Haroun
Titre en anglais : non traduit

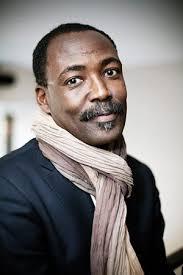
Merci aux éditions Stock de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
Je suis un peu embêtée parce que j’aurais vraiment aimé aimer ce livre. Ce n’est pas que je l’ai détesté, mais il m’a laissée assez indifférente, je n’ai pas réussi à entrer dedans. D’abord parce que je crois que j’ai de moins en moins de patience pour les livres qui se présentent d’une certaine façon et qui finalement son autre chose. Ici, Je m’attendais à découvrir un personnage complexe, peut-être important mais oublié de l’histoire récente du Tchad. Il n’en est rien. Kaltouma n’est d’abord qu’une des trois voix que l’on écoute dans ce livre, ensuite, ce qu’on apprend d’elle ne va pas beaucoup plus loin que ce qu’un enfant sait de sa grand-mère, certes à la vie hors du commun, grâce à ses souvenirs et à la mémoire que l’on conserve d’elle dans la famille.
Ensuite, ce livre balaie en fait en quelques centaines de pages presqu’un siècle d’histoire du Tchad. On reste donc assez superficiel dans tout cela, et j’ai trouvé que c’était soit trop peu soit pas assez, en tout cas pas la bonne dose pour que j’y prenne goût. Et puis on ne sait pas vraiment « d’où » parle le narrateur. Peut-être est-ce ma faute parce que je ne le connais pas, alors que c’est un cinéaste qui a un certaine succès d’estime (mais je ne m’en cache pas, ma culture cinématographique est assez proche du néant), mais j’ai du mal à remettre dans son contexte les critiques politiques (certes à fleuret moucheté, et assez rares), ne sachant pas bien dans quelle mesure lui ou sa famille a été plus ou moins proche de ce système (j’apprends ainsi au détour d’une phrase que l’auteur a été ministre de la culture au Tchad, il semble donc être à la fois un peu dans le système et hors du système).
Dommage donc pour ce livre qui, je ne le nie pas, nous transporte au Tchad et nous montre certains aspects bien peu connus de ce pays bien peu connu. Il y avait matière à, mais il m’a semblé que le livre n’était pas aussi abouti qu’il aurait pu l’être ou du moins que j’aurais aimé qu’il soit.
Titre en anglais : non traduit

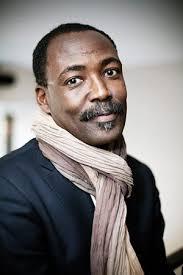
Merci aux éditions Stock de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
Je suis un peu embêtée parce que j’aurais vraiment aimé aimer ce livre. Ce n’est pas que je l’ai détesté, mais il m’a laissée assez indifférente, je n’ai pas réussi à entrer dedans. D’abord parce que je crois que j’ai de moins en moins de patience pour les livres qui se présentent d’une certaine façon et qui finalement son autre chose. Ici, Je m’attendais à découvrir un personnage complexe, peut-être important mais oublié de l’histoire récente du Tchad. Il n’en est rien. Kaltouma n’est d’abord qu’une des trois voix que l’on écoute dans ce livre, ensuite, ce qu’on apprend d’elle ne va pas beaucoup plus loin que ce qu’un enfant sait de sa grand-mère, certes à la vie hors du commun, grâce à ses souvenirs et à la mémoire que l’on conserve d’elle dans la famille.
Ensuite, ce livre balaie en fait en quelques centaines de pages presqu’un siècle d’histoire du Tchad. On reste donc assez superficiel dans tout cela, et j’ai trouvé que c’était soit trop peu soit pas assez, en tout cas pas la bonne dose pour que j’y prenne goût. Et puis on ne sait pas vraiment « d’où » parle le narrateur. Peut-être est-ce ma faute parce que je ne le connais pas, alors que c’est un cinéaste qui a un certaine succès d’estime (mais je ne m’en cache pas, ma culture cinématographique est assez proche du néant), mais j’ai du mal à remettre dans son contexte les critiques politiques (certes à fleuret moucheté, et assez rares), ne sachant pas bien dans quelle mesure lui ou sa famille a été plus ou moins proche de ce système (j’apprends ainsi au détour d’une phrase que l’auteur a été ministre de la culture au Tchad, il semble donc être à la fois un peu dans le système et hors du système).
Dommage donc pour ce livre qui, je ne le nie pas, nous transporte au Tchad et nous montre certains aspects bien peu connus de ce pays bien peu connu. Il y avait matière à, mais il m’a semblé que le livre n’était pas aussi abouti qu’il aurait pu l’être ou du moins que j’aurais aimé qu’il soit.
134labfs39
>133 raton-liseur: Too bad this didn't hit the mark, I haven't read anything from Chad yet.
135raton-liseur
>134 labfs39: Well, I think it was my first book from Chad. I guess I'll have to find a better one!
136raton-liseur
111. 73. (53) Les jours viennent et passent d'Hemley Boum
Titre en anglais : Days come and go


Voici, une fois encore, un livre que j’aurais aimé plus aimer. C’est à la suite de l’interview de l’autrice pour un livre plus récent (Le Rêve du pêcheur) que j’ai acheté ce livre, déjà paru en poche, désireuse de découvrir cette romancière camerounaise contemporaine. L’idée est classique, mais efficace, retracer l’évolution du Cameroun au cours du dernier demi-siècle.
Avec les voix de Bouissi-Anna et d’Abi, une mère mourante et sa fille qui la veille, toutes deux ressassant leurs souvenirs plus ou moins douloureux, c’est un portrait incarné et personnel que l’autrice nous permet de contempler. Les blessures de la colonisation et de la décolonisation vécues dans la quotidienneté des vies ; les mirages de l’exil et les douleurs du racisme dans une vie de tous les jours ni rose ni grise. Tout cela rend le début du livre plutôt intéressant, avec un entremêlement de sentiments difficile à décrire mais qui, par sa complexité même, apparaît comme réaliste.
Là où les choses se compliquent, c’est avec l’arrivé de la troisième voix, celle de Tina, une jeune adolescente rescapée des camps de Boko Haram. Là, on passe dans un discours beaucoup plus linéaire, et qui finalement est assez irréaliste au vu des personnages, de leur histoire et de leur personnalité. Le discours devient lourd, à sens unique, et la mise à distance de l’événement qui permet de faire littérature n’est pas encore là pour faire de ce livre un texte qui permet au lecteur de commencer à mettre des mots ou à comprendre.
Un livre qui donc commençait plutôt bien, qui promettait d’être intéressant, mais qui finit sur une déception. Le livre, aussi, je pense, d’une autrice en devenir. Ce titre n’est certes pas son premier livre, mais on y trouve beaucoup de choses que l’on sent en germination, beaucoup de potentiel. Je crois donc je lirai avec intérêt les œuvres à venir de cette autrice, qui a beaucoup à dire, qui porte un regard acéré et riche sur le monde qui l’entoure et qui cherche, pour dire cela, des personnages complexes et crédibles, qui donnent envie à la lectrice que je suis de les suivre dans leurs vies et dans leurs états d’âme.
Titre en anglais : Days come and go


Voici, une fois encore, un livre que j’aurais aimé plus aimer. C’est à la suite de l’interview de l’autrice pour un livre plus récent (Le Rêve du pêcheur) que j’ai acheté ce livre, déjà paru en poche, désireuse de découvrir cette romancière camerounaise contemporaine. L’idée est classique, mais efficace, retracer l’évolution du Cameroun au cours du dernier demi-siècle.
Avec les voix de Bouissi-Anna et d’Abi, une mère mourante et sa fille qui la veille, toutes deux ressassant leurs souvenirs plus ou moins douloureux, c’est un portrait incarné et personnel que l’autrice nous permet de contempler. Les blessures de la colonisation et de la décolonisation vécues dans la quotidienneté des vies ; les mirages de l’exil et les douleurs du racisme dans une vie de tous les jours ni rose ni grise. Tout cela rend le début du livre plutôt intéressant, avec un entremêlement de sentiments difficile à décrire mais qui, par sa complexité même, apparaît comme réaliste.
Là où les choses se compliquent, c’est avec l’arrivé de la troisième voix, celle de Tina, une jeune adolescente rescapée des camps de Boko Haram. Là, on passe dans un discours beaucoup plus linéaire, et qui finalement est assez irréaliste au vu des personnages, de leur histoire et de leur personnalité. Le discours devient lourd, à sens unique, et la mise à distance de l’événement qui permet de faire littérature n’est pas encore là pour faire de ce livre un texte qui permet au lecteur de commencer à mettre des mots ou à comprendre.
Un livre qui donc commençait plutôt bien, qui promettait d’être intéressant, mais qui finit sur une déception. Le livre, aussi, je pense, d’une autrice en devenir. Ce titre n’est certes pas son premier livre, mais on y trouve beaucoup de choses que l’on sent en germination, beaucoup de potentiel. Je crois donc je lirai avec intérêt les œuvres à venir de cette autrice, qui a beaucoup à dire, qui porte un regard acéré et riche sur le monde qui l’entoure et qui cherche, pour dire cela, des personnages complexes et crédibles, qui donnent envie à la lectrice que je suis de les suivre dans leurs vies et dans leurs états d’âme.
137raton-liseur
Un Ennemi du peuple d'Henrik Ibsen, traduit du norvégien par Aloi Recoing ; lu par Charles Morillon
Titre original : En Folkefiende
Titre en anglais : An Enemy of the People
Je n’avais jamais entendu parler de cette pièce d’Henrik Ibsen (il faut dire que je n’ai jamais rien lu ni vu de lui, ceci explique probablement cela…), mais Wikipédia la range parmi ses œuvres majeures. Cette lecture audio comble donc un trou majeur de ma culture générale, même si c’était un trou dont je ne soupçonnais pas l’existence !
Si l’on ne craint pas les anachronismes, on peut résumer cette pièce en disant qu’elle décrit le sort réservé à un lanceur d’alerte, puisque c’est bien ce qu’est le docteur Stockmann, qui s’aperçoit que les eaux de la station thermale de sa ville sont polluées. Il se voit alors comme le bienfaiteur de sa communauté, lui qui a évité un désastre. Mais très vite, les autorités administratives (en la personne de son propre frère), au lieu de voir la catastrophe sanitaire évitée, voient les complications économiques (fermer la station thermale), techniques (refaire toutes les canalisations de la ville) et financières (tout cela va coûter bien cher au contribuable…). S’engage alors un jeu malsain d’intimidation et de décrédibilisation qui ne donne pas une belle image des instances dirigeantes…
Cette pièce a certes été publiée en 1882, mais ce qui est décrit paraît vraiment actuel, il suffit de remplacer le journal écrit par les réseaux sociaux, les intérêts des petits propriétaires par ceux des groupes pharmaceutiques ou agro-alimentaires, le populisme par … le populisme, et on y est !
La pièce est peut-être un peu trop manichéenne car il y a bien un conflit entre les intérêts économiques de court terme et les intérêts sanitaires de plus long terme. Je sais de quel côté mon cœur balance, mais ce n’est pas pour autant que je pense qu’il soit bon de nier cette tension.
Et puis Ibsen donne une vision du peuple qui est probablement une des raisons qui explique que la pièce n’ait pas toujours été bien reçue. Il manque d’abord les implications sociales de la découverte du docteur : les « petits propriétaires » voient les conséquences pour eux en terme de baisse d’activité et de revenu, mais on ne voit les ouvriers que comme une masse influençable, alors que pour eux aussi, les répercussions peuvent être graves en terme de chômage et de pauvreté accrue. Certes, la fin propose l’éducation comme voie vers un avenir plus éclairé, mais en attendant, Ibsen montre un personnage que son expérience rend profondément pessimiste, même s’il reste combattif.
Un bon moment de théâtre, un classique que j’ai été contente de découvrir, presque par hasard.
Titre original : En Folkefiende
Titre en anglais : An Enemy of the People
Je n’avais jamais entendu parler de cette pièce d’Henrik Ibsen (il faut dire que je n’ai jamais rien lu ni vu de lui, ceci explique probablement cela…), mais Wikipédia la range parmi ses œuvres majeures. Cette lecture audio comble donc un trou majeur de ma culture générale, même si c’était un trou dont je ne soupçonnais pas l’existence !
Si l’on ne craint pas les anachronismes, on peut résumer cette pièce en disant qu’elle décrit le sort réservé à un lanceur d’alerte, puisque c’est bien ce qu’est le docteur Stockmann, qui s’aperçoit que les eaux de la station thermale de sa ville sont polluées. Il se voit alors comme le bienfaiteur de sa communauté, lui qui a évité un désastre. Mais très vite, les autorités administratives (en la personne de son propre frère), au lieu de voir la catastrophe sanitaire évitée, voient les complications économiques (fermer la station thermale), techniques (refaire toutes les canalisations de la ville) et financières (tout cela va coûter bien cher au contribuable…). S’engage alors un jeu malsain d’intimidation et de décrédibilisation qui ne donne pas une belle image des instances dirigeantes…
Cette pièce a certes été publiée en 1882, mais ce qui est décrit paraît vraiment actuel, il suffit de remplacer le journal écrit par les réseaux sociaux, les intérêts des petits propriétaires par ceux des groupes pharmaceutiques ou agro-alimentaires, le populisme par … le populisme, et on y est !
La pièce est peut-être un peu trop manichéenne car il y a bien un conflit entre les intérêts économiques de court terme et les intérêts sanitaires de plus long terme. Je sais de quel côté mon cœur balance, mais ce n’est pas pour autant que je pense qu’il soit bon de nier cette tension.
Et puis Ibsen donne une vision du peuple qui est probablement une des raisons qui explique que la pièce n’ait pas toujours été bien reçue. Il manque d’abord les implications sociales de la découverte du docteur : les « petits propriétaires » voient les conséquences pour eux en terme de baisse d’activité et de revenu, mais on ne voit les ouvriers que comme une masse influençable, alors que pour eux aussi, les répercussions peuvent être graves en terme de chômage et de pauvreté accrue. Certes, la fin propose l’éducation comme voie vers un avenir plus éclairé, mais en attendant, Ibsen montre un personnage que son expérience rend profondément pessimiste, même s’il reste combattif.
Un bon moment de théâtre, un classique que j’ai été contente de découvrir, presque par hasard.
139raton-liseur
108. -. (-) Le Maître des livres, tome 2 et tome 3 de Umiharu Shinohara, traduit du japonais par Fabien Nabhan
Titre original : Toshokan no Aruji (図書館の主)
Titre en anglais : non traduit



Cette note de lecture se rapporte aux tomes 2 et 3 de la série « Le Maître des livres ».
Je n’avais pas été emballée par le premier tome, mais comme je l’avais emprunté en même temps que les deux suivants, je les ai quand même lus, au cas où cette série arrive à plus m’intéresser. Mais finalement, je reste sur ma faim. Toujours la même recette : une œuvre jeunesse qui nous est résumée et interprétée, et qui permet à un des protagonistes, usager de la bibliothèque ou personnel, d’avancer dans sa propre vie. Un peu trop cucul et irréaliste pour moi (d’autant que parfois, le rapport entre le bouquin et la situation personnelle est plutôt tiré par les cheveux), je n’ai pas réussi à me laisser emporter.
Par contre, même si une grande partie des œuvres présentées est occidentale, ce manga reste profondément japonais dans les relations qui s’instaurent entre les personnages. Que ce soit le désir de réussir sa vie professionnelle, les relations hommes-femmes, ou bien familiales, il y a un côté très dépaysant, avec des réactions qui auxquelles on ne s’attend pas. Mais cet aspect du livre n’a pas suffi à lui seul à m’intéresser à cette galerie de personnages pourtant idylliquement entourée de livres.
Les histoires sont souvent sur deux chapitres et, bien sûr, le dernier chapitre d’un tome est le premier d’une histoire. Cela m’a poussé à lire ces deux tomes, mais je ne poursuivrai pas l’aventure. Dommage, l’idée me plaisait beaucoup...
Titre original : Toshokan no Aruji (図書館の主)
Titre en anglais : non traduit



Cette note de lecture se rapporte aux tomes 2 et 3 de la série « Le Maître des livres ».
Je n’avais pas été emballée par le premier tome, mais comme je l’avais emprunté en même temps que les deux suivants, je les ai quand même lus, au cas où cette série arrive à plus m’intéresser. Mais finalement, je reste sur ma faim. Toujours la même recette : une œuvre jeunesse qui nous est résumée et interprétée, et qui permet à un des protagonistes, usager de la bibliothèque ou personnel, d’avancer dans sa propre vie. Un peu trop cucul et irréaliste pour moi (d’autant que parfois, le rapport entre le bouquin et la situation personnelle est plutôt tiré par les cheveux), je n’ai pas réussi à me laisser emporter.
Par contre, même si une grande partie des œuvres présentées est occidentale, ce manga reste profondément japonais dans les relations qui s’instaurent entre les personnages. Que ce soit le désir de réussir sa vie professionnelle, les relations hommes-femmes, ou bien familiales, il y a un côté très dépaysant, avec des réactions qui auxquelles on ne s’attend pas. Mais cet aspect du livre n’a pas suffi à lui seul à m’intéresser à cette galerie de personnages pourtant idylliquement entourée de livres.
Les histoires sont souvent sur deux chapitres et, bien sûr, le dernier chapitre d’un tome est le premier d’une histoire. Cela m’a poussé à lire ces deux tomes, mais je ne poursuivrai pas l’aventure. Dommage, l’idée me plaisait beaucoup...
140raton-liseur
109. 72. (52) Un lycée pas comme les autres d'Yvonne Meynier
Titre en anglais : The School with a Difference


Les éditions rennaises Goater ont décidé il y a quelques temps de lancer la collection UniversELLES qui met à l’honneur le matrimoine littéraire breton. Ce titre est le deuxième de cette collection, une réédition d’un livre paru dans la collection Rouge et Or, un livre pour jeunes adolescentes, donc. Un livre qui avait gagné en 1962, l’éditeur le mentionne à plusieurs reprises, le Prix de la Fédération des Assocaitions de Parents d’élèves des lycées et collèges français. Cela m’a fait sourire, il y a vraiment des prix littéraires de partout !
Comme l’on a fêté en août dernier la libération de Rennes, la réédition de ce livre et ma lecture sont tout à fait opportunes, puisque dans ce livre, Yvonne Meynier, autrice de romans jeunesse reconnue, utilise très directement sa propre expérience pour raconter, sous la forme d’un roman épistolaire, l’année scolaire 1943-1944, pendant lequel le lycée de jeunes filles de rennes a été déplacé à La Guerche de Bretagne, plus au sud, pour éviter les bombardements et tenter de préserver une scolarité normale aux élèves de l’établissement. Les deux filles aînées d’Yvonne Meynier ont effectivement fréquenté cet établissement délocalisé pendant cette année si particulière et l’on peut donc imaginer que ce qui est raconté ressemble beaucoup à ce que cette famille a vécu à ce moment-là.
Bien sûr, il s’agit d’un roman jeunesse, donc les gentils et les méchants sont facilement identifiables, et puis le livre date du début des années 60, un temps où le discours sur la France résistance battait son plein sous l’œil vigilant de De Gaulle. Il vaut donc mieux lire ce livre en en connaissant le contexte, mais même sans cela, je l’ai trouvé très intéressant.
C’est un témoignage tout ce qu’il y a de plus quotidien de la vie en ce temps de fin d’Occupation. Et Yvonne Meynier décrit d’une façon que je crois ne jamais avoir rencontré avant le fragile équilibre entre la recherche d’une certaine normalité (la scolarité, apprendre à lire à son enfant, fêter Noël, …) et l’adaptation aux conditions de vie plus qu’exceptionnelles, depuis les pénuries alimentaires jusqu’aux bombardements. On observe tout cela à hauteur de jeune fille sage, des jeunes filles tiraillées entre la tristesse suite à la rafle d’une camarade de classe et la fierté d’un premier prix de géographie. La présence d’une petite fille (la troisième fille d’Yvonne Meynier, encore un trait autobiographique) au regard candide permet de mettre un peu de légèreté dans ce livre, en même temps qu’il permet de voir les effets de la guerre sur la construction de l’imaginaire d’un enfant.
Un livre vraiment intéressant, qui aujourd’hui est plus une lecture pour adulte, car il y a bien peu d’action pour intéresser le jeune public d’aujourd’hui, et la place de l’éducation a tellement changé que je ne suis pas sûre que la génération actuelle puisse véritablement s’identifier aux préoccupations de ces deux jeunes filles qui grandissent trop vite et tentent pourtant de préserver la part d’innocence à laquelle chaque enfant devrait avoir le droit.
Titre en anglais : The School with a Difference


Les éditions rennaises Goater ont décidé il y a quelques temps de lancer la collection UniversELLES qui met à l’honneur le matrimoine littéraire breton. Ce titre est le deuxième de cette collection, une réédition d’un livre paru dans la collection Rouge et Or, un livre pour jeunes adolescentes, donc. Un livre qui avait gagné en 1962, l’éditeur le mentionne à plusieurs reprises, le Prix de la Fédération des Assocaitions de Parents d’élèves des lycées et collèges français. Cela m’a fait sourire, il y a vraiment des prix littéraires de partout !
Comme l’on a fêté en août dernier la libération de Rennes, la réédition de ce livre et ma lecture sont tout à fait opportunes, puisque dans ce livre, Yvonne Meynier, autrice de romans jeunesse reconnue, utilise très directement sa propre expérience pour raconter, sous la forme d’un roman épistolaire, l’année scolaire 1943-1944, pendant lequel le lycée de jeunes filles de rennes a été déplacé à La Guerche de Bretagne, plus au sud, pour éviter les bombardements et tenter de préserver une scolarité normale aux élèves de l’établissement. Les deux filles aînées d’Yvonne Meynier ont effectivement fréquenté cet établissement délocalisé pendant cette année si particulière et l’on peut donc imaginer que ce qui est raconté ressemble beaucoup à ce que cette famille a vécu à ce moment-là.
Bien sûr, il s’agit d’un roman jeunesse, donc les gentils et les méchants sont facilement identifiables, et puis le livre date du début des années 60, un temps où le discours sur la France résistance battait son plein sous l’œil vigilant de De Gaulle. Il vaut donc mieux lire ce livre en en connaissant le contexte, mais même sans cela, je l’ai trouvé très intéressant.
C’est un témoignage tout ce qu’il y a de plus quotidien de la vie en ce temps de fin d’Occupation. Et Yvonne Meynier décrit d’une façon que je crois ne jamais avoir rencontré avant le fragile équilibre entre la recherche d’une certaine normalité (la scolarité, apprendre à lire à son enfant, fêter Noël, …) et l’adaptation aux conditions de vie plus qu’exceptionnelles, depuis les pénuries alimentaires jusqu’aux bombardements. On observe tout cela à hauteur de jeune fille sage, des jeunes filles tiraillées entre la tristesse suite à la rafle d’une camarade de classe et la fierté d’un premier prix de géographie. La présence d’une petite fille (la troisième fille d’Yvonne Meynier, encore un trait autobiographique) au regard candide permet de mettre un peu de légèreté dans ce livre, en même temps qu’il permet de voir les effets de la guerre sur la construction de l’imaginaire d’un enfant.
Un livre vraiment intéressant, qui aujourd’hui est plus une lecture pour adulte, car il y a bien peu d’action pour intéresser le jeune public d’aujourd’hui, et la place de l’éducation a tellement changé que je ne suis pas sûre que la génération actuelle puisse véritablement s’identifier aux préoccupations de ces deux jeunes filles qui grandissent trop vite et tentent pourtant de préserver la part d’innocence à laquelle chaque enfant devrait avoir le droit.
141raton-liseur
>138 dchaikin: Welcome!
142Dilara86
>130 raton-liseur: Not sure we will have enough interest for a group read on Dette : 5000 ans d'histoire / Debt: The 5000 first years, but we could try. Do you think I should post something on the message board?
Well, there's no harm in trying...
>137 raton-liseur: Plus ça change...
>140 raton-liseur: Interesting! I wouldn't want to buy it, but I'll see if my library has it.
Well, there's no harm in trying...
>137 raton-liseur: Plus ça change...
>140 raton-liseur: Interesting! I wouldn't want to buy it, but I'll see if my library has it.
143raton-liseur
>142 Dilara86: Ok, I think I'll post a message a bit latter on Club Read 2025 then to see if there is an interest in a group read for Dette : 5000 ans d'histoire / Debt: The 5000 first years!
I have been reading a lot of graphic stories in the past few weeks, mainly because of the second graphic prize that my library is organising. This has made me read books I was not planning to read. I could be a good thing, but this time, it was not and I am quite disappointed with the selection (I have read all books but one and don't know which one I will vote for, because none seems good enough for me to bother casting a vote...)
So you are about to enter a long list of grumpy reviews. If you don't want to read them, which I would not blame you for, please consider skipping a few posts and jumping directly to further posts (>150 raton-liseur: and >151 raton-liseur: are for audio reads, some good some less, and >152 raton-liseur: is an all-positive review!), as I have kept the best reads for the last posts of the day!
I have been reading a lot of graphic stories in the past few weeks, mainly because of the second graphic prize that my library is organising. This has made me read books I was not planning to read. I could be a good thing, but this time, it was not and I am quite disappointed with the selection (I have read all books but one and don't know which one I will vote for, because none seems good enough for me to bother casting a vote...)
So you are about to enter a long list of grumpy reviews. If you don't want to read them, which I would not blame you for, please consider skipping a few posts and jumping directly to further posts (>150 raton-liseur: and >151 raton-liseur: are for audio reads, some good some less, and >152 raton-liseur: is an all-positive review!), as I have kept the best reads for the last posts of the day!
144raton-liseur
Well, this one is not a graphic book, but it's a grumpy review...
112. -. (-) Algérie, 1960 : Journal d'un appelé de Bernard Ponty
Titre en anglais : non traduit
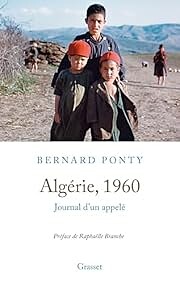

Merci aux éditions Grasset de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
Il faut parfois du temps pour qu’un événement historique entre en littérature. Alors quand j’ai vu ce livre, témoignage d’un jeune appelé pendant la guerre (non, pardon, les événements…) d’Algérie, je me suis dit que ce pourrait être un bon moyen d’en savoir plus, car des livres s’attaquent bien au sujet en ce moment, mais il reste beaucoup à dire, notamment du côté des exactions françaises.
Mais ce livre n’est pas ce que j’en attendais. Il s’agit du journal (dont j’ai la sensation qu’il est écrit après coup, ou récrit une fois que le temps a donné un peu de perspective aux événements) écrit par un jeune homme envoyé en Algérie en 1960, c’est-à-dire après que la guerre se soit déployée pendant plusieurs années et que ses moments les plus noirs soient déjà connus, ou du moins commençaient à être envisagés. Il arrive donc dedans, mais avec un regard d’après, et cela rend sa lecture des événements peut-être plus complexe à comprendre.
Et puis surtout, ce journal parle assez peu de ce qui se passe au quotidien. Des éléments sont rapportés, mais c’est une vision très partielle de la vie d’un homme de troupe, et ce sont surtout les idées qui lui passent par la tête que nous suivons, parfois par rapport aux choses qui l’entourent, ce qu’il voit et sa propre réaction (ou absence de réaction), mais surtout comment cette expérience le change, transformant l’adolescent qu’il se sent encore être en un homme qui a plus de mal à rêver, dont les illusions se fissurent et les principes sont mis à mal.
Ce n’est pas inintéressant en soi, mais ce n’est juste pas ce que j’espérais de ce livre, et je n’ai hélas pas non plus accroché au style, très flux de conscience, mais d’une écriture pas assez maîtrisée pour me permettre de me laisser entraîner dans ce courant. Je suis donc passée à côté de ce livre, mais plus parce que ce n’était pas ce que j’en attendais, d’autres devraient y trouver leur compte, probablement des lecteurs qui en savent plus que moi sur cette période, et pour qui les pensées de ce jeune appelé du contingent feront écho à leur propre expérience ou à celle de proches.
112. -. (-) Algérie, 1960 : Journal d'un appelé de Bernard Ponty
Titre en anglais : non traduit
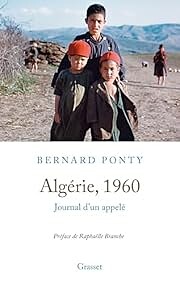

Merci aux éditions Grasset de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
Il faut parfois du temps pour qu’un événement historique entre en littérature. Alors quand j’ai vu ce livre, témoignage d’un jeune appelé pendant la guerre (non, pardon, les événements…) d’Algérie, je me suis dit que ce pourrait être un bon moyen d’en savoir plus, car des livres s’attaquent bien au sujet en ce moment, mais il reste beaucoup à dire, notamment du côté des exactions françaises.
Mais ce livre n’est pas ce que j’en attendais. Il s’agit du journal (dont j’ai la sensation qu’il est écrit après coup, ou récrit une fois que le temps a donné un peu de perspective aux événements) écrit par un jeune homme envoyé en Algérie en 1960, c’est-à-dire après que la guerre se soit déployée pendant plusieurs années et que ses moments les plus noirs soient déjà connus, ou du moins commençaient à être envisagés. Il arrive donc dedans, mais avec un regard d’après, et cela rend sa lecture des événements peut-être plus complexe à comprendre.
Et puis surtout, ce journal parle assez peu de ce qui se passe au quotidien. Des éléments sont rapportés, mais c’est une vision très partielle de la vie d’un homme de troupe, et ce sont surtout les idées qui lui passent par la tête que nous suivons, parfois par rapport aux choses qui l’entourent, ce qu’il voit et sa propre réaction (ou absence de réaction), mais surtout comment cette expérience le change, transformant l’adolescent qu’il se sent encore être en un homme qui a plus de mal à rêver, dont les illusions se fissurent et les principes sont mis à mal.
Ce n’est pas inintéressant en soi, mais ce n’est juste pas ce que j’espérais de ce livre, et je n’ai hélas pas non plus accroché au style, très flux de conscience, mais d’une écriture pas assez maîtrisée pour me permettre de me laisser entraîner dans ce courant. Je suis donc passée à côté de ce livre, mais plus parce que ce n’était pas ce que j’en attendais, d’autres devraient y trouver leur compte, probablement des lecteurs qui en savent plus que moi sur cette période, et pour qui les pensées de ce jeune appelé du contingent feront écho à leur propre expérience ou à celle de proches.
145raton-liseur
114. 21g. (-) Coquelicot de Fanny Vella
Titre en anglais : non traduit


Les livres sur les adolescentes qui doivent apprendre à apprivoiser leur corps sont à la mode en ce moment, une mode que je suis, parce que je trouve intéressant de lire des livres que je peux après proposer à M'ni Raton, mon adolescente à moi. Donc ce livre m'intéressait, avec ses jolies couleurs dans des palettes de rouge et sa belle couverture sensible.
Je me suis lancée confiante dans cette lecture, mais je suis un peu désolée de ne pas en avoir retiré grand-chose. Notre Emilie a des problèmes avec son corps, mais on s'aperçoit qu'il y a un traumatisme grave à l'origine de cela. J'ai un peu de mal avec tous ces livres qui lient mal-être adolescent ou adulte et traumatisme d'enfance. Un peu comme si par ricochet, cela discréditait les mal-être plus banals, qui n'ont pas de cause grave et unique identifiable, plus un faisceau de situations et d'habitudes peut-être.
Je suis un peu désolée que cette critique un peu générale tombe sur ce livre-là, car ce reproche, je pourrais le faire à d'autres livres dans la même veine. Mais celui-ci, en plus de charger la barque, n'apporte pas grand-chose, me semble-t-il par rapport à d'autres livres de la même veine. Je n'y ai pas vu de regard particulier ou neuf (le contraste entre les deux gynécologues dépeints dans le livre a quelque chose d'un peu caricatural par exemple) et je suis donc assez déçue.
Je me dis même un peu que les difficultés (qui ne m'ont pas empêchées de construire une relation épanouie et une vie qui m'apporte beaucoup) que j'ai pu ou que je peux avoir avec mon corps ou ma sexualité sont ridicules et que je ne devrais pas me plaindre, ce qui est probablement l'effet inverse de celui que l'autrice voulait provoquer.
C'est peut-être un livre qui tombe au mauvais moment, que je lis alors que je suis un peu déprimée et un peu susceptible, donc je ne lui fais peut-être pas honneur, mais je suis sortie de cette lecture en restant un peu sur ma faim, et peut-être même un peu plus amère vis-à-vis de moi-même…
Titre en anglais : non traduit


Les livres sur les adolescentes qui doivent apprendre à apprivoiser leur corps sont à la mode en ce moment, une mode que je suis, parce que je trouve intéressant de lire des livres que je peux après proposer à M'ni Raton, mon adolescente à moi. Donc ce livre m'intéressait, avec ses jolies couleurs dans des palettes de rouge et sa belle couverture sensible.
Je me suis lancée confiante dans cette lecture, mais je suis un peu désolée de ne pas en avoir retiré grand-chose. Notre Emilie a des problèmes avec son corps, mais on s'aperçoit qu'il y a un traumatisme grave à l'origine de cela. J'ai un peu de mal avec tous ces livres qui lient mal-être adolescent ou adulte et traumatisme d'enfance. Un peu comme si par ricochet, cela discréditait les mal-être plus banals, qui n'ont pas de cause grave et unique identifiable, plus un faisceau de situations et d'habitudes peut-être.
Je suis un peu désolée que cette critique un peu générale tombe sur ce livre-là, car ce reproche, je pourrais le faire à d'autres livres dans la même veine. Mais celui-ci, en plus de charger la barque, n'apporte pas grand-chose, me semble-t-il par rapport à d'autres livres de la même veine. Je n'y ai pas vu de regard particulier ou neuf (le contraste entre les deux gynécologues dépeints dans le livre a quelque chose d'un peu caricatural par exemple) et je suis donc assez déçue.
Je me dis même un peu que les difficultés (qui ne m'ont pas empêchées de construire une relation épanouie et une vie qui m'apporte beaucoup) que j'ai pu ou que je peux avoir avec mon corps ou ma sexualité sont ridicules et que je ne devrais pas me plaindre, ce qui est probablement l'effet inverse de celui que l'autrice voulait provoquer.
C'est peut-être un livre qui tombe au mauvais moment, que je lis alors que je suis un peu déprimée et un peu susceptible, donc je ne lui fais peut-être pas honneur, mais je suis sortie de cette lecture en restant un peu sur ma faim, et peut-être même un peu plus amère vis-à-vis de moi-même…
146raton-liseur
115. -. (-) The Summer Hikaru died, tome 1 de Mokumokuren, traduit du japonais par Manon Debienne et Sayaka Okada
Titre original : non relevé
Titre en anglais : The Summer Hikaru Died, Vol. 1
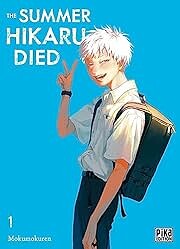

Un drôle de manga, entre histoire d’ados et une terreur habillement distillée. Pas du tout mon genre de lecture, mais il fait partie de la sélection de notre prix bd, donc je le lis aussi. Mais finalement, dans son genre, il est plutôt pas mal fait et j’imagine que pour les lecteurs qui aiment ce type de lecture, pas vraiment horreur, mais qui joue sur cette corde, ce doit être une lecture agréable.
Un bémol cependant, la relation entre les deux adolescents, Hikaru et Yoshiki, est ambiguë. Le problème n’est pas là, mais plutôt dans le mélange entre une possible homosexualité et une relation plus que toxique entre ces deux personnages (l’un menaçant de tuer l’autre, les deux restant collés ensemble comme si plus rien que cette relation n’existait, on n’est pas loin de la définition de l’emprise, non ? ). Certes, il est un peu difficile de juger de tout cela après seulement le premier tome d’une série qui en compte pour l’instant quatre, mais c’est quelque chose à regarder d’un peu plus près je pense, notamment pour la lecture par un public plutôt jeune et/ou qui n’aurait pas assez de recul sur ces questions.
Titre original : non relevé
Titre en anglais : The Summer Hikaru Died, Vol. 1
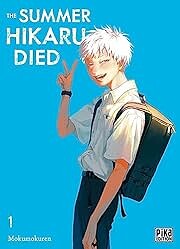

Un drôle de manga, entre histoire d’ados et une terreur habillement distillée. Pas du tout mon genre de lecture, mais il fait partie de la sélection de notre prix bd, donc je le lis aussi. Mais finalement, dans son genre, il est plutôt pas mal fait et j’imagine que pour les lecteurs qui aiment ce type de lecture, pas vraiment horreur, mais qui joue sur cette corde, ce doit être une lecture agréable.
Un bémol cependant, la relation entre les deux adolescents, Hikaru et Yoshiki, est ambiguë. Le problème n’est pas là, mais plutôt dans le mélange entre une possible homosexualité et une relation plus que toxique entre ces deux personnages (
147raton-liseur
116. 22g. (-) Furieuse de Geoffroy Monde (scénario) et Mathieu Burniat (dessin)
Titre en anglais : non traduit
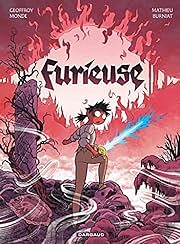


Une idée originale que cette réécriture, ou plutôt cette suite, au mythe d’Arthur, et la façon dont le pouvoir corrompt même les plus forts. J’imagine que ce livre se veut féministe, mais je l’ai trouvé trop outré. La fureur (pour reprendre le titre) d’une jeune fille qu’on ne laisse pas écrire son propre avenir, pourquoi pas. Mais tout est trop dans ce livre. Les dessins trop violents, les dialogues trop sommaires, les couleurs et le lettrage trop agressifs… Je n’ai ni réussi à passer un bon moment en prenant tout cela au premier degré, ni pu y trouver un message qui aurait rendu la lecture intéressante. Je passe.
Titre en anglais : non traduit
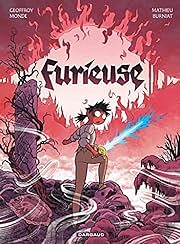


Une idée originale que cette réécriture, ou plutôt cette suite, au mythe d’Arthur, et la façon dont le pouvoir corrompt même les plus forts. J’imagine que ce livre se veut féministe, mais je l’ai trouvé trop outré. La fureur (pour reprendre le titre) d’une jeune fille qu’on ne laisse pas écrire son propre avenir, pourquoi pas. Mais tout est trop dans ce livre. Les dessins trop violents, les dialogues trop sommaires, les couleurs et le lettrage trop agressifs… Je n’ai ni réussi à passer un bon moment en prenant tout cela au premier degré, ni pu y trouver un message qui aurait rendu la lecture intéressante. Je passe.
148raton-liseur
117. 23g. (-) Filles uniques, tomes 1 à 5 de BeKa (scénario) et Camille Méhu (dessin)
Titre en anglais : non traduit

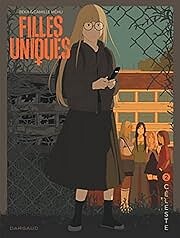


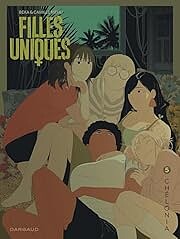


Cette note de lecture se rapporte aux cinq tomes de la série de bandes dessinées « Filles uniques ».
J’aime bien le titre, et puis les couvertures aussi, dans des couleurs sombres qui nous font comprendre où on met les pieds (ou plutôt les yeux) et avec des regards déterminés, qui nous préviennent qu’on va avoir affaire à des demoiselles au caractère bien trempé. Et effectivement, dès le premier tome, on est mis dans l’ambiance, avec cette Paloma qui passe de famille d’accueil en famille d’accueil parce qu’elle fait toujours tout pour être rejetée. Puis vient cette idée du club des mal-barrées, 5 filles (5 tomes) qui unissent leurs fêlures pour en faire une force. Chaque tome se concentre sur un personnage et sur la résolution de son problème, même si, et ça c’est intéressant, on voit certains de ces personnages continuer à évoluer (et à se confronter à leurs démons) dans les tomes suivants : tout ne se résout pas toujours en 48 pages.
Mais, un peu comme dans une autre œuvre graphique lues récemment, j’ai trouvé que les histoires de ces ados étaient particulièrement lourdes, toutes venant de familles particulièrement dysfonctionnelles, ce qui, je trouve, rend l’identification difficile pour la plupart des enfants, à moins de penser que nombre d’ados se fantasment dans des familles dysfonctionnelles (ce qui n’est pas impossible, simple variante – en plus sombre – du fantasme de la princesse perdue ou volée à la naissance). La seule dont la famille n’est pas dysfonctionnelle (mais pas particulièrement aimante non plus), Apolline, voit étrangement son histoire et ses blessures moins développées que celles des autres.
Et puis le dernier tome est vraiment alambiqué et donne une nouvelle perspective à toute la série, qui tout à coup devient à mon sens moins intéressante. Et puis la fin qui n’en est pas une m’a surprise et intéressée en tant qu’adulte, mais je ne suis pas certaine qu’elle soit satisfaisante pour un public plus jeune.
J’étais donc partie confiante, mais je reviens un peu mitigée de cette série, qui a de bons côtés mais qui n’a pas complètement réussi à me convaincre. M’ni Raton a commencé à la lire hier ou avant-hier, donc il faudra que je revienne faire un tour par ici pour rendre compte de son ressenti, puisqu’après tout, elle est mieux placée que moi pour juger de l’intérêt de ces bd !
Titre en anglais : non traduit

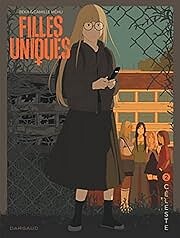


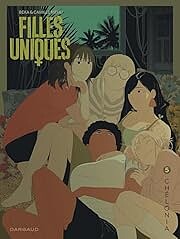


Cette note de lecture se rapporte aux cinq tomes de la série de bandes dessinées « Filles uniques ».
J’aime bien le titre, et puis les couvertures aussi, dans des couleurs sombres qui nous font comprendre où on met les pieds (ou plutôt les yeux) et avec des regards déterminés, qui nous préviennent qu’on va avoir affaire à des demoiselles au caractère bien trempé. Et effectivement, dès le premier tome, on est mis dans l’ambiance, avec cette Paloma qui passe de famille d’accueil en famille d’accueil parce qu’elle fait toujours tout pour être rejetée. Puis vient cette idée du club des mal-barrées, 5 filles (5 tomes) qui unissent leurs fêlures pour en faire une force. Chaque tome se concentre sur un personnage et sur la résolution de son problème, même si, et ça c’est intéressant, on voit certains de ces personnages continuer à évoluer (et à se confronter à leurs démons) dans les tomes suivants : tout ne se résout pas toujours en 48 pages.
Mais, un peu comme dans une autre œuvre graphique lues récemment, j’ai trouvé que les histoires de ces ados étaient particulièrement lourdes, toutes venant de familles particulièrement dysfonctionnelles, ce qui, je trouve, rend l’identification difficile pour la plupart des enfants, à moins de penser que nombre d’ados se fantasment dans des familles dysfonctionnelles (ce qui n’est pas impossible, simple variante – en plus sombre – du fantasme de la princesse perdue ou volée à la naissance). La seule dont la famille n’est pas dysfonctionnelle (mais pas particulièrement aimante non plus), Apolline, voit étrangement son histoire et ses blessures moins développées que celles des autres.
Et puis le dernier tome est vraiment alambiqué et donne une nouvelle perspective à toute la série, qui tout à coup devient à mon sens moins intéressante. Et puis la fin qui n’en est pas une m’a surprise et intéressée en tant qu’adulte, mais je ne suis pas certaine qu’elle soit satisfaisante pour un public plus jeune.
J’étais donc partie confiante, mais je reviens un peu mitigée de cette série, qui a de bons côtés mais qui n’a pas complètement réussi à me convaincre. M’ni Raton a commencé à la lire hier ou avant-hier, donc il faudra que je revienne faire un tour par ici pour rendre compte de son ressenti, puisqu’après tout, elle est mieux placée que moi pour juger de l’intérêt de ces bd !
149raton-liseur
118. 24g. (-) Je suis au-delà de la mort de L'Homme Etoilé
Titre en anglais : non traduit


Il est bien possible après tout que j’habite la grotte Cosquer ou la grotte Chauvet, car je n’avais jamais entendu parler de L’Homme Etoilé, que la quatrième de couverture comme l’infirmier star des réseaux sociaux. Bon, il faut dire qu’en dehors de mes deux réseaux sociaux exclusivement consacrés au livres, celui-ci et l’autre, je ne fréquente pas ces parages-là. Fort de son expérience, cet Homme Etoilé nous présente donc l’histoire d’un homme d’une trentaine d’années, plein de vie et de projets, qui découvre qu’il a un cancer. On le suit pendant les différentes étapes de la maladie et du traitement. On devine plus qu’on ne voit, son regard qui change sur la vie, sur les relations humaines, sur ce qui est important.
Mais ce genre de bd fait légion aujourd’hui, et, si celle-ci est certes très tendre et très respectueuse, je n’ai pas trouvé qu’elle apportait quelque chose de neuf par rapport à toutes les autres bd sur le sujet, qui sont légion. Je suis donc assez peu emballée. J’ai passé un bon moment, malgré le sujet, j’ai souri parfois, versé une larme aussi, mais tout cela ne me laissera pas une impression durable. Vite lu, et presque aussi vite oublié, tant pis.
Titre en anglais : non traduit


Il est bien possible après tout que j’habite la grotte Cosquer ou la grotte Chauvet, car je n’avais jamais entendu parler de L’Homme Etoilé, que la quatrième de couverture comme l’infirmier star des réseaux sociaux. Bon, il faut dire qu’en dehors de mes deux réseaux sociaux exclusivement consacrés au livres, celui-ci et l’autre, je ne fréquente pas ces parages-là. Fort de son expérience, cet Homme Etoilé nous présente donc l’histoire d’un homme d’une trentaine d’années, plein de vie et de projets, qui découvre qu’il a un cancer. On le suit pendant les différentes étapes de la maladie et du traitement. On devine plus qu’on ne voit, son regard qui change sur la vie, sur les relations humaines, sur ce qui est important.
Mais ce genre de bd fait légion aujourd’hui, et, si celle-ci est certes très tendre et très respectueuse, je n’ai pas trouvé qu’elle apportait quelque chose de neuf par rapport à toutes les autres bd sur le sujet, qui sont légion. Je suis donc assez peu emballée. J’ai passé un bon moment, malgré le sujet, j’ai souri parfois, versé une larme aussi, mais tout cela ne me laissera pas une impression durable. Vite lu, et presque aussi vite oublié, tant pis.
150raton-liseur
Ok, I think I am done with my grumpiest reviews. I'll post a few audio reviews now. Some are just so, so, and some are more positive. A mixed bag...
First, three fairly good ones, that are 1985 radio programmes, labelled "Les Nouvelles du Crime" (a pun on "Nouvelles", that means in French both "News" and "Short stories"). I only managed to download three, out of the five that were programmed at the end of November. Three pretty good ones, so I would have loved to listen to the two others, that are "L'écharpe de soie rouge" by Maurice Leblanc, featuring the famous Arsène Lupin and an unexpected short story by Rudyard Kipling, Le retour d'Imray. I'm intrigued by this Kipling story so I guess I'll have to find it somewhere else!
Témoin à charge d'Agatha Christie ; responsables de la traduction, de l'adaptation et de la lecture non précisés
Titre original : Witness for the Prosecution
Agatha Christie sans un de ses détectives fétiches, c’est assez rare et cela laisse un peu de place à la nouveauté. Ici, on suit l’avocat d’un homme accusé du meurtre d’une femme et dont la sincérité mise à nier ce crime touche l’homme de loi. Celui-ci cherche une stratégie pour sauver son client et se met en quête d’un témoin qui pourrait le disculper.
C’est une nouvelle qui arrive plutôt assez tôt dans l’œuvre d’Agatha Christie et qui joue sur les ressorts psychologiques tant des protagonistes de l’affaire que du personnel de la justice. Une lecture bien plaisante, et je ne suis pas la seule à le penser puisque cette nouvelle a été adaptée au théâtre par Agatha Christie elle-même (qui en a modifié la fin, c’est presque dommage d’après ce que j’ai lu sur cette nouvelle fin, certes moins abrupte, mais peut-être plus cliché) et plusieurs fois au cinéma aussi. A découvrir, tant par ceux qui aiment Agatha Christie et qui pourraient en découvrir ici une nouvelle facette, que par ceux qui n’aiment pas trop la reine du crime et qui pourraient se laisser séduire par cette longue nouvelle ou ce court roman dans lequel elle nous amène sur un terrain différent.
Erreur sur la victime de Horace Mc Coy ; responsables de la traduction, de l'adaptation et de la lecture non précisés
Titre original : non précisé
Une longue nouvelle dans le plus pur style hard boiled. La pègre, la police corrompue, les méthodes d’enquête pas très orthodoxes, des fausses pistes... Tout ce qu’il faut pour passer un bon moment, dont une victime imprévue fera les frais…
La Maison de Turk Street de Dashiell Hammett ; responsables de la traduction, de l'adaptation et de la lecture non précisés
Titre original : The House in Turk Street
Une longue nouvelle par un des maîtres incontestés du hard boiled, mais dont l’intrigue à rebondissement m’a paru plutôt originale et plaisante à suivre. Il faut se méfier des apparences parfois, et connaître la psychologie des méchants quand on veut espérer sauver sa peau !
First, three fairly good ones, that are 1985 radio programmes, labelled "Les Nouvelles du Crime" (a pun on "Nouvelles", that means in French both "News" and "Short stories"). I only managed to download three, out of the five that were programmed at the end of November. Three pretty good ones, so I would have loved to listen to the two others, that are "L'écharpe de soie rouge" by Maurice Leblanc, featuring the famous Arsène Lupin and an unexpected short story by Rudyard Kipling, Le retour d'Imray. I'm intrigued by this Kipling story so I guess I'll have to find it somewhere else!
Témoin à charge d'Agatha Christie ; responsables de la traduction, de l'adaptation et de la lecture non précisés
Titre original : Witness for the Prosecution
Agatha Christie sans un de ses détectives fétiches, c’est assez rare et cela laisse un peu de place à la nouveauté. Ici, on suit l’avocat d’un homme accusé du meurtre d’une femme et dont la sincérité mise à nier ce crime touche l’homme de loi. Celui-ci cherche une stratégie pour sauver son client et se met en quête d’un témoin qui pourrait le disculper.
C’est une nouvelle qui arrive plutôt assez tôt dans l’œuvre d’Agatha Christie et qui joue sur les ressorts psychologiques tant des protagonistes de l’affaire que du personnel de la justice. Une lecture bien plaisante, et je ne suis pas la seule à le penser puisque cette nouvelle a été adaptée au théâtre par Agatha Christie elle-même (qui en a modifié la fin, c’est presque dommage d’après ce que j’ai lu sur cette nouvelle fin, certes moins abrupte, mais peut-être plus cliché) et plusieurs fois au cinéma aussi. A découvrir, tant par ceux qui aiment Agatha Christie et qui pourraient en découvrir ici une nouvelle facette, que par ceux qui n’aiment pas trop la reine du crime et qui pourraient se laisser séduire par cette longue nouvelle ou ce court roman dans lequel elle nous amène sur un terrain différent.
Erreur sur la victime de Horace Mc Coy ; responsables de la traduction, de l'adaptation et de la lecture non précisés
Titre original : non précisé
Une longue nouvelle dans le plus pur style hard boiled. La pègre, la police corrompue, les méthodes d’enquête pas très orthodoxes, des fausses pistes... Tout ce qu’il faut pour passer un bon moment, dont une victime imprévue fera les frais…
La Maison de Turk Street de Dashiell Hammett ; responsables de la traduction, de l'adaptation et de la lecture non précisés
Titre original : The House in Turk Street
Une longue nouvelle par un des maîtres incontestés du hard boiled, mais dont l’intrigue à rebondissement m’a paru plutôt originale et plaisante à suivre. Il faut se méfier des apparences parfois, et connaître la psychologie des méchants quand on veut espérer sauver sa peau !
151raton-liseur
Quelques autres lectures audio, un peu de tout cette fois.
Le Dahlia noir de James Ellroy, traduit de l'anglais par Freddy Michalsky ; adapté par Michel Quint et lu par Pierre-Bernard Donnadieu
Titre original : Black Dahlia
J’ai écouté l’adaptation radiophonique qu’en a fait France Culture par curiosité, surtout parce que j’avais entendu il y a peu que cette œuvre était une étape marquante de la littérature récente, mais ce n’est pas le genre de bouquin que je lis d’habitude.
Et ça n’a pas loupé, je ne peux pas dire que j’ai aimé… Trop gore pour moi, presque voyeuriste à mon goût, avec des personnages tous plus malsains les uns que les autres. James Ellroy, quand il parle de ce livre, fait un rapprochement entre cette histoire et le meurtre de sa mère. J’imagine bien la part de vérité qu’il peut y avoir dans cette histoire, mais ce n’est pas une facette de la réalité ou de l’histoire récente qui m’intéresse particulièrement, et encore moins qui me fascine. Décidément, le genre n’est pas fait pour moi.
Extrêmement fort et incroyablement près de Jonathan Safran Foer, traduit de l'anglais par Jacqueline Huet et Jean-Pierre Carasso ; adapté par Cécile Laffon et lu par Edgar Cemin
Titre original : Extremely Loud and Incredibly Close
Avec ce livre, paru aux Etats-Unis dès 2005, Jonathan Safran Foer tente une première mise en littérature d’un des premiers traumatismes du XXIème siècle, les attentats du 11 septembre 2001. Avec si peu de recul, cela peut être périlleux, mais l’auteur s’en sort plutôt correctement, avec une œuvre qui n’est pas (à mon avis) d’un grand intérêt littéraire, mais qui évite les écueils principaux. En se mettant à hauteur d’un enfant qui semble présenter quelques traits d’autisme, il peut inventer une histoire un peu loufoque et un brin invraisemblable pour explorer le deuil sous différentes formes. Il évite aussi le travers du tout est bien qui finit bien qui serait déplacé ici. Une lecture à la portée de tous, gentillette sans être mièvre. Pourquoi pas...
Au Bonheur des Dames d'Emile Zola ; extraits choisis par Katell Guillou et lus par François Loriquet
Titre en anglais : The Ladies' Paradise
Je la connais, bien sûr, cette histoire, et j’ai été contente d’en écouter cette version audio qui m’a replongée dans toutes les péripéties de la conquête de Paris par Denise. Cette ode à la faiblesse de la femme et à la futilité de la mode n’est pas vraiment un sentiment que je partage, ce qui fait qu’il y a toujours un petit quelque chose qui m’exaspère dans ce livre, mais je dois être une midinette au fond, parce que cette histoire d’amour entre Mouret et Denise (oh, quelle asymétrie déjà dans les personnages !) me fait fondre à chaque fois.
Les Révoltés de la Bounty de Jules Verne ; lu par Christian Gonon
Titre en anglais : The Mutineers of the Bounty
Une histoire célèbre, mais pas l’œuvre la plus connue de Jules Verne. J’ai écouté ce livre pour un moment de détente, et c’était très bien pour cela. Jules Verne n’est pas forcément un grand psychologue, il s’en tient aux faits, et ne cherche même pas vraiment à combler les vides et à faire les liens entre les événements. Tout cela nous est livré de façon assez brute, à part une petite morale bien conservatrice à la fin tout de même. Une chouette lecture, mais principalement pour les inconditionnels de Jules Verne.
Le Dahlia noir de James Ellroy, traduit de l'anglais par Freddy Michalsky ; adapté par Michel Quint et lu par Pierre-Bernard Donnadieu
Titre original : Black Dahlia
J’ai écouté l’adaptation radiophonique qu’en a fait France Culture par curiosité, surtout parce que j’avais entendu il y a peu que cette œuvre était une étape marquante de la littérature récente, mais ce n’est pas le genre de bouquin que je lis d’habitude.
Et ça n’a pas loupé, je ne peux pas dire que j’ai aimé… Trop gore pour moi, presque voyeuriste à mon goût, avec des personnages tous plus malsains les uns que les autres. James Ellroy, quand il parle de ce livre, fait un rapprochement entre cette histoire et le meurtre de sa mère. J’imagine bien la part de vérité qu’il peut y avoir dans cette histoire, mais ce n’est pas une facette de la réalité ou de l’histoire récente qui m’intéresse particulièrement, et encore moins qui me fascine. Décidément, le genre n’est pas fait pour moi.
Extrêmement fort et incroyablement près de Jonathan Safran Foer, traduit de l'anglais par Jacqueline Huet et Jean-Pierre Carasso ; adapté par Cécile Laffon et lu par Edgar Cemin
Titre original : Extremely Loud and Incredibly Close
Avec ce livre, paru aux Etats-Unis dès 2005, Jonathan Safran Foer tente une première mise en littérature d’un des premiers traumatismes du XXIème siècle, les attentats du 11 septembre 2001. Avec si peu de recul, cela peut être périlleux, mais l’auteur s’en sort plutôt correctement, avec une œuvre qui n’est pas (à mon avis) d’un grand intérêt littéraire, mais qui évite les écueils principaux. En se mettant à hauteur d’un enfant qui semble présenter quelques traits d’autisme, il peut inventer une histoire un peu loufoque et un brin invraisemblable pour explorer le deuil sous différentes formes. Il évite aussi le travers du tout est bien qui finit bien qui serait déplacé ici. Une lecture à la portée de tous, gentillette sans être mièvre. Pourquoi pas...
Au Bonheur des Dames d'Emile Zola ; extraits choisis par Katell Guillou et lus par François Loriquet
Titre en anglais : The Ladies' Paradise
Je la connais, bien sûr, cette histoire, et j’ai été contente d’en écouter cette version audio qui m’a replongée dans toutes les péripéties de la conquête de Paris par Denise. Cette ode à la faiblesse de la femme et à la futilité de la mode n’est pas vraiment un sentiment que je partage, ce qui fait qu’il y a toujours un petit quelque chose qui m’exaspère dans ce livre, mais je dois être une midinette au fond, parce que cette histoire d’amour entre Mouret et Denise (oh, quelle asymétrie déjà dans les personnages !) me fait fondre à chaque fois.
Les Révoltés de la Bounty de Jules Verne ; lu par Christian Gonon
Titre en anglais : The Mutineers of the Bounty
Une histoire célèbre, mais pas l’œuvre la plus connue de Jules Verne. J’ai écouté ce livre pour un moment de détente, et c’était très bien pour cela. Jules Verne n’est pas forcément un grand psychologue, il s’en tient aux faits, et ne cherche même pas vraiment à combler les vides et à faire les liens entre les événements. Tout cela nous est livré de façon assez brute, à part une petite morale bien conservatrice à la fin tout de même. Une chouette lecture, mais principalement pour les inconditionnels de Jules Verne.
152raton-liseur
And the grumpy reviews are defintely over. Here comes a review for a fairly recent graphic non-fiction book that I found really interesting and I enjoyed reading. Highly recommended for people interested in agriculture and recent agriculture history in France.
119. 25g. (-) Champs de bataille : L'Histoire enfouie du remembrement d'Inès Léraud (scénario) et Pierre Van Hove (dessin)
Titre en anglais : non traduit



Merci aux éditions Delcourt de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
Passionnant ! Bien sûr que j’ai entendu parler du remembrement : un sujet impossible à éviter quand on fait quelques balades nature en Bretagne, un territoire où le remembrement a nécessairement eu des répercussions impossibles à ne pas voir, et puis parce que c’est un marronnier de l’histoire agricole récente. Marronnier, certes, mais qui ne fait généralement pas plus d’une ou deux lignes dans les livres ou les articles sur le sujet, comme si cela allait de soi.
Ce que propose cette bd, c’est de revenir justement sur ce qui semble aller de soi et de montrer quelles ont été les conditions d’application de ce remembrement, ainsi que ses conséquences. Sur le deuxième point, j’avais déjà quelques connaissances, mais j’ai continué à apprendre (je ne savais par exemple pas que le remembrement s’était accompagné du changement de tracé des cours d’eau, avec les conséquences hydrographiques et de ruissellement que l’on peut imaginer). Sur le premier point, par contre, ce fut une découverte totale : voir à quel point le remembrement a été forcé par l’administration (aidée des forces de l’ordre d’ailleurs : imaginer les CRS dans des petits villages bretons, c’est assez cocasse…), à quel point l’opposition a été rude (ça, on peut compter sur les paysans bretons pour ne pas se laisser marcher sur les sabots !), mais aussi à quel point cela a durablement altéré les relations dans des villages déchirés entre les pour et les contre.
Bien sûr, le livre est à charge, les choix politiques de l’époque (l’industrialisation de l’agriculture, la baisse délibérée de la main-d’œuvre agricole, etc.) sont unilatéralement remis en cause, sans voir qu’ils ont aussi eu leur raison d’être (même si, comme souvent, on est allé trop loin, trop vite, sans mesurer les conséquences à long terme) et qu’ils ont parfois été pris de bonne foi. Il est quand même intéressant de voir Pisanni qui exprime des regrets, lui qui a été si influent dans les évolutions de l’agriculture d’après-guerre. La description aussi de la structuration du secteur agricole, avec la FNSEA, et les organismes qui gravitent autour, la continuité entre les politiques du début du XXème siècle, puis du régime de Vichy puis de la Vème République, sont aussi décrites de façon très intéressante. Le format reportage et le format bd rendent peut-être le discours plus univoque et laisse moins de place à la nuance et à la contradiction, mais cela donne un ensemble particulièrement intéressant et convainquant, qui m’a permis de reconsidérer ce que je connaissais ou ce que je croyais connaître de la politique agricole de ces 70 ou 80 dernières années, et qui m’a donné à réfléchir.
Une bd sacrément bien faite et qui peut je pense intéresser quelque soit le niveau de connaissance préalable ou d’affinité avec le monde agricole. Et pour moi qui n’ai pas encore lu Algues vertes, la première bd qui a fait connaître le duo Inès Léraud-Pierre Van Hove, je sais quelle bd je vais emprunter la prochaine fois que je vais chez mes parents. Et d’ailleurs, s’ils n’ont pas encore celle-là, bien que je leur en ai déjà parlé, je sais aussi quel est le prochain livre que je vais leur acheter !
119. 25g. (-) Champs de bataille : L'Histoire enfouie du remembrement d'Inès Léraud (scénario) et Pierre Van Hove (dessin)
Titre en anglais : non traduit



Grâce au remembrement, les revenus agricoles augmentent mais les relations de l’homme avec la société, avec la terre, risquent d’être plus étroitement fondées sur la monnaie, et donc de dépendre de décisions prises ailleurs, étrangères à sa vie. (p. 129).
Merci aux éditions Delcourt de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
Passionnant ! Bien sûr que j’ai entendu parler du remembrement : un sujet impossible à éviter quand on fait quelques balades nature en Bretagne, un territoire où le remembrement a nécessairement eu des répercussions impossibles à ne pas voir, et puis parce que c’est un marronnier de l’histoire agricole récente. Marronnier, certes, mais qui ne fait généralement pas plus d’une ou deux lignes dans les livres ou les articles sur le sujet, comme si cela allait de soi.
Ce que propose cette bd, c’est de revenir justement sur ce qui semble aller de soi et de montrer quelles ont été les conditions d’application de ce remembrement, ainsi que ses conséquences. Sur le deuxième point, j’avais déjà quelques connaissances, mais j’ai continué à apprendre (je ne savais par exemple pas que le remembrement s’était accompagné du changement de tracé des cours d’eau, avec les conséquences hydrographiques et de ruissellement que l’on peut imaginer). Sur le premier point, par contre, ce fut une découverte totale : voir à quel point le remembrement a été forcé par l’administration (aidée des forces de l’ordre d’ailleurs : imaginer les CRS dans des petits villages bretons, c’est assez cocasse…), à quel point l’opposition a été rude (ça, on peut compter sur les paysans bretons pour ne pas se laisser marcher sur les sabots !), mais aussi à quel point cela a durablement altéré les relations dans des villages déchirés entre les pour et les contre.
Bien sûr, le livre est à charge, les choix politiques de l’époque (l’industrialisation de l’agriculture, la baisse délibérée de la main-d’œuvre agricole, etc.) sont unilatéralement remis en cause, sans voir qu’ils ont aussi eu leur raison d’être (même si, comme souvent, on est allé trop loin, trop vite, sans mesurer les conséquences à long terme) et qu’ils ont parfois été pris de bonne foi. Il est quand même intéressant de voir Pisanni qui exprime des regrets, lui qui a été si influent dans les évolutions de l’agriculture d’après-guerre. La description aussi de la structuration du secteur agricole, avec la FNSEA, et les organismes qui gravitent autour, la continuité entre les politiques du début du XXème siècle, puis du régime de Vichy puis de la Vème République, sont aussi décrites de façon très intéressante. Le format reportage et le format bd rendent peut-être le discours plus univoque et laisse moins de place à la nuance et à la contradiction, mais cela donne un ensemble particulièrement intéressant et convainquant, qui m’a permis de reconsidérer ce que je connaissais ou ce que je croyais connaître de la politique agricole de ces 70 ou 80 dernières années, et qui m’a donné à réfléchir.
Une bd sacrément bien faite et qui peut je pense intéresser quelque soit le niveau de connaissance préalable ou d’affinité avec le monde agricole. Et pour moi qui n’ai pas encore lu Algues vertes, la première bd qui a fait connaître le duo Inès Léraud-Pierre Van Hove, je sais quelle bd je vais emprunter la prochaine fois que je vais chez mes parents. Et d’ailleurs, s’ils n’ont pas encore celle-là, bien que je leur en ai déjà parlé, je sais aussi quel est le prochain livre que je vais leur acheter !
153raton-liseur
I went working by public transport for most of November and December, which explains why there are so many audio reads in my thread lately. Quality differed a lot, but there were two outstanding audio-reads: Un Ennemi du peuple / An Enemy of the People by Henrik Ibsen (reviewed in >137 raton-liseur:) and the one that follows, La Maladie blanche / The White Disease by Karel Čapek, coincidently two plays. I enjoyed those two audio-reads immensely, although none will do much to uplift your spirit!
La Maladie blanche de Karel Čapek, traduit du tchèque par Alain van Crugten ; adapté par Baptiste Guiton et lu par Alain Fromager et Sébastien Chassagne
Titre original : Bílá nemoc
Titre en anglais : The White Disease
C’est peut-être un peu exagéré de dire que Karel Čapek est à la mode en ce moment, mais on entend son nom de loin en loin, parce qu’il serait le premier à avoir utilisé le mot robot, dans sa pièce de théâtre RUR de 1920. Avec La Maladie blanche, on n’est pas dans le théâtre de science-fiction, mais dans le théâtre de dystopie, voire de parabole. Le monde est atteint par une pandémie venue de Chine (toute ressemblance avec des événements récents ne peut être que fortuite puisque la pièce date de 1937 !), une maladie incurable qui ressemble à la lèpre, n’atteint que les gens de plus de 45 ou 50 ans, et les fait mourir dans des circonstances peu dignes… Dans les premières scènes, Karel Čapek prend le temps de poser le décor et ne révèle pas tout de suite le véritable sujet de sa pièce. On y voit un professeur de médecine installé et sûr de son savoir (même s’il est inopérant dans ce cas précis), on y voit des hommes qui commencent à trembler pour eux-mêmes et au contraire des jeunes qui voient leurs opportunités professionnelles et sociales se débloquer.
Puis arrive un médecin, pas même un spécialiste, une clientèle pauvre… Mais lui seul a trouvé un remède. Avec une sorte de force tranquille, il arrive à imposer ses conditions pour tester son remède. Ce qui apparaît d’abord comme allant de soi (on teste un médicament sur les pauvres, pas sur les riches !) ou comme une simple excentricité (le docteur traite lui-même ses patients, sans assistant !) se révèle petit à petit comme un plan mûrement réfléchi et soigneusement goupillé, et le docteur Galen se révèle bien moins benêt qu’il ne le laisse paraître au premier abord.
Une très belle mise en scène de l’attrait du pouvoir et, pour coller avec l’époque, du totalitarisme qui en découle. Joliment menée de bout en bout, je suis restée en haleine pendant toute ma lecture audio, et quand j’ai fini par comprendre de quoi il en retournait, je n’ai pu que souhaiter que Karel Čapek trouve une fin adéquate, et là encore je n’ai pas été déçue, la fin estgrinçante à souhait. Karel Čapek n’a pas l’air d’être un grand optimiste, et il vaut mieux ne pas lire ou voir cette pièce si on cherche une lecture douillette qui remonte le moral ou qui redonne foi en l’humanité. Karel Čapek n’a pas l’air d’être un grand optimiste, mais peut-on s’attendre à autre chose de la part d’un homme vivant en Tchéquie dans les années 30.
La Maladie blanche de Karel Čapek, traduit du tchèque par Alain van Crugten ; adapté par Baptiste Guiton et lu par Alain Fromager et Sébastien Chassagne
Titre original : Bílá nemoc
Titre en anglais : The White Disease
C’est peut-être un peu exagéré de dire que Karel Čapek est à la mode en ce moment, mais on entend son nom de loin en loin, parce qu’il serait le premier à avoir utilisé le mot robot, dans sa pièce de théâtre RUR de 1920. Avec La Maladie blanche, on n’est pas dans le théâtre de science-fiction, mais dans le théâtre de dystopie, voire de parabole. Le monde est atteint par une pandémie venue de Chine (toute ressemblance avec des événements récents ne peut être que fortuite puisque la pièce date de 1937 !), une maladie incurable qui ressemble à la lèpre, n’atteint que les gens de plus de 45 ou 50 ans, et les fait mourir dans des circonstances peu dignes… Dans les premières scènes, Karel Čapek prend le temps de poser le décor et ne révèle pas tout de suite le véritable sujet de sa pièce. On y voit un professeur de médecine installé et sûr de son savoir (même s’il est inopérant dans ce cas précis), on y voit des hommes qui commencent à trembler pour eux-mêmes et au contraire des jeunes qui voient leurs opportunités professionnelles et sociales se débloquer.
Puis arrive un médecin, pas même un spécialiste, une clientèle pauvre… Mais lui seul a trouvé un remède. Avec une sorte de force tranquille, il arrive à imposer ses conditions pour tester son remède. Ce qui apparaît d’abord comme allant de soi (on teste un médicament sur les pauvres, pas sur les riches !) ou comme une simple excentricité (le docteur traite lui-même ses patients, sans assistant !) se révèle petit à petit comme un plan mûrement réfléchi et soigneusement goupillé, et le docteur Galen se révèle bien moins benêt qu’il ne le laisse paraître au premier abord.
Une très belle mise en scène de l’attrait du pouvoir et, pour coller avec l’époque, du totalitarisme qui en découle. Joliment menée de bout en bout, je suis restée en haleine pendant toute ma lecture audio, et quand j’ai fini par comprendre de quoi il en retournait, je n’ai pu que souhaiter que Karel Čapek trouve une fin adéquate, et là encore je n’ai pas été déçue, la fin est
154raton-liseur
106. 70. (51) Pourquoi la guerre ? : une correspondance entre Albert Einstein et Sigmund Freud, traduit de l'allemand par Blaise Briod
Titre original : Warum Krieg?
Titre en anglais : Why War?



Si on m’avait dit un jour que je lirais un livre d’Einstein, j’aurais eu du mal à y croire, et si on m’avait dit que je lirais un livre de Freud, là j’aurais tout simplement éclaté de rire. Mais même en matière de lecture il ne faut jamais dire jamais, puisque je me retrouve à lire un livre mêlant ces deux auteurs.
Bon, disons-le d’emblée, j’ai été un peu déçue. La pensée n’est pas si originale que cela (vue avec quelques décennies de distance, certes), et on est vraiment dans le service minimum en terme de correspondance : je n’ai pas vu d’échange d’idée, seulement d’abord une première lettre d’Einstein introduisant le sujet et faisant montre d’une sorte d’admiration un peu forcée et un peu honteuse pour un aîné que l’on sait influent mais dont on n’arrive pas à apprécier les travaux. Puis une deuxième lettre, réponse de Freud, dans laquelle il utilise ses théories pour tenter d’expliquer la propension des êtres humains à faire la guerre. En gros, c’est atavique, c’est comme ça et puis c’est tout. Peut-être que par l’éducation on pourrait y faire quelque chose, mais Freud lui-même ne semble pas vraiment y croire. Et puis voilà, c’est tout, débrouillez-vous avec cela…
Pour Einstein qui était alors un pacifiste convaincu et un fervent activiste de la SDN, c’est presqu’étonnant qu’il est laissé publier ce fascicule (d’une très courte correspondance qu’il avait lui-même suggérée et initiée) qui est d’un pessimisme fini. Dans un monde où les zones de conflit sont probablement plutôt en expansion, c’est un livre que l’on peut lire pour le document historique qu’il est, mais certainement pas pour imaginer des solutions ni même trouver un peu d’espoir...
Titre original : Warum Krieg?
Titre en anglais : Why War?



Si on m’avait dit un jour que je lirais un livre d’Einstein, j’aurais eu du mal à y croire, et si on m’avait dit que je lirais un livre de Freud, là j’aurais tout simplement éclaté de rire. Mais même en matière de lecture il ne faut jamais dire jamais, puisque je me retrouve à lire un livre mêlant ces deux auteurs.
Bon, disons-le d’emblée, j’ai été un peu déçue. La pensée n’est pas si originale que cela (vue avec quelques décennies de distance, certes), et on est vraiment dans le service minimum en terme de correspondance : je n’ai pas vu d’échange d’idée, seulement d’abord une première lettre d’Einstein introduisant le sujet et faisant montre d’une sorte d’admiration un peu forcée et un peu honteuse pour un aîné que l’on sait influent mais dont on n’arrive pas à apprécier les travaux. Puis une deuxième lettre, réponse de Freud, dans laquelle il utilise ses théories pour tenter d’expliquer la propension des êtres humains à faire la guerre. En gros, c’est atavique, c’est comme ça et puis c’est tout. Peut-être que par l’éducation on pourrait y faire quelque chose, mais Freud lui-même ne semble pas vraiment y croire. Et puis voilà, c’est tout, débrouillez-vous avec cela…
Pour Einstein qui était alors un pacifiste convaincu et un fervent activiste de la SDN, c’est presqu’étonnant qu’il est laissé publier ce fascicule (d’une très courte correspondance qu’il avait lui-même suggérée et initiée) qui est d’un pessimisme fini. Dans un monde où les zones de conflit sont probablement plutôt en expansion, c’est un livre que l’on peut lire pour le document historique qu’il est, mais certainement pas pour imaginer des solutions ni même trouver un peu d’espoir...
155raton-liseur
105. 69. (50) Terrasses, ou Notre Long Baiser si longtemps retardé de Laurent Gaudé
Titre en anglais : non traduit


J’ai vu ce livre sur les tables de ma librairie (enfin, pas la mienne, mais celle où on peut toujours me trouver quand je vais faire un tour en ville...) à sa sortie il y a quelques mois. J’étais toute contente de trouver un nouveau titre de cet auteur que j’apprécie beaucoup. Puis j’ai lu le résumé et je me suis dit que je n’étais peut-être pas prête à lire un livre sur les attentats du 13 novembre 2015. Mais en repassant à la librairie quelques mois plus tard, j’ai fini par me laisser tenter, me disant qu’après tout c’était du Laurent Gaudé, donc que je pouvais peut-être lui faire confiance malgré la difficulté du sujet.
Et ce n’était pas prévu comme ça, mais j’ai pris ce livre un soir (alors qu’il y avait classe le lendemain), et je n’ai pas pu le lâcher sans l’avoir terminé. Trop dur pour que je le laisse en suspens.
Trop envoûtant aussi, même si ce mot peut paraître étrange. Envoûtant parce que ce livre est comme une longue récitation, de longs monologues qui se tressent comme un natte épaisse à laquelle se raccrocher pour ne pas sombrer.
On sent ici à chaque page les influences de Laurent Gaudé qui fait de cette tragédie un drame antique dans lequel le chœur des anonymes qui ont eu un rôle ce jour-là, sans l’avoir demandé. Le livre ne parle vraiment que de la soirée des attentats et un tout petit peu de la nuit qui a suivi. On y croise les gens aux terrasses, ceux au concert, et puis plus tard les urgentistes, les forces de l’ordre. Il y a aussi ceux qui resteront et qui devront affronter l’attente et l’angoisse, puis l’horreur de la confirmation.
Je dis que le livre ne parle que de la soirée, c’est faux, en fait il commence le 13 au matin, il suit ces gens, qui commencent leur journée comme tout un chacun, ceux qui pensent à leur journée de travail, ceux qui se disputent avec leur conjoint, ceux qui s’émerveillent d’une si douce journée si tard dans la saison et qui se promettent d’en profiter ce vendredi soir, ceux qui ont une amoureuse à rencontrer, un anniversaire à fêter. Et s’invite un personnage dont on a perdu l’habitude dans notre littérature moderne, le hasard. Le simple et pur hasard qui fait choisir une table plutôt qu’une autre, qui fait se lever à une seconde plutôt qu’à une autre. Le hasard, qui semble le personnage principal de la pièce, jusqu’à ce qu’il ait rempli son rôle et alors quand il a fait son choix, il s’efface et laisse ceux qu’il a pointé du doigt prendre le centre de la scène.
J’ai beaucoup aimé cette figure du hasard, qui pour moi a deux fonctions. La première est de réussir à faire entrer le lecteur dans l’histoire malgré la difficulté de ce qui est raconté. C’est le hasard qui a choisi, et le hasard aurait pu choisir tout le monde ou personne, qu’importe le lieu où l’on était, ce que l’on faisait, qui l’on est. Et puis, finalement, c’est le hasard qui tue, et donc les terroristes n’ont presque pas d’existence dans ce livre, ils sont complètement désincarnés. Non que Laurent Gaudé ne les considèrent pas comme des humains (hélas, trois fois hélas, oui l’humanité aboutit aussi à cela), mais il s’agit plus d’une figure de style qui permet de les mettre hors champs parce que ce livre n’est pas pour eux, n’est pas sur eux, ils n’y ont tout simplement pas droit de cité.
C’était un livre difficile à écrire, du moins je l’imagine. Mais je trouve que Laurent Gaudé a su trouver un ton et un style équilibrés qui ne masquent pas la réalité (avec quelques descriptions difficilement soutenables) mais qui donnent humanité, tendresse et respect à tous ceux qui ont vécu ces événements. En en faisant une tragédie grecque, il arrive à la fois à rendre ses personnages uniques et vivants et à en faire des archétypes, presque des héros au sens mythologique du mot.
L’entreprise était risquée, mais pour moi, elle est réussie. Je suis cependant bien consciente que la façon très particulière qu’a Laurent Gaudé d’aborder ce sujet qui est encore pour beaucoup une plaie à vif ne plaira pas à tout le monde. Il est important de savoir un peu dans quoi l’on s’embarque avant de commencer cette lecture. Pour moi, même si je ne me suis fiée qu’à mes lectures précédentes de cet auteur avant de me lancer, cela a fonctionné. Ça a été une lecture intense, difficile même si les phrases coulent facilement, sombre bien sûr, mais une lecture dont je sors… dont je sors, je ne sais comment dire, groggy ? désespérée ? sonnée ? Je ne suis pas sûre d’avoir plus d’espoir en l’humanité, je ne suis pas sûre d’avoir pu donné un sens à toutes ces horreurs, mais j’ai eu l’impression que d’une façon ou d’une autre, j’ai pu honorer une mémoire collective sans oublier les drames individuels.
Titre en anglais : non traduit


J’ai vu ce livre sur les tables de ma librairie (enfin, pas la mienne, mais celle où on peut toujours me trouver quand je vais faire un tour en ville...) à sa sortie il y a quelques mois. J’étais toute contente de trouver un nouveau titre de cet auteur que j’apprécie beaucoup. Puis j’ai lu le résumé et je me suis dit que je n’étais peut-être pas prête à lire un livre sur les attentats du 13 novembre 2015. Mais en repassant à la librairie quelques mois plus tard, j’ai fini par me laisser tenter, me disant qu’après tout c’était du Laurent Gaudé, donc que je pouvais peut-être lui faire confiance malgré la difficulté du sujet.
Et ce n’était pas prévu comme ça, mais j’ai pris ce livre un soir (alors qu’il y avait classe le lendemain), et je n’ai pas pu le lâcher sans l’avoir terminé. Trop dur pour que je le laisse en suspens.
Trop envoûtant aussi, même si ce mot peut paraître étrange. Envoûtant parce que ce livre est comme une longue récitation, de longs monologues qui se tressent comme un natte épaisse à laquelle se raccrocher pour ne pas sombrer.
On sent ici à chaque page les influences de Laurent Gaudé qui fait de cette tragédie un drame antique dans lequel le chœur des anonymes qui ont eu un rôle ce jour-là, sans l’avoir demandé. Le livre ne parle vraiment que de la soirée des attentats et un tout petit peu de la nuit qui a suivi. On y croise les gens aux terrasses, ceux au concert, et puis plus tard les urgentistes, les forces de l’ordre. Il y a aussi ceux qui resteront et qui devront affronter l’attente et l’angoisse, puis l’horreur de la confirmation.
Je dis que le livre ne parle que de la soirée, c’est faux, en fait il commence le 13 au matin, il suit ces gens, qui commencent leur journée comme tout un chacun, ceux qui pensent à leur journée de travail, ceux qui se disputent avec leur conjoint, ceux qui s’émerveillent d’une si douce journée si tard dans la saison et qui se promettent d’en profiter ce vendredi soir, ceux qui ont une amoureuse à rencontrer, un anniversaire à fêter. Et s’invite un personnage dont on a perdu l’habitude dans notre littérature moderne, le hasard. Le simple et pur hasard qui fait choisir une table plutôt qu’une autre, qui fait se lever à une seconde plutôt qu’à une autre. Le hasard, qui semble le personnage principal de la pièce, jusqu’à ce qu’il ait rempli son rôle et alors quand il a fait son choix, il s’efface et laisse ceux qu’il a pointé du doigt prendre le centre de la scène.
J’ai beaucoup aimé cette figure du hasard, qui pour moi a deux fonctions. La première est de réussir à faire entrer le lecteur dans l’histoire malgré la difficulté de ce qui est raconté. C’est le hasard qui a choisi, et le hasard aurait pu choisir tout le monde ou personne, qu’importe le lieu où l’on était, ce que l’on faisait, qui l’on est. Et puis, finalement, c’est le hasard qui tue, et donc les terroristes n’ont presque pas d’existence dans ce livre, ils sont complètement désincarnés. Non que Laurent Gaudé ne les considèrent pas comme des humains (hélas, trois fois hélas, oui l’humanité aboutit aussi à cela), mais il s’agit plus d’une figure de style qui permet de les mettre hors champs parce que ce livre n’est pas pour eux, n’est pas sur eux, ils n’y ont tout simplement pas droit de cité.
C’était un livre difficile à écrire, du moins je l’imagine. Mais je trouve que Laurent Gaudé a su trouver un ton et un style équilibrés qui ne masquent pas la réalité (avec quelques descriptions difficilement soutenables) mais qui donnent humanité, tendresse et respect à tous ceux qui ont vécu ces événements. En en faisant une tragédie grecque, il arrive à la fois à rendre ses personnages uniques et vivants et à en faire des archétypes, presque des héros au sens mythologique du mot.
L’entreprise était risquée, mais pour moi, elle est réussie. Je suis cependant bien consciente que la façon très particulière qu’a Laurent Gaudé d’aborder ce sujet qui est encore pour beaucoup une plaie à vif ne plaira pas à tout le monde. Il est important de savoir un peu dans quoi l’on s’embarque avant de commencer cette lecture. Pour moi, même si je ne me suis fiée qu’à mes lectures précédentes de cet auteur avant de me lancer, cela a fonctionné. Ça a été une lecture intense, difficile même si les phrases coulent facilement, sombre bien sûr, mais une lecture dont je sors… dont je sors, je ne sais comment dire, groggy ? désespérée ? sonnée ? Je ne suis pas sûre d’avoir plus d’espoir en l’humanité, je ne suis pas sûre d’avoir pu donné un sens à toutes ces horreurs, mais j’ai eu l’impression que d’une façon ou d’une autre, j’ai pu honorer une mémoire collective sans oublier les drames individuels.
156raton-liseur
121. -. (-) Poison Ivy, tome 1 : Cycle vertueux de G. Willow Wilson (scénario) et Marcio Takara (dessin), traduit de l'anglais par Mathieu Auverdin
Titre original : Poison Ivy Vol. 1: The Virtuous Cycle


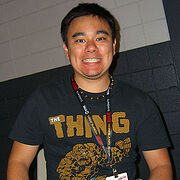
Mon premier DC Comics, et il a fallu qu’il soit dans la sélection du prix BD auquel je participe pour que je le lise. Pour être honnête, je l’avais emprunté à la bibliothèque il y a quelques mois, parce que la couverture me plaisait et je me suis dit que le livre taperait peut-être dans l’œil de ma jeune M’ni Raton. C’est là que M’sieur Raton m’a dit qu’il s’agissait d’une bd de super héros, résultat elle est retournée non lue à la bibliothèque… Point n’est besoin de préciser que j’ai donc commencé cette lecture à reculons.
Bon, d’accord, le côté un peu psychédélique de certaines planches, la charte graphique, si je peux utiliser cette expression barbare, ne sont pas tout à fait dans mes habitudes ni dans mes goûts, mais j’ai trouvé le personne de Poison Ivy (donc je n’avais jamais entendu parler avant) plutôt intéressant. Ne connaissant pas son passé (je n’ai au que la rapide introduction pour tenter de m’y retrouver dans tous les épisodes et dans toutes les formes d’histoire), je n’ai pas tout saisi de sa rage et de ses motivations, mais son combat écologiste, bien que plutôt extrême, n’est pas sans intérêt, la question de la disparition de l’humanité pour laisser une chance au reste du vivant n’étant à mon avis pas une question si farfelue que cela. (Et puis que dire de la façon dont le véganisme est épinglé ! Moi qui suis en désaccord complet avec cette tendance, ça m’a bien fait sourire !).
Je ne suis pas sûre que j’emprunterai les tomes suivants, mais finalement, je suis assez contente d’avoir lu cette bd et de me rendre compte qu’elle est finalement plus riche que ce que mon ignorance me faisait penser !
Titre original : Poison Ivy Vol. 1: The Virtuous Cycle


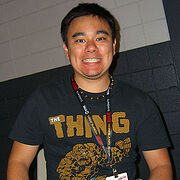
Mon premier DC Comics, et il a fallu qu’il soit dans la sélection du prix BD auquel je participe pour que je le lise. Pour être honnête, je l’avais emprunté à la bibliothèque il y a quelques mois, parce que la couverture me plaisait et je me suis dit que le livre taperait peut-être dans l’œil de ma jeune M’ni Raton. C’est là que M’sieur Raton m’a dit qu’il s’agissait d’une bd de super héros, résultat elle est retournée non lue à la bibliothèque… Point n’est besoin de préciser que j’ai donc commencé cette lecture à reculons.
Bon, d’accord, le côté un peu psychédélique de certaines planches, la charte graphique, si je peux utiliser cette expression barbare, ne sont pas tout à fait dans mes habitudes ni dans mes goûts, mais j’ai trouvé le personne de Poison Ivy (donc je n’avais jamais entendu parler avant) plutôt intéressant. Ne connaissant pas son passé (je n’ai au que la rapide introduction pour tenter de m’y retrouver dans tous les épisodes et dans toutes les formes d’histoire), je n’ai pas tout saisi de sa rage et de ses motivations, mais son combat écologiste, bien que plutôt extrême, n’est pas sans intérêt, la question de la disparition de l’humanité pour laisser une chance au reste du vivant n’étant à mon avis pas une question si farfelue que cela. (Et puis que dire de la façon dont le véganisme est épinglé ! Moi qui suis en désaccord complet avec cette tendance, ça m’a bien fait sourire !).
Je ne suis pas sûre que j’emprunterai les tomes suivants, mais finalement, je suis assez contente d’avoir lu cette bd et de me rendre compte qu’elle est finalement plus riche que ce que mon ignorance me faisait penser !
157raton-liseur
120. 74. (-) Une Fratrie de Brigitte Reimann, traduit de l'allemand par Françoise Toraille
Titre original : Die Geschwister
Titre en anglais : Siblings


Merci aux éditions Métailié de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
Il est toujours un peu compliqué de savoir comment apprécier un livre écrit en un temps où la censure s’exerçait sans vergogne et sous des cieux qui me semblent très loin de moi, de mon quotidien et de mon imaginaire. Ici, c’est la RDA du début des années 60, celle d’avant le mur et celle d’après Staline, mais la RDA tout de même. Un pays, ou un bout de pays déchiré en deux, dans lequel vit la jeune Elisabeth, toute jeune peintre œuvrant pour le rapprochement entre le monde de l’art et le monde ouvrier. Et un jour de 1961, Uli, ce frère avec qui elle a tout partagé, jeux, idées, frasques…, lui annonce qu’il part s’installer à l’Ouest. Pour elle, c’est un double déchirement : celui de voir son frère choisir une voie qui l’éloigne de ses convictions politiques à elle, et celui de s’apercevoir qu’elle n’a pas vu ce fossé qui se creusait avec celui qui était son alter ego.
Ce livre raconte, sur un temps resserré, intercalé de souvenirs de différentes périodes, les tiraillements d’une jeune fille pleine d’idéaux, qui se confronte à la réalité et aux choix des autres. Brigitte Reimann, une autrice que je ne connaissais pas mais qui semble avoir eu un certain succès à l’époque, a vécu une situation similaire puisque son frère a suivi le même chemin qu’Uli. Un chemin qui n’est pas un exil, puisque c’est toujours l’Allemagne, juste une autre partie, de plus en plus étanche, du même pays. Mais un chemin qui est celui de rêves différents et de familles irrémédiablement déchirées.
Un témoignage à la fois intime et politique, une vision intime de la partition de l’Allemagne que j’ai trouvée plutôt intéressante, surtout pour moi qui ne me suis jamais suffisamment intéressée à ce pan de notre histoire récente. Une bonne façon de commencer à réparer ce manque.
Ce livre a été écrit en 1961, mais n’est pas qu’en 1963, le temps d’obtenir les autorisations nécessaires (et le temps de couper quelques parties…). En 1961, Brigitte Reimann s’étonnait que le sujet n’ait pas encore été traité par la littérature. En 1963, est sorti un livre de Christa Wolf, Le Ciel divisé, sur le même sujet ! Comme quoi… C’est intéressant cependant, que ce soient deux femmes qui se soient saisies de ce sujet. Pas sûre que ce soit une coïncidence...
Et comme j’ai découvert Christa Wolf cette année, maintenant je me dis que je lirais bien aussi celui-là...
Titre original : Die Geschwister
Titre en anglais : Siblings


Merci aux éditions Métailié de m’avoir permis de découvrir ce livre, via netgalley.
Il est toujours un peu compliqué de savoir comment apprécier un livre écrit en un temps où la censure s’exerçait sans vergogne et sous des cieux qui me semblent très loin de moi, de mon quotidien et de mon imaginaire. Ici, c’est la RDA du début des années 60, celle d’avant le mur et celle d’après Staline, mais la RDA tout de même. Un pays, ou un bout de pays déchiré en deux, dans lequel vit la jeune Elisabeth, toute jeune peintre œuvrant pour le rapprochement entre le monde de l’art et le monde ouvrier. Et un jour de 1961, Uli, ce frère avec qui elle a tout partagé, jeux, idées, frasques…, lui annonce qu’il part s’installer à l’Ouest. Pour elle, c’est un double déchirement : celui de voir son frère choisir une voie qui l’éloigne de ses convictions politiques à elle, et celui de s’apercevoir qu’elle n’a pas vu ce fossé qui se creusait avec celui qui était son alter ego.
Ce livre raconte, sur un temps resserré, intercalé de souvenirs de différentes périodes, les tiraillements d’une jeune fille pleine d’idéaux, qui se confronte à la réalité et aux choix des autres. Brigitte Reimann, une autrice que je ne connaissais pas mais qui semble avoir eu un certain succès à l’époque, a vécu une situation similaire puisque son frère a suivi le même chemin qu’Uli. Un chemin qui n’est pas un exil, puisque c’est toujours l’Allemagne, juste une autre partie, de plus en plus étanche, du même pays. Mais un chemin qui est celui de rêves différents et de familles irrémédiablement déchirées.
Un témoignage à la fois intime et politique, une vision intime de la partition de l’Allemagne que j’ai trouvée plutôt intéressante, surtout pour moi qui ne me suis jamais suffisamment intéressée à ce pan de notre histoire récente. Une bonne façon de commencer à réparer ce manque.
Ce livre a été écrit en 1961, mais n’est pas qu’en 1963, le temps d’obtenir les autorisations nécessaires (et le temps de couper quelques parties…). En 1961, Brigitte Reimann s’étonnait que le sujet n’ait pas encore été traité par la littérature. En 1963, est sorti un livre de Christa Wolf, Le Ciel divisé, sur le même sujet ! Comme quoi… C’est intéressant cependant, que ce soient deux femmes qui se soient saisies de ce sujet. Pas sûre que ce soit une coïncidence...
Et comme j’ai découvert Christa Wolf cette année, maintenant je me dis que je lirais bien aussi celui-là...

